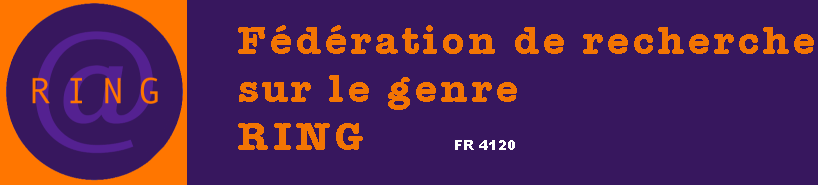Autres mots-clés :
texte
-
A propos d’un concept ou les difficultés du genre en France
Michèle Riot-Sarcey
Tout a été dit ou presque sur les relations conflictuelles entre l’analyse historique fondée sur le genre et l’écriture de l’histoire sociale, politique ou économique. Dans tous les pays, les historiennes, particulièrement, se plaignent de la faible intégration des femmes dans l’Histoire, au sens global du terme.
Le mode de penser l’histoire en France est cependant assez spécifique, si l’on en juge par le rapport tendu de ses historiens avec la question du genre.
lire la suite
-
Sciences Po, le MLF et la mémoire des luttes féministes
Les études de genre en France, année zéro ?
Juliette Rennes et Rose-Marie Lagrave
Si la catégorisation d’un phénomène comme "nouveau" est un principe récurrent de production de l’information, lorsque ce principe concerne le traitement des mouvements sociaux et des mobilisations, il a aussi pour effet d’effacer l’histoire des luttes. Il est ainsi courant que des féministes se voient qualifier de "nouvelles" quand bien même elles se présentent comme des héritières des luttes antérieures.
lire la suite
-
Nicole-Claude Mathieu ou l’espoir d’une transmission muliéri-linéaire et plurilocale
Jules Falquet
Nicole-Claude Mathieu vient de nous quitter le 9 mars 2014. Une théoricienne fondamentale disparaît, et avec elle une militante décidée et une pédagogue généreuse. Mais Nicole-Claude Mathieu n’est pas morte : sa jument noire caracole encore parmi nous. Sa jument noire ? Plus exactement, elle nous laisse toute une manade sauvage, qui emporte nos pensés et leur donne de l’audace depuis plus de quarante ans. Ces fières créatures sont avant tout le produit d’un mouvement, de luttes et de réflexions portées par des femmes très variées dans le monde entier, non-occidental et occidental comme elle insistait pour l’écrire. Dans cet élan collectif et multiple, Mathieu a posé noir sur blanc, texte après texte, un certain nombre de propositions fortes.
lire la suite
-
Féminisme, modernité, postmodernisme : pour un dialogue des deux cotés de l’océan
Eleni Varikas
Si, dans ses versions dominantes, la réflexion féministe a historiquement montré un attachement pathétique au projet de la modernité, cette passion - malheureuse car trop souvent à sens unique - est en train de s’affaiblir quand elle ne se tourne pas purement et simplement en son contraire. Pour ne pas avoir rempli ses promesses émancipatrices, la modernité devient l’objet d’une interrogation qui tend à déstabiliser quelques-unes des certitudes les mieux installées de notre tradition de l’Aufklärung, cette même tradition qui a vu naître la demande de l’émancipation des femmes.
lire la suite
-
De l’histoire politique et des pouvoirs
Michèle Riot-Sarcey
S’il nous fallait rendre compte des discours d’exclusion des femmes de la cité, cet article n’y suffirait pas ; bien d’autres avant moi ont analysé ces discours, sans cependant infléchir l’écriture de l’histoire politique vers la critique des relations de pouvoir où s’inscrit le devenir historique des femmes. Du point de vue du mode de penser le politique, nous sommes toujours ou presque assignées à « la loi » énoncée par Auguste Comte :
« C’est ainsi que dans toutes sociétés humaines, la vie publique appartient aux hommes et l’existence des femmes est essentiellement domestique. Loin d’effacer cette diversité naturelle, la civilisation la développe sans cesse, en la perfectionnant. »
lire la suite
-
Entretien avec Michèle Perrot
Christine Planté
-
Questions de différence
Christine Planté
Pour décrire les positions en présence dans les différents travaux concernant la place des femmes et les rapports sociaux entre les sexes, on a l’habitude de recourir aux termes, supposés antinomiques, d’égalité et de différence, ou encore on parle d’un féminisme égalitaire et d’un féminisme identitaire . Le premier, héritier des Lumières, revendiquerait l’application à toutes et à tous des droits des individu(e)s né(e)s libres et égaux/ ales, ce qui suppose de démontrer que les femmes sont bien des individus, des êtres humains, autant que les hommes, et que la différence des sexes, les comportements sexuels tels qu’ils sont connus, sont impensables indépendamment de leur construction sociale, historique et culturelle. Le deuxième, tenant la différence pour acquise, dénonce son occultation, ses travestissements ou utilisations par une société phallocentrique, cherche à en changer le sens et la valeur, et la place au fondement d’une réflexion théorique, politique et éthique.
lire la suite
-
L’usage du genre au Portugal : en tant que catégorie analytique ou descriptif ?
Virgínia Ferreira, Université de Coimbra (Portugal)
La difficulté de conceptualiser les femmes, comme collectif social, par la Sociologie et d’autres sciences sociales, aussi bien que les problèmes suscités par le concept de " gender " sont présents dans l’oeuvre de beaucoup d’auteurs, femmes et hommes, qui, au Portugal, ont effectué des recherches dans ce domaine. Voyons quelques exemples, entre celles et ceux qui me semblent plus significatives/significatifs.
lire la suite
-
Les Etudes Genre en Suisse : entre dynamisme et institutionnalisation précaire
Gaël Pannatier et Magdalena Rosende
Les Etudes Genre ont connu un développement réjouissant cette dernière décennie en Suisse, avec la création de plusieurs postes dans les universités. Derrière ce tableau idyllique, il faut cependant relever que la plupart des postes, centres ou projets ne sont pas stables et que les avancées sont le produit de luttes et d’investissements de temps importants de la part des chercheur·e·s féministes. Dans ce pays fédéraliste, plurilingue, et composé de dix universités de taille modeste, la particularité du champ des Etudes Genre est la volonté de mise en réseau sur le plan national. Elle se traduit notamment par deux projets qui oeuvrent pour beaucoup dans l’essor des Etudes Genre : le LIEGE (Laboratoire interuniversitaire en Etudes Genre) basé à l’Université de Lausanne (et principalement romand) et la plateforme internet GenderCampus, rattachée à l’Université de Berne.
lire la suite
-
Le féminin, un genre très singulier
Michèle Riot-Sarcey
Au risque de nous répéter, encore faut-il revenir sur l’usage du genre comme outil d’analyse historique. Mal introduit en France — sans doute à cause de sa polysémie —, il est souvent assimilé au sexe féminin, en tant que donnée biologique et, par voie de conséquence, de donnée historique.
lire la suite
Fichiers de syndication :
Statistiques :
Le site contient 4383 articles