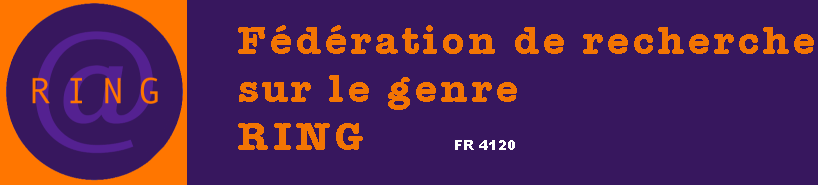Entretien paru dans la revue Futur Antérieur, numéro spécial "Féminismes au présent", avril 1993.
Christine Planté - La première question s’impose : elle concerne le succès de L’histoire des femmes, qui est très grand - et peut-être un peu inattendu. On peut s’interroger en termes sociologiques : pourquoi les gens achètent-ils ? - car, si les livres sont beaux, la lecture n’en est pas toujours évidente. On peut aussi se demander si ce succès s’accompagne d’une reconnaissance de la part de la communauté scientifique, si on peut en conclure que les choses ont changé, et attendre des changements épistémologiques durables.
Michelle Perrot - Ces questions seront [1] au cœur du colloque « Femmes et Histoire » de la Sorbonne (13 et 14 novembre 1992). Le succès de L’Histoire des Femmes en Occident nous a étonné(e)s. Il faut d’ailleurs le relativiser : ce n’est tout de même pas un best-seller ! Mais enfin, il semble que 20 à 25 000 exemplaires vendus pour chaque tome soit considéré comme un indice de succès pour ce type d’ouvrage, à la fois cher et relativement difficile de lecture. Succès, donc, auquel nous ne nous attendions pas vraiment, les éditeurs parisiens les premiers, réservés au départ devant cette entreprise dont il faut rappeler qu’elle vient d’une initiative de l’éditeur italien Laterza. Il est probable que le succès de cet objet n’a que peu de rapport avec son contenu. Il tient plutôt à son existence même, ressentie comme une affirmation de l’historicité des femmes. « Les femmes ont-elles une histoire ? », nous demandions-nous il y a vingt ans (1973 - C’était l’intitulé d’un cours à Jussieu - Paris VII). « Une histoire des femmes est-elle possible ? », poursuivions-nous en 1983 au colloque de Saint-Maximin, ayant en somme franchi une étape. Et maintenant voici la réalisation de cette Histoire, qui donne une réponse affirmative aux deux questions précédentes. Nos lectrices - et nos lecteurs, car il y en a plus qu’on ne croit - éprouvent un certain soulagement, un certain plaisir à cette reconnaissance. Pour les femmes, il y a là comme une figure d’identité. Beaucoup nous le disent. « Il y avait un manque », nous dit-on parfois comme si l’on constatait tout à coup une évidence ; « et vous l’avez comblé ». L’écho rencontré par cet ouvrage est donc à analyser comme un phénomène social.
De la même manière, on devra suivre la diversité des accueils selon les pays où cette Histoire sera publiée. Bien des facteurs rentrent en ligne de compte : la structure de la recherche universitaire, l’accueil fait à une équipe perçue comme française, la prise en compte de l’histoire nationale des femmes, et ceci est un vrai problème qui donne lieu à des solutions diverses. Tantôt, on ajoute des chapitres complémentaires l’édition espagnole a été ainsi très enrichie, notamment pour l’époque moderne (exportation des modèles féminins ibériques en Amérique latine, par exemple) ; l’édition allemande entend faire de même. Tantôt, il naît de nouvelles séries pour traiter l’histoire des femmes dans le cadre d’une nation. Les historiennes italiennes ont en chantier, chez Laterza encore, une histoire thématique des femmes italiennes depuis la Renaissance. Le cas des États-Unis sera particulièrement intéressant. Nathalie Zemon-Davis, qui a dirigé avec Arlette Farge le tome III, et Joan Scott, qui a collaboré au tome IV, ont ressenti la nécessité d’écrire une courte préface pour le public américain, expliquant en quoi cette Histoire sur la longue durée est très française, comme aussi la moindre importance accordée à la sexualité, surtout à l’homosexualité. Il y a parfois quelque dépit dans les pays francophones qui s’estiment trop annexés implicitement au cas français. Et si le tome V XXè siècle) a été particulièrement salué au Québec, c’est qu’un chapitre, rédigé par Yolande Cohen, professeur à l’U.Q.U.A.M., y traite des fermières, choix considéré d’ailleurs par certaines féministes québécoises comme trop traditionnel. On le voit : les choses sont infiniment complexes. En tout état de cause, cet objet a une histoire qui désormais nous échappe. Et les réactions rencontrées nous rendent plus conscientes des implications de choix opérés parfois de manière assez pragmatique.
Quant aux milieux scientifiques, ils ont manifesté un certain étonnement : après tout, ce n’est pas si mal ! Mais on ne peut pas dire qu’il y ait eu jusqu’à maintenant beaucoup de réactions critiques. C’est pourquoi nous les avons nous-mêmes suscitées, en sollicitant des « lectures critiques » des différents volumes pour le colloque organisé à la Sorbonne [2]. Ce colloque, que nous devons à Véronique Neiertz, secrétaire d’État aux droits des femmes, qui souhaitait ainsi soutenir une réalisation qu’elle a beaucoup appréciée, comporte un indéniable aspect de légitimation. Parler d’histoire des femmes à la Sorbonne, où les jeunes filles eurent tant de mal à se faire leur place - en 1895 encore, un chahut s’opposait à leur présence dans un cours - et dans le Grand Amphi, où tant de femmes furent des auditrices déférentes et muettes (de la Sorbonne et du Collège de France, une institutrice de la fin du siècle dernier disait « mes sanctuaires »), comporte une part de jouissance symbolique incontestable. Nous parlerons sous des fresques où figurent tant d’allégories féminines de la Science et des savoirs dont les femmes étaient exclues. Signe que les temps ont changé et qu’il y a - donc - eu histoire et modification des rapports de sexes dans les champs et les lieux intellectuels.
Plaisir, donc. Triomphalisme, non pas. Est-ce que l’existence de cette Histoire des Femmes s’accompagnera d’un nouveau type de questionnement, ce qui serait bien plus important que les petites satisfactions d’amour-propre ? C’est moins sûr, encore que des signes existent, par ailleurs, d’une meilleure prise en compte de la différence des sexes dans la recherche historienne. Pour Georges Duby, qui codirige cette Histoire, c’est un souci ancien, visible dans ses cours du Collège et dans ses livres. Plus récemment, et pour ne donner que quelques exemples, Jean Delumeau publie La religion de ma mère [3], résultat d’un séminaire mené plusieurs années durant dans ce même Collège, où il est question à la fois du rôle des femmes dans la transmission religieuse, et des limites imposées par les églises à l’exercice de leurs pouvoirs et de leur parole. Pierre Rosanvallon, dans Le sacre du citoyen [4], consacre d’assez longs développements aux raisons de l’exclusion des femmes de la citoyenneté politique en France, problème traité par les historiennes, mais ordinairement ignoré par les auteurs masculins [5]. Dans leur ouvrage sur La société française au XIXe siècle [6], Jacques Dupâquier et Denis Kessler posent la question de l’invisibilité du travail des femmes qu’on ne remarquait guère il y a quelques années. Bien entendu, ce n’est pas l’effet de la parution de L’Histoire des femmes, mais l’indice d’un climat général où les développements de la recherche dans ce domaine depuis deux décennies finissent par porter leurs fruits. Sans qu’on puisse parler de bouleversement épistémologique !
Sans doute faudra-t-il encore plus de temps pour que l’histoire des femmes soit abordée dans l’enseignement secondaire. Le rôle des femmes professeurs sera ici essentiel. Mais un intérêt existe. Des candidats au CARE.S. ont eu à traiter des questions relatives à l’histoire des femmes. Et en janvier prochain, l’association historique que dirige Jacques Marseille et qui organise des séances d’information historique pour les professeurs du second degré, a mis à son programme : « les femmes dans l’économie et la société française aux XIXè et XXè siècles ». Comment introduire ce questionnement, ces résultats dans les programmes et les manuels du secondaire, c’est un projet gigantesque que devra sans doute assumer la génération qui vient.
Eleni Varikas - Vous venez de le rappeler, il y a quelques années, vous aviez posé la question avec d’autres : une histoire des femmes est-elle possible ? L’Histoire des femmes a, de fait, donné une réponse positive. Il n’empêche que dans votre introduction commune avec Georges Duby, vous évoquez le caractère problématique de l’histoire des femmes comme objet continu. Vous dites par exemple, dans l’introduction du tome XIXè siècle, que la condition féminine n’est pas un objet en soi, mais que justement ce qui vous intéresse est ce qui change. Comment cette contradiction a-t-elle informé votre travail préparatoire ? Et après coup, considérez-vous que le livre a aidé à reformuler ces tensions - et à avancer ?
M. P. - Il y a l’intention et la pratique. L’intention de l’équipe de direction de Histoire des Femmes en Occident a bien été de mettre au cœur de la réflexion le rapport entre les sexes, de ne jamais traiter les femmes en territoire séparé, mais comme partie d’un univers mixte. Introductions et liaisons écrites par les directrices de volume le rappellent sans cesse. Mais 70 auteurs dispersés en France et à l’étranger ne peuvent fonctionner comme une équipe constamment cohérente. D’où sans doute le sentiment parfois d’un discours éclaté, qui est aussi peut-être une respiration de liberté.
Cette volonté, cet accent sur la priorité du rapport entre les sexes ne sont pas toujours bien reçus. Récemment, au Québec, lors d’une conférence, une auditrice m’en faisait le reproche : faire l’histoire des rapports entre les sexes, n’est-ce pas en définitive faire l’histoire des représentations et des discours masculins et oublier les femmes ? Grande question, en effet. L’inégalité des sources y contraint souvent. Pour l’Antiquité, par exemple, on ne dispose que de textes ou d’images produits par des hommes ; il faut y lire en creux la présence plus ou moins lointaine, parfois tumultueuse, des femmes. Les choses s’arrangent progressivement, du moins pour l’écrit - l’image, elle, demeure beaucoup plus obstinément et longtemps masculine, d’où les problèmes que pose son usage, auquel nous avons tenté de réfléchir dans chacun des volumes et dans le tout récent Images de femmes [7]. Les modifications du partage des formes d’expression masculines et féminines sont une de nos lignes de crête, suivies obstinément à travers les cinq volumes. La prise d’écriture et de parole des femmes est certainement un des aspects majeurs de leur historicité. Mais on aurait pu sans doute mettre l’accent plus résolument sur les pratiques féminines dans tous ces domaines.
Une autre question butoir est celle de la chronologie. Par commodité, nous avons repris les grandes divisions classiques de l’histoire occidentale, telles qu’elles ont été élaborées notamment au XIXè siècle. Nous avons accordé nettement plus de place aux deux derniers siècles, puisque les XIXè et XXè siècles bénéficient chacun d’un volume propre. Nous nous sommes davantage préoccupés de saisir les changements des rapports de sexes dans ces périodes préétablies que de reconstruire une autre chronologie. Nous n’en serions pas présentement capables ; à peine pourrions-nous identifier les « tournants » véritables, voire les événements majeurs (ce qui est tout de même plus simple).
Quant à la question du choix de l’espace occidental, nous nous en sommes expliqués, parce que nous étions plus conscients des problèmes réels posés par une telle limite, difficilement dépassable en raison de la situation des historiographies. Celles-ci se sont développées essentiellement dans l’aire occidentale. Et ce n’est pas arbitraire. Il y a un lien très fort entre historiographie et évolution politique des sociétés. En allant vite, on pourrait dire que l’histoire des femmes (au sens history) est fille de la démocratie, qui, pourtant, avait d’abord exclu les femmes de la Cité. Il est probable que l’écriture de l’histoire des femmes progressera avec le développement de la démocratie, qui induit des rapports plus égalitaires entre les sexes, et par conséquent l’accès des femmes aux savoirs et à l’Université. On voit ce processus s’amorcer au Japon, dans les pays de l’Est (où une forte demande existe du moins) et plus encore en Amérique latine.
E. V. - Surtout que dans ce dernier cas, il s’agit vraiment d’une histoire du rapport des sexes, d’une histoire du genre, comme au Brésil où il existe des travaux importants sur les manières dont le genre construit le concept de classe par exemple.
M. P. - Et puis aussi des réflexions très importantes sur l’ethnicité, la question indienne, l’esclavage, la question du racisme. Même à ne considérer que l’Europe, on aurait certainement dû être plus attentifs à l’influence de l’Islam. On a fait une large place au christianisme, le judaïsme n’est présent que dans le volume du XIXè siècle, l’Islam est absent. Or, on réalise bien, ne serait-ce qu’en voyant les événements d’aujourd’hui, que le fait de ne pas s’être vraiment posé cette question est une lacune. D’autre part, il est vrai, Françoise Thébaut le dit très bien dans son introduction au volume XXè siècle, il y a trop peu de choses sur les femmes migrantes qui font partie de l’histoire du monde occidental. Nous faisons donc une autocritique déjà.
Ch. P. - Il me paraît intéressant de revenir en deux mots sur le lien entre histoire des femmes et démocratie, sur cette idée que vous avancez de la démocratie comme condition de possibilité de l’histoire des femmes. Est-ce là un sentiment commun, partagé par l’ensemble de l’équipe, une sorte de découverte à l’issue du travail ? Et ceci vous amène-t-il à revenir sur l’idée d’une exclusion des femmes au fondement même de la démocratie, avec l’exemple athénien et celui de la Révolution française ?
M. P. - Les travaux de Nicole Loraux pour la Cité athénienne, de Geneviève Fraisse, Michèle Riot-Sarcey et d’autres pour le XIXè siècle ont bien montré le caractère exclusif de ces démocraties autour de la question centrale du pouvoir politique. La définition de la citoyenneté est une opération conjointe d’inclusion et d’exclusion. L’intérêt, et la nouveauté, de la conception de la Révolution française, c’est qu’elle est universaliste et individualiste. Personne n’est exclu définitivement. Pas même les femmes ! Comme le dit Siéyès, elles le sont « pour le moment du moins ». Provisoirement, en attendant qu’elles deviennent capables. On sait que l’examen de capacité a, en ce qui les concerne, duré longtemps. Mais la démocratie des Droits de l’Homme et du Citoyen rend possible la citoyenneté des femmes. Dans sa contradiction initiale - ou dans sa logique - s’est développé le féminisme et, plus largement, une « conscience de genre » (Eleni Varikas), une opinion publique féminine dont l’étude n’est qu’à peine amorcée. Rien de tel n’est possible dans un État totalitaire où le chef - le Père - représente les sujets et les familles.
La réflexion liée à l’organisation et à l’écriture de Histoire des femmes en Occident m’a rendue plus consciente de l’importance de l’espace démocratique pour les femmes. Pour leur avènement politique, la démocratie n’est certes pas une condition suffisante, mais elle est absolument nécessaire.
E. V. - Pendant que vous parliez, j’étais en train de penser que, dans l’historiographie féministe, en particulier anglosaxonne, il y a une évaluation inverse de cette même histoire des femmes qui est en même temps l’histoire de la démocratie. Je pense à tous les travaux récents sur la dynamique sexuée des Lumières, de la Révolution française, de la constitution de l’espace. public - sans parler de la « Découverte », du prix qui a été payé pour la marche de la démocratie. Cette réflexion suggère une vision bien plus pessimiste en ce qui concerne les possibilités de la démocratie, telle- qu’elle a été formulée, réfléchie et constituée historiquement, de faire accéder les femmes au statut de l’individu, et qui plus est de l’individu égal. Vous avez mentionné le rôle de l’individualisme. Pour de nombreux révolutionnaires, entre l’État et l’individu il ne doit y avoir que le vide. Or la famille est réfléchie comme une médiation entre les deux. La famille est précisément une unité, dont tous les membres n’ont pas le même accès à l’individualisation ; une unité considérée comme naturelle, qui impose d’emblée une division sexuelle, l’exclusion des femmes du politique comme condition de la démocratie.
Au fond, cela repose le problème des périodisations sous formes de l’évaluation des moments historiques du progrès. Je pense au célèbre article de Joan Kelly « Les femmes ont-elles eu une Renaissance ? ». Si elles n’en ont pas eu une, cela signifierait-il qu’il y a eu une Renaissance pour les hommes ou bien qu’il n’y a pas eu de Renaissance du tout ? Ce sont quand même des enjeux très importants pour l’histoire des femmes.
M. P. - Mais, comme je vous l’ai dit, sur ce point nous n’avons pas donné des réponses. On ne propose pas une nouvelle périodisation. On essaie simplement de voir quelles ont été les ruptures qui ont modifié les rapports de pouvoir entre hommes et femmes. Il y a quelque chose que tous les auteurs admettent dans ces volumes : l’existence d’une surdétermination de la domination masculine. Quels sont les moments où les femmes ont connu des avancées ? A quels moments ont-elles modifié, de façon positive, le rapport au pouvoir, à l’espace, aux rôles ? C’est ainsi qu’on a essayé de traiter le problème de la périodisation.
Ch. P. - Vous paraît-il, si ce n’est possible dans l’immédiat, du moins souhaitable, d’élaborer une périodisation autre ? Serait-ce un objectif d’une histoire des femmes et des rapports de sexes ?
M. P. - En tout cas, il serait intéressant de s’attaquer à un problème sur lequel tout le monde réfléchit actuellement. C’est la question des tournants : quels ont été les vrais tournants dans les rapports masculin/féminin ? Cela ne mènerait pas nécessairement à modifier la totalité de l’histoire des sociétés. Il y a d’ailleurs là un problème : si l’on considère que le rapport masculin/féminin n’est qu’un élément de l’histoire des sociétés, on pose que ce n’est pas le seul facteur, qu’il y en a d’autres. Autrement dit, réfléchir aux tournants des rapports masculin/ féminin est un véritable enjeu dans la mesure où cela amènerait à bien situer les rapports de sexes dans un ensemble, ce que nous avons essayé de faire sans toujours y parvenir.
Ceci dit, si j’avais à réorganiser L’Histoire des femmes, je ne ferais pas autrement.
Ch. P. - L’abandon, au moins partiel, d’un plan chronologique au sein de chaque volume, était-il conçu comme un des moyens de cette réflexion, ou signifie-t-il que cette histoire a à traiter d’objets qui échappent à l’ordre du temps (disons du temps court et du temps linéaire) ?
M. P . - Il est vrai qu’à l’intérieur de ces grandes tranches chronologiques, on a choisi des thèmes. Autrement dit, on pourrait dire que ces ouvrages sont chronothématiques. On s’est demandé : dans telle période (admettons le Moyen Age) quels sont les thèmes importants ? Nous avons exclu un projet encyclopédique qui aurait cherché à tout traiter. Les responsables de période, avec leurs équipes, ont voulu dégager les problèmes importants en tenant compte des recherches existantes. Ainsi a-t-on choisi de réfléchir sur la déesse pour l’antiquité, sur la parole religieuse des femmes à l’époque médiévale, on pourrait multiplier les exemples. Le féminisme n’est peut-être pas suffisamment bien traité, mais il est quand même très présent dans le volume XIXè siècle, parce que c’est à ce moment que le féminisme se constitue comme mouvement. Le volume XXè accorde une grande place à ce que Françoise Thébaut appelle la nationalisation des femmes et on retrouve là un ordre chronologique. Il est vrai qu’il existe des chronologies fortes et des chronologies faibles. Par exemple, les chronologies fortes au XXè siècle sont les deux guerres, les régimes totalitaires. Est-ce qu’elles nous paraissent très fortes parce que nous venons de les vivre ? Est-ce que dans 500 ans, les gens considéreront qu’après tout ce n’était pas si important que cela, c’est une question qui se pose. Les auteurs américaines ont critiqué et refusé un plan envisagé pour le XXè siècle qui prenait appui sur les deux guerres. Elles estimaient que c’était là une chronologie européenne. Il y a donc eu un rééquilibrage, les guerres ont été traitées d’une certaine manière, on a donné aussi satisfaction à ce point de vue des Américaines. Ce désaccord montre bien l’importance des enjeux.
Pour les chronologies faibles, je dirais que quelle que soit l’importance de 1830, le passage des Bourbons à Louis Philippe, c’est quand même une chronologie plus faible que la Deuxième Guerre mondiale. On pourrait donc ne pas prendre appui sur les révolutions du XIXè siècle et négliger la chronologie pour ce volume là. Mais ça se discute.
E. V. - Oui. D’autant plus que, pour la formation de collectifs de femmes, pour la formation des premiers collectifs pour l’émancipation, c’étaient des dates clés aussi bien en France qu’en Angleterre.
M. P. - Mais vous savez, il y a eu discussion sur tout. Par exemple, le mot « tournant », je me souviens qu’il y a eu une discussion âpre autour du titre du chapitre sur la Révolution française : le « tournant français ». Je pensais qu’il fallait supprimer ce mot, parce que je ne suis pas sûre que la Révolution française soit un tel tournant pour les femmes. Mais Élisabeth Sledziewski a souhaité le maintenir. Vous voyez à quel point on peut avoir, avec des gens extrêmement proches, des différences d’appréciation sur ce qu’a bien pu représenter la Révolution française pour les rapports entre les sexes.
C. P. - Mais pour en revenir au choix de composition thématique, ne comporte-t-il pas le risque de faire manquer aux lecteurs une perception plus dynamique, et proprement historique, des choses ? J’y trouve le danger de se replier sur des images, presque de reconstituer des invariants, en tout cas de faire la part trop belle à des représentations figées.
M. P. - Ce risque est réel, et nous n’y avons sans doute pas échappé complètement. Néanmoins, cela vient en partie de l’objet lui-même, et, en ce qui concerne les rapports des hommes et des femmes à travers le temps, de la longue durée de certaines questions - la différence des sexes, le rapport amoureux, la maternité, etc. -, voire de certaines réponses. C’est vrai des images - la figure de la Méduse sans cesse reprise, la pérennité de Vénus, la récurrence de la Nikè dans la République, etc. - brodent autour de l’idée d’éternel féminin. C’est vrai des discours les plus savants. Les conceptions médicales du corps des femmes, des maladies des femmes, de l’hystérie sont d’une singulière permanence. La pensée de Galien est reprise jusqu’au XIXè siècle. Ou encore lorsqu’on parle du travail des femmes, l’image de la fileuse - Pénélope immobile - revient avec insistance. Faire l’histoire des femmes, c’est sans doute tenter de montrer les changements derrière ces structures imaginaires. Mais cela rend parfois difficile la saisie de ce qui fait événement.
Ch. P. - En découvrant les volumes, je me suis demandé si c’était un choix concerté, ou une contrainte éditoriale, de ne pas proposer de chronologie. L’exercice serait certainement difficile et discutable, mais utile pour les lecteurs...
M. P. - Faire une chronologie est une opération difficile qui suppose le discernement de ce qui fait événement. Encore une fois, notre réponse est certainement insuffisante sur ce point. C’est en tout cas quelque chose auquel il faudrait s’atteler, notamment pour une édition de poche dont il est question. Pour les deux derniers siècles, l’opération serait réalisable. Il faudrait sélectionner ce qui fait événement pour les femmes dans tous les domaines de la législation, de la création, du féminisme, de l’économie, de l’éducation, de l’hygiène, de la politique, de la religion, etc. Il s’est passé tant de choses qu’on n’aurait que l’embarras du choix et celui-ci ne serait pas facile. Pour les périodes plus anciennes, la difficulté serait nettement plus grande. Ce serait en tout cas un exercice intellectuel fructueux. Ceci étant, il y a quelque paradoxe dans cette exigence de chronologie et d’événementialisation que la Nouvelle Histoire avait rendu tellement plus légère. D’une certaine manière, l’histoire des rapports de sexes s’inscrivait bien dans la conception braudélienne de la durée et de la différence des temps.
E. V. - Je voudrais revenir sur le problème des récurrences, et de ce qui vous paraît structurel, de ce qui ne change pas dans l’image des femmes sur la longue durée. Dans le volume XXè, vous affirmez que le poids relativement important des « représentations », par rapport à ce qu’on pourrait appeler la « réalité matérielle » et les rapports sociaux, est quelque chose de spécifique à l’histoire des femmes. J’ai eu parfois l’impression que cela faisait partie d’un choix méthodologique plus large lié à l’idée que tout est construit. Est-ce que ce n’est pas une reformulation de la vieille dichotomie entre idéologie et réalité ?
M. P. - Vous avez probablement raison. Mais votre question appelle plusieurs réponses. D’abord, il y avait certainement au départ la conviction que les femmes sont imaginées avant que d’être décrites ou racontées et que nous devions d’abord nous atteler à décortiquer cet épais manteau de formations discursives. Michel Foucault s’est trouvé devant une difficulté semblable lorsqu’il a entrepris de faire l’histoire de la folie, et ce qu’il dit de la connaissance « évidente » des fous qui empêche longtemps toute véritable science à leur endroit m’a fait beaucoup réfléchir à la similarité des femmes dans le champ de la perception.
D’autre part, ce poids de la représentation, du symbolique, en ce qui concerne les rapports de sexes, est considérable. Dans une certaine mesure, il bloque les évolutions sociales, interdit l’événement, freine l’accès à l’historicité. Ces représentations, sans cesse réactivées (et les processus de réactivation sont essentiels), structurent les réalités et rendent difficile leur appréhension. Joan Scott le montre bien dans sa contribution sur les ouvrières au XIXè siècle (tome IV).
Plus que pour tout autre secteur de l’histoire, on est confronté ici au problème de la représentation et du réel, ce réel, objet du désir, obsession de l’historien, toujours atteint à travers des représentations et du langage, eux-mêmes constitutifs de la « réalité ». Sans doute est-ce vrai pour toute opération historique, mais on le ressent encore plus vivement pour l’histoire des femmes que pour celle du mouvement ouvrier, par exemple.
E. V. - En lisant votre livre, Les ouvriers en grève, j’ai vu l’intérêt d’un aller-retour entre expérience et représentations, faits et construction des faits. Mais en quoi y a-t-il quelque chose de spécifique aux femmes (en dehors de la surabondance de l’imaginaire à leur propos) ? Vous avez bien montré qu’on ne peut pas faire l’histoire ouvrière seulement par celle des « structures dures », que la classe ouvrière n’existe pas sans ses images (qu’elles soient créées par le regard de l’autre ou par ses propres acteurs).
M. P. - Certes, ce type d’interrogation n’est pas spécifique à l’histoire des femmes et c’est vrai que je l’avais très fortement ressenti auparavant pour les ouvriers. Les travaux de Jacques Rancière l’ont abondamment montré : le peuple et les femmes sont d’abord dans le regard de l’autre, parce qu’ils sont figures de l’altérité. Et ce regard les contraint à se définir dans cette relation qu’il n’est pas toujours aisé de transformer en liberté.
Il y a peut-être aussi des différences d’objet. Et de chronologie. Dans la première moitié du XIXè siècle, il est plus aisé de repérer les acteurs du mouvement ouvrier que les actrices du mouvement des femmes. Quel que soit notre désir de rendre visibles, de montrer les continuités, il faut reconnaître qu’il y a une différence d’échelle entre mouvement ouvrier et mouvement des femmes au XIXè siècle. Le féminisme est-il alors un mouvement social, au sens où l’entend par exemple Alain Touraine ? Le Maitron - dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français - comporte plus de 40 volumes ; nous savons bien qu’un dictionnaire du féminisme n’en comporterait pas tant : ce qui est d’ailleurs une raison supplémentaire pour le tenter, pour reprendre le projet ébauché il y a quelques années, avec Laurence Klejman, Florence Rochefort et Michèle Riot-Sarcey.
La notion de « minorité », jusqu’à une date récente, est encore plus forte pour les femmes. Si bien qu’une histoire des femmes hésite forcément entre une histoire des masses qui se confond avec celle des travaux et des jours, une ethnologie du quotidien, et une histoire des femmes exceptionnelles, plus biographique ou culturelle.
Ch. P. - Je me demande s’il n’y a pas, dans la notion même de représentation, un écrasement d’éléments hétérogènes. Je veux dire que les références et les modèles identitaires dont vous parliez, et qui sont, pour le XIXè siècle, la Vierge Marie, George Sand, Flora Tristan..., ne sont pas tous de même nature. Il est vrai que dans tous les cas, on se trouve confronté à une abondance de « discours sur » et d’images, avec une multiplicité de rapports de rejet et d’identification autour de ces figures. Mais, avec certaines, on est situé dans un ordre symbolique ou religieux, avec peu ou pas de réalité historique, tandis que les autres ont pour point de départ des pratiques individuelles et sociales de femmes. A analyser les choses en termes de dualité des « représentations » et du « réel », est-ce qu’on ne risque pas de perdre les passages des unes à l’autre, de manquer la pluralité des pratiques, à leur naissance même, des pratiques langagières aussi ? Plus simplement : George Sand, ce n’est pas que des « représentations », même si on a beaucoup fantasmé à son sujet, si on l’a beaucoup vilipendée, adorée, utilisée, caricaturée... Il y a bien sûr autour d’elle toutes ces images et ces clichés, et c’est souvent d’elle ce qu’on connaît le mieux. Mais enfin, il y a aussi ses écrits auxquels on peut avoir accès, ses pratiques, dont on sait beaucoup de choses.
M. P. - Si telle est votre impression de lectrice, c’est sans doute que nous avons un peu raté notre coup, du moins dans ce volume du XIXè siècle qu’avec Geneviève Fraisse j’ai dirigé. Notre intention, à Geneviève et moi, était pourtant claire et elle est constamment énoncée et reprise dans nos introductions et liaisons. Nous voulions naviguer entre « Ordre et Liberté » (titre de l’introduction générale), entre contrainte et choix. Nous voulions saisir le poids des déterminants, si forts en ce XIXè siècle qui entend remettre chaque sexe à sa place, qui veut penser les rapports de sexes et les réorganiser. D’où la place accordée par nous - parce qu’elle nous est apparue si prégnante - au Droit, à la réflexion philosophique, à la religion qui, consciente de l’enjeu éducatif, s’empare plus que jamais des filles. Nous voulions montrer comment les femmes sont « produites » d’où le titre de la seconde partie du volume. Mais ce terme - « de la production des femmes » - nous l’entendions aussi au sens actif. Nous voulions montrer que les femmes s’emparent de ce qui leur est donné ou abandonné pour construire leur sphère, leur existence, leur action. D’où - par exemple - l’insistance sur les pratiques de lecture et d’écriture dans l’Allemagne du XIXè siècle (Marie-Claire Hoock-Demarle). Ou encore sur les pratiques philanthropiques par lesquelles les femmes prennent pied dans l’organisation sociale, sur les voyages par lesquels elles s’approprient l’espace du monde. J’ai intitulé ce chapitre Sortir, pour suggérer tout cela. Notre intention était claire, donc. Mais il est bien possible, en effet, que nous n’ayons pas réussi à tenir la balance égale et qu’on sente excessivement cette pesée des structures et pas assez la dynamique du mouvement : qu’on n’entende pas assez le bruit des pas des femmes dans la Cité.
Ch. P. - Cela pose, il me semble, une question plus générale de méthode, à propos du poids des représentations dans les rapports sociaux de sexes, à propos aussi de ce qui se joue dans la notion de discours. N’y a-t-il pas quelque chose de caricatural et de dangereux à affirmer que « tout est construit » ? Si on peut dire, avec Joan Scott, que « l’ouvrière n’existe pas », les ouvrières, elles, existent, et on ne peut réduire leur existence, les conflits et les pratiques dans lesquels elles sont prises et interviennent, à un effet de construction discursive.
Je suis frappée, parmi les partis pris du livre, par celui de ne consacrer aucun chapitre à des figures qui ont marqué l’histoire des femmes ou le féminisme, que ce soient des figures de militantes (Flora Tristan, Louise Michel) ou de créatrices. Réfléchissant à ce que c’est qu’un événement du point de vue des femmes, vous dites que George Sand - sa vie et ses livres - constitue par elle-même un événement, et je crois que vous avez raison. Pourquoi alors ne pas lui avoir accordé plus de place ?
M. P. - Elle est très citée, quand vous regardez l’index c’est celle qui vient en tête. Il y a aussi Madeleine Pelletier et Madame de Staël. Mais nous sommes filles de l’école des Annales malgré tout, c’est-à-dire que pour nous les singularités comptent moins que les groupes, les ensembles. Nous avions aussi la volonté de rompre avec l’histoire des femmes célèbres, de nous débarrasser du modèle des biographies, nous voulions donc prendre les femmes dans leur globalité. George Sand était donc plutôt appelée à la barre comme témoin ; tel texte de l’Histoire de ma vie étant cité pour exemple par rapport à la religion ou à l’écriture. Toutefois, à la fin du volume qui se clôt sur des « paroles de femmes », on a choisi pour le XIXè siècle Madame de Staël et Lou-Andréas Salomé, qui sont quand même deux très grandes figures. Un texte de 1800 et un texte de 1900, qui de plus disaient des choses absolument opposées. Mais concevoir une histoire des femmes au XIXè siècle autour de grandes figures, ou leur consacrer un chapitre comme le fait Nathalie Zermon-Davis dans le volume XVIè-XVIIIè, réfléchissant sur le pouvoir, à partir des figures de reines, ce n’est pas ce qui nous a tentées.
Ch. P. - Mais sans tomber dans le culte biographique de la femme exceptionnelle, ne pouvait-on imaginer de rendre compte d’expériences singulières, qui auraient alors apporté un contrepoids aux représentations si présentes ? Puisque, de toute façon, des femmes comme Sand sont abondamment citées, pourquoi ne pas tenter de les évoquer de leur point de vue, de les montrer en action, de faire entendre leur parole, et lire leur écriture ? Privilégier les représentations peut empêcher de voir comment les rapports de force se modifient et qu’ils sont modifiables, en écartant les expériences singulières ou minoritaires...
La dernière interrogation que nous aimerions débattre avec vous concerne l’importance accordée, en particulier dans les différentes introductions, au discours et au langage. Vous dites que la prise en considération du discours est une tâche prioritaire de l’histoire des femmes, et peut-être aussi son apport méthodologique spécifique. Cela soulève de nombreux problèmes, en particulier concernant le traitement des textes en histoire et l’influence des théories de la déconstruction. On peut aussi se demander ce que signifie cette notion de discours, souvent confuse et ambiguë, parce qu’elle emprunte en même temps à des horizons théoriques très différents, et peut-être incompatibles. Elle tend à faire oublier que les discours (au pluriel) sont aussi des pratiques, qui peuvent transformer ceux qui les tiennent et l’univers social qui les environne. Dans certains usages de la déconstruction, on finit par croire que tout n’est que jeux de mots, par oublier que les discours sont tenus par des sujets, eux-mêmes situés à la fois dans des histoires singulières, des conflits, des rapports de forces et de pouvoirs.
M. P. - Ce sont des questions beaucoup trop vastes, qui mériteraient un débat particulier, et auxquelles il me paraît difficile de répondre en quelques mots.
Ch. P. - Que souhaitez-vous faire maintenant ?
M. P. - En ce qui concerne les femmes, j’ai plusieurs projets. D’abord, je vais travailler sur George Sand à la demande de l’Imprimerie Nationale qui souhaite la voir figurer dans sa nouvelle collection « Acteurs de l’Histoire ». Il m’a semblé que c’était une occasion de réunir ses « écrits polémiques », comme elle l’avait elle-même souhaité pour ses Œuvres complètes dans l’édition réalisée par Michel Lévy, qui lui fut, sur ce point, infidèle.
Ensuite, je voudrais tirer partie d’archives privées que m’a confiées Philippe Lejeune. Il s’agit d’une institutrice qui fut aussi une des premières femmes inspectrices de l’enseignement primaire, une certaine Marie Rauber, très représentative de la pensée laïque. Elle a laissé un journal volumineux, où elle consignait presque chaque jour ses -observations professionnelles (plus qu’intimes) en vue d’écrire un jour un « roman de mœurs administratives », comme elle disait. Ce roman, elle l’a en effet écrit, sous le titre « Une si belle position. Roman féministe », titre ironique d’un récit largement autobiographique, bien qu’écrit à la troisième personne et où elle règle pas mal de comptes, avec son milieu, ses collègues, ses supérieurs, ses disciples, et plus encore son mari... C’est assez grinçant, mais intéressant, par cela même.
Deux femmes - une célèbre, une inconnue - aux prises avec leur temps et l’ordonnant par l’écriture : voilà qui va, je pense, dans le sens de ces expériences singulières dont, à juste titre, vous souhaitiez la mise en récit.
[1] Cet entretien a eu lieu le 16 octobre 1992.
[2] Ces « lectures critiques » seront peut-être publiées dans les Annales, à la demande du secrétaire de la rédaction, ce qui serait une manière d’y faire pénétrer le débat que nous souhaitons.
[3] Jean Delumeau (sous la direction de), La religion de ma mère. Le rôle des femmes dans la transmission de la foi, Paris, Éditions du Cerf, 1992.
[4] Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 1992.
[5] P Rosanvallon cite les travaux de Dominique Godineau et d’Élisabeth G. Sledziewski. II faudrait ajouter les travaux de Geneviève Fraisse, notamment Muse de la Raison. La démocratie exclusive et la différence des sexes, Marseille, Alinéa, 1989, en attendant la publication de la thèse de Michèle Riot-Sarcey, Parcours des femmes dans la démocratie, à paraître prochainement chez Albin Michel.
[6] Jacques Dupâquier et Denis Kessler (sous la direction de), La société française au XIXè siècle. Tradition, transition, transformation, Paris, Fayard, 1992. La reconstitution des itinéraires de femmes est d’autant plus difficile à réaliser que, dans cette enquête démographique de grande ampleur, reposant sur la reconstitution généalogique des patronymes commençant par TRA (d’où le nom d’« enquête TRA »), les auteurs ne s’appuient, pour des raisons qu’ils expliquent, que sur les lignées masculines. Ainsi, en perdant leur nom, les femmes perdent leur existence sociale : nouvel exemple de l’invisibilité des femmes dans l’histoire.
[7] Georges Duby (sous la direction de), Images de femmes, Paris, Pion, 1992, tentative pour concilier l’image représentative (c’était le point de vue qui avait surtout guidé les iconographes des cinq tomes de Histoire des femmes en Occident) et belle. La question de la beauté n’est évidemment pas simple. A ce sujet, je me permets de renvoyer à mon article dans ce livre : « les femmes et leurs images ou le regard des femmes. »
Pour citer cet article :
Christine Planté , « Entretien avec Michèle Perrot », Fédération de recherche sur le genre RING, 1er août 2010. URL : http://www2.univ-paris8.fr/RING/spip.php?article1083
Fichiers de syndication :
Statistiques :
Le site contient 4383 articles