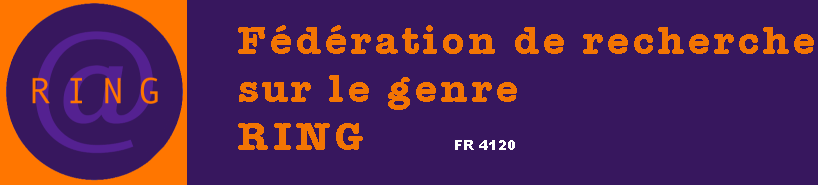Communication, colloque sur le genre, Université de Rennes, septembre-octobre 2002
Au risque de nous répéter, encore faut-il revenir sur l’usage du genre comme outil d’analyse historique. Mal introduit en France — sans doute à cause de sa polysémie —, il est souvent assimilé au sexe féminin, en tant que donnée biologique et, par voie de conséquence, de donnée historique. Or, le mot, au singulier, n’est pas statique, il porte en lui la partition, le rapport hiérarchique, voire la tension qu’il représente. De là vient la difficulté de son emploi. L’histoire des femmes fut longtemps privilégiée en France au détriment de l’histoire du genre qui présuppose une relecture de l’histoire en termes de rapport inégal entre les sexes. Et comment entreprendre cette histoire sans penser à la construction des différences, sans interroger les relations de domination qui les engendrent. Or, nous savons, après Michel Foucault, que la question des pouvoirs, constitutifs des rapports sociaux est, en général, mis à l’écart de la réflexion historique.
Si nous acceptons de mettre en cause la permanence du genre et d’envisager sa construction historique, il nous semble alors possible de dépasser les termes du langage propre à la France où le mot renvoie à la complexité de ses usages en nous référant à Emile Benveniste. « Les langues ne nous offrent en fait que des constructions diverses du réel, et c’est peut-être justement dans la manière dont elles élaborent un système temporel complexe qu’elles divergent le plus » [1].
C’est pourquoi il ne peut exister de genre qu’historique et la tâche de l’historien consiste à restituer l’historicité de cette formation. La mise au jour de la genèse d’un dispositif discursif permet alors de saisir une réalité dans son processus, là où les enjeux deviennent décryptables. Analyser l’historicité du genre suppose un travail sur le sens des mots qui le disent à travers les règles du système de domination à l’œuvre dans le mouvement de l’histoire, lequel participe au renouvellement constant des représentations discursives qui fondent le réel.
La part de modernité que j’esquisse ici commence avec la Révolution française, au moment où prennent naissance, ou plutôt figure concrète, les idées de liberté et d’égalité dont s’emparent les individus des deux sexes. Idée, au sens hégélien du terme, qui « créa ou renouvela toutes les questions par le principe nouveau qu’elle a proclamé et où l’égalité de la femme, comme toutes les autres, est contenue » [2].
Cette référence fondatrice a guidé les pas des féministes françaises pendant les deux siècles qui nous ont précédés. Est-elle à l’origine des formes d’exclusion dont ont été victimes les femmes ? Impossible de répondre à cette question. Pourtant tout a été dit ou presque sur la mise à l’écart des femmes de la sphère publique. Or, les faits mis au jour n’infléchissent aucunement le regard de l’historien sur l’apprentissage de la citoyenneté ou le sens de l’universalité, de préférence décliné au masculin. Aussi nous faut-il recourir à d’autres questionnements si nous voulons identifier la formation du genre.
En ces temps de troubles et d’angoisses qui agitent les contemporains, le féminin, comme valeur normative, s’inscrit au cœur du dispositif de reconstruction du lien social défait. Tour à tour magnifié, sacralisé ou minoré, le féminin, constitutif de l’identité d’une moitié de l’humanité, est repensé comme contribution à la régénération du spirituel et du naturel dont l’usage semble échapper à la sécularisation de la société. Comme si, la femme, au sein de la famille notamment, portait en elle le substitut des fonctions apaisantes du religieux. Thomas Laqueur a très bien montré la part du « sexe socialisé » dans l’élaboration de nouvelles règles de domination : « Les revendications universalistes de liberté et d’égalité de l’homme à l’époque des Lumières n’excluaient pas intrinsèquement la moitié féminine de l’humanité. Il fallait fouiller la nature si les hommes voulaient justifier leur domination, dont la distinction du domaine privé allait être, de plus en plus, imaginée en termes de différences sexuelles » [3]. Mais c’est encore trop peu pour être en mesure de juguler « le mal du siècle ».
En effet, les contemporains du début du siècle prennent conscience, si ce n’est de la mort de Dieu, tout au moins de l’inefficience de sa puissance transcendante. Théodore Jouffroy, par exemple, auteur du fameux « Comment les dogmes finissent » se découvre agnostique et en éprouve un immense malaise. « Ce moment fut affreux, écrit-il, et quand vers le matin, je me jetai épuisé sur mon lit, il me sembla sentir ma première vie, si riante et si pleine s’éteindre, et devant moi s’en ouvrir une autre sombre et dépeuplée où désormais j’allais vivre seul, seul avec ma fatale pensée qui venait de m’y exiler et que j’étais en train de maudire » [4]. Le suicide était à la mode selon les témoins de l’époque. Balzac l’érige en art : « Il y aura cependant un art dans lequel se feront de gros progrès, l’art du suicide » [5]. Aussi pour un grand nombre d’autorités des milieux politiques et culturels, il s’agissait moins de séculariser le sacré que de sacraliser la société [6]. Ce besoin de renouveau spirituel, cette nécessité de palingénésie sociale, selon l’expression de Pierre Simon Ballanche, furent admirablement compris par les mouvements romantiques du début du siècle.
Au carrefour des peurs contemporaines se dessinent alors les valeurs féminines par l’appropriation de la morale kantienne : la philanthropie et les bonnes mœurs sont à l’honneur. La femme est conçue comme une personne de devoir et de dévouement. Loin de rappeler les valeurs d’Ancien régime, dont la vocation serait de garantir la permanence de la famille au sein d’une cité déstabilisée, le féminin repensé participe à l’invention d’une nouvelle catégorie, hors histoire, entre spiritualité et nature, et dont l’existence suffirait à restaurer le lien social. L’idée, dont l’utilité est très vite comprise par les Eglises chrétiennes, particulièrement catholique, chemine aisément dans le mouvement de réveil religieux. Elle atteindra son apogée au sein des congrégations, en ascension continue au XIXe siècle.
Les saint-simoniens, également, s’emparent de l’aspiration du temps. Saint-Simon d’abord en publiant le Nouveau christianisme, les saint-simoniens ensuite en diffusant largement une nouvelle doctrine ; ils enseignent la religion nouvelle au sein de leur Eglise dont ils inventent le dogme et explicitent les rites. Lesquels suscitent à la fois l’engouement et le rejet des contemporains, toutes catégories sociales confondues, il est vrai pour un temps très court. La place du féminin prend tout son sens du côté du sentiment et de la spiritualité, bien au-delà des manifestations connues de « l’appel à la femme libre ». De la réhabilitation de la chair au trône laissé vacant pour accueillir la Mère, que d’aucuns cherchent en Orient, tout un corps de doctrines est élaboré afin de fonder la nouvelle humanité, bien loin du socialisme utopique que l’historiographie leur a attribué.
Selon les principes hégéliens, la femme incarne l’élément spirituel. « C’est pourquoi, le féminin a en tant que sœur le sentiment intime suprême de l’essence éthique ; il ne parvient pas à la conscience et à l’effectivité de celle-ci, parce que la loi de la famille est l’essence qui est en soi, l’essence intérieure qui ne se trouve pas au jour de la conscience, mais demeure sentiment intérieur, le divin dégagé de l’effectivité » [7]. Le féminin, sous la forme d’allégories et dans ses différents états symboliques, représente désormais la nouvelle spiritualité. On comprend mieux alors le succès sans précédent des écrits de Rousseau, de l’Emile à la Nouvelle Héloïse. L’interprétation de sa vision du monde, au cours du XIXe siècle, infléchit la raison du philosophe du côté des « rêveries du visionnaire » en faveur de « son modèle domestique », avec la part de spiritualité incombant aux femmes [8]. La représentation de la hiérarchie familiale, le partage des rôles prennent une valeur presque ontologique. Est alors oubliée l’opinion critique des premiers romantiques à l’encontre de cette figure soumise et consentante, en capacité d’apaiser les tumultes de la vie sociale. « Prétendre, que les femmes pourraient, pour ainsi dire, croire plus que les hommes en Dieu ou en Christ, et que quelque belle et bonne libre-pensée leur conviendrait moins qu’à eux, ce n’est qu’une de ses innombrables platitudes couramment admises, que Rousseau a rassemblé en un système méthodique d’une théorie de la féminité, dans lequel l’absurde était si bien mis au clair et en forme qu’il devait forcément rencontrer l’approbation unanime » [9]. Point de vue élitiste, mais d’une extrême lucidité. L’absurdité, comme on le sait, l’a largement emporté. Mis en forme tout au long de ce XIXe siècle, le rapport inégal au sein de la famille, légalisé par le Code, tissé par la morale, organisé par les représentations successives du bon gouvernement, peu à peu est considéré comme allant de soi. Naturellement admis par les autorités, la différence des sexes dans sa dimension sociale, n’appartient plus à l’histoire mais à la genèse de l’humanité, dans sa dimension religieuse, éthique et philosophique. La science commence alors à enrichir la panoplie des « découvertes » pour légitimer l’invariant du féminin, lequel peut contenir à la fois l’infériorité légale et la supériorité morale, voire l’extrême sensibilité de l’intelligence. Les qualités féminines sont déclinées en tout lieu, de l’Eglise à la littérature, sans omettre la théorie politique. Ainsi les femmes, en ce siècle, doivent savoir « librement se soumettre ». François Guizot a invoqué la « raison supérieur du père » comme figure emblématique du bon gouvernement. « La providence a voué les unes à l’existence domestique ; les autres (les enfants) n’ont pas encore atteint à la plénitude de leur existence individuelle et de ses facultés. De là dérive évidemment la première restriction du droit de suffrage, sa légitimité comme sa nécessité. La capacité est donc le principe naturel, la condition nécessaire du droit. Où manque la capacité, le droit n’est point » [10]. Alexis de Tocqueville dépasse le constat objectif pour faire intervenir la subjectivité des femmes elles-mêmes dans leur capacité à librement se soumettre. « Je n’ai pas remarqué que les américaines considérassent l’autorité conjugale comme une usurpation heureuse de leurs droits, ni qu’elles crussent que ce fut s’abaisser de s’y soumettre. Il m’a semblé voir, au contraire, qu’elles se faisaient une sorte de gloire du volontaire abandon de leur volonté, et qu’elles mettaient leur grandeur à se plier d’elles-mêmes au joug et non à s’y soustraire » [11].
Cette vision des rapports sociaux comme fondement de la théorie des capacités chères au gouvernement représentatif participe, comme on le sait, à la genèse de la démocratie représentative. Au cœur du système libéral, le rejet de l’idée même de souveraineté populaire, ou son étroit contrôle, est explicité par l’essence même de la dissymétrie familiale. Trop peu d’historiens ont relevé cet usage du genre dans la phase d’apprentissage de la démocratie qui tend à objectiver les catégories sociales selon des fonctions à valeur normative. À la fin du siècle, l’intériorisation du féminin sera si bien installée dans le mode d’être des femmes qu’il ne sera plus nécessaire de l’expliciter pour légitimer la répartition des rôles sociaux. Elle appartient désormais à l’impensé du politique.
Ainsi se construit le genre, consolidé, y compris par les auteurs les plus critiques, ou les plus marginaux par rapport à la pensée dominante : de Lamennais à Auguste Comte, le rôle des femmes est placé aux limites du réel. Magnifiée, sacralisée, « la » femme chez Auguste Comte est transformée en prêtresse de l’humanité. On en retrouvera la trace dans la symbolique républicaine. « La Vierge Humanité, choisie par Comte pour figurer l’utopie, entre Marianne et Marie, héritage chrétien et espoir révolutionnaire, est donc lisible dans un contexte historique (1848, le début du Second Empire). Elle sera à la base d’une future allégorie de la République » [12]
Entre spiritualité, effet de la providence et maternité, les femmes du XIXe siècle acquièrent une identité profondément instable. Les contours sont mal définis, toujours aux confins d’une réalité historique qui leur échappe. La tension se lit dans les journaux intimes, nombreux en ce siècle ou la parole publique des femmes n’est guère admise. Par un effet curieux de passage entre fiction et réalité, de l’histoire à son écriture, les héroïnes romanesques apparaissent parfois plus ancrées dans le réel. Personnages vrais dans le récit, elles semblent s’éloigner de la fiction transmise par les représentations normatives. Dans Une Ténébreuse affaire, Laurence, par exemple, l’héroïne de Balzac, incarne « la femme libre », chère aux saint-simoniennes dans le concret de leur vie quotidienne. Le narrateur considère alors l’aîné des Hauteserre (personnage historique s’il en est) comme le prototype du conservateur d’Ancien Régime « Il appartient à cette secte d’hommes qui considèrent la femme comme dépendante de l’homme, en restreignant au physique son droit de maternité, lui voulant beaucoup de perfections et ne lui en tenant aucun compte. Selon eux, admettre la femme dans la société, dans la politique, dans la famille est un bouleversement social. Nous sommes aujourd’hui si loin de cette vieille opinion des peuples primitifs, que presque toutes les femmes, même celles qui ne veulent pas de la liberté funeste offerte par les nouvelles sectes pourront s’en choquer » [13]. De même Balzac ne peut respecter ses propres engagements dans la mise en scène des prescriptions morales infligées à Mme de Morsault. L’amour l’emporte sur le sacré quand les passions humaines débordent les résolutions de celle qui incarne Le Lys dans la Vallée [14]. Le sacrifice de soi ne peut être réalisé que beaucoup plus tard par Thérèse de Lisieux qui, mieux que personne, concrétise « l’idéal ascétique » mis en pièce par Nietzsche [15].
Si le roman est la vie où chercher le sujet dans l’histoire des vies assujetties au genre si difficile à identifier tant il s’inscrit dans le comportement individuel ? On comprend alors l’interrogation de George Sand après l’échec de la Révolution de 1848 :
« J’admets physiologiquement que le caractère a un sexe comme le corps, mais non pas l’intelligence (…) Quant à vous, femmes, qui prétendez débuter par l’exercice des droits politiques, permettez-moi de vous dire encore que vous vous amuser à un enfantillage. Votre maison brûle, votre foyer domestique est en péril et vous voulez vous exposer aux railleries et aux affronts publics quand il s’agirait de défendre votre intérieur et d’y relever vos pénates outragés ? Quel bizarre caprice vous pousse aux luttes parlementaires, vous qui ne pouvez pas seulement y apporter l’exercice de votre indépendance personnelle ? Quoi, votre mari siégera sur un banc, votre amant peut être sur cet autre, et vous prétendez représenter quelque chose quand vous n’ètes pas seulement la représentation de vous-mêmes ». Nous lisons là un mélange de lucidité critique et de réalisme social, en vertu du rapport de forces si peu favorable aux femmes de 1848 qui souhaitaient accéder à l’universel suffrage au nom de la vérité des mots.
Au terme de cette rapide esquisse, peut-on se demander si le féminin a une existence réelle hors des attributs qui le façonnent dans l’exercice d’un pouvoir social ? Quant aux valeurs féminines, leurs énonciations répétitives prouvent, à l’envi, l’instrumentalisation dont elles son l’objet. L’extension de la représentation citoyenne à l’ensemble du corps électoral masculin correspond à la formalisation toujours plus précise d’un féminin dont la fonction est pensée par essence hors du politique. Le genre socialement construit a eu pour conséquence historique l’effectivité d’un genre féminin déterminé par sa dimension biologique. L’absurdité dénoncée par Schlegel a si bien réussi que les quelques pensées critiques à l’encontre de ce féminin si singulièrement restrictif sont restées inintelligibles avant que d’être irrecevables par absence de toute représentativité d’une catégorie identifiée d’abord par son appartenance à un groupe sexué.
« Si l’être humain est libre par le seul fait de son existence (…), quelle raison alléguer pour exclure la femme du droit inhérent à tout individu de l’espèce humaine ? L’utilité ? – (…) Contre le droit, elle n’a pas même d’existence. L’utilité, dans l’ordre ancien, fut une mystification énorme ; ce n’est autre chose que l’arbitraire, et nous retombons dans ce non-sens qui sacrifie l’individu à la société, l’être à l’abstraction. (…) » [16] André Léo 1869.
Michèle Riot-Sarcey (Université de Paris)
Communication, colloque sur le genre, Université de Rennes, septembre-octobre 2002
Pour citer cet article :
Michèle Riot-Sarcey , « Le féminin, un genre très singulier », Fédération de recherche sur le genre RING, 16 janvier 2011. URL : http://www2.univ-paris8.fr/RING/spip.php?article1084
Notes
[1] Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, 2, Paris Tel Gallimard, 1974, p. 69.
[2] André Léo, La Femme et les mœurs, monarchie ou liberté, Paris, 1869, Editions du Lerot, Tusson, 1990, p.37.
[3] Thomas Laqueur, La Fabrique du sexe, Essai sur le corps et le genre en Occident, Paris, Gallimard, 1990, p..221.
[4] « De la dernière séance de l’Académie des sciences morales et politiques et du discours de M. Mignet » (4 juillet 1853). Causeries du lundi, VIII, pp. 297, cité par Wolf Lepenies, Paris, Gallimard, 2002, p 258.
[5] Le Départ, Œuvres diverses, ed. Conrad, tII, p. 466, cité par Nicole Mozet, « Temps historique et écriture romanesque », Année Balzacienne, 1990, p.290.
[6] Voir à ce propos, Histoire du Christianisme, sous la direction de Jean-Marie Mayeur, et al, particulièrement vol. 10, Les Défis de la Modernité, (1750-1840), Paris Desclée, 1997.
[7] G.W.F. Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, Traduction de Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Aubier, 1991, p.310.
[8] Je remercie Yannick Seïté pour les précisions qu’il a bien voulu me donner sur sa lecture de Rousseau.
[9] Friedrich Schlegel, Fragments de l’Athenaeum, cité par Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nançy, L’Absolu littéraire, Paris Seuil, 1978, p.169.
[10] François Guizot, De la Souveraineté, 1826-1837, Histoire de la civilisation en Europe, présenté par Pierre Rosanvallon, Hachette, Pluriel, 1985, p. 284.
[11] La Démocratie en Amérique, tome II, 1840, Paris, Gallimard, 1961, p. 293.
[12] Juliette Grange, notice, Auguste Comte, Dictionnaire des Utopies, dir. Michèle Riot-Sarcey, Thomas Bouchet, Antoine Picon, Paris, Larousse, 2002, p. 59.
[13] Honoré de Balzac, Une Ténébreuse affaire, préface René Guise, Paris, folio classique, 1973, p. 136.
[14] Il ne s’agit là que d’incise dans La Comédie Humaine, dont les personnages ressemblent, pour l’essentiel, aux représentations ordinaires des fonctions féminines, mais ces incises me paraissent révéler les dysfonctionnements des normes/valeurs.
[15] Voir, La Généalogie de la morale, 1887.
[16] André Léo, op. cit. p. 118, citée par Alice Primi, 3e Colloque International de des Recherches Féministes Francophones, Ruptures, Résistances et Utopies, Toulouse, 17-22 septembre 2002.
Fichiers de syndication :
Statistiques :
Le site contient 4383 articles