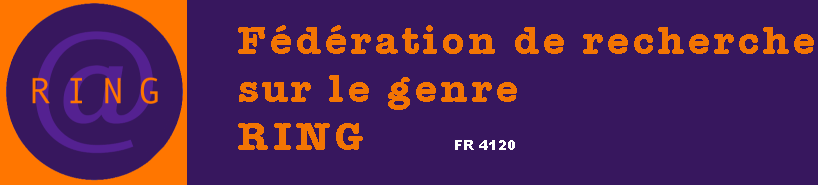Autres mots-clés :
anti-féminisme
-

Ripostes catholiques : mobilisations conservatrices autour d’enjeux sexuels et reproductifs
Avant le 15 octobre - Lausanne
Outre-Atlantique, les mobilisations religieuses dans le champ politique sont bien connues. Aux Etats-Unis où le Tea Party et les autres droites chrétiennes ont désormais un poids sur le parti Républicain, le rôle des organisations confessionnelles dans l’activité politique n’a jamais cessé d’être l’objet de recherches académiques (Williamson & Skocpol, 2012). Toutefois, la mise sur l’agenda scientifique de ces formes d’engagement a été beaucoup plus tardive en Europe et notamment en France. Bien connues sous la Troisième République, période de consolidation de l’Etat-nation sur des fondements laïcs, ces mobilisations ont progressivement été délaissées (Portier, 1998 ; Déloye, 2006).
lire la suite
-

Injures sexistes et LGBTphobes
14 novembre - Angers
Journée d’étude organisée dans le cadre du projet GEDI – Genre et discriminations sexistes et homophobes
lire la suite
-

Francis Dupuis-Déri, "La ’crise de la masculinité’ comme discours antiféministe"
21 mars - Bordeaux 2
Intervention dans le cadre de l’’atelier genre de l’axe identification organisé par Fanny Bugnon, post-doc au Centre Emile Durkheim et par Clément Arambourou, doctorant au Centre emile Durkheim. du Centre Emile Durkheim
lire la suite
-
Béatrice Fracchiolla, "Violence verbale dans le discours des mouvements antagonistes : le cas de ‘Mariage pour tous’ et ‘Manif pour tous’", Argumentation & analyse du discours
-
D. Lamoureux, F. Dupuis-Déri (dir.), Les antiféminismes. Analyse d’un discours réactionnaire
À chaque mouvement de libération, sa réplique contre-révolutionnaire : c’est ce que nous enseigne l’histoire. Les luttes féministes n’y font pas exception. Décrié à droite comme un réel péril pour la stabilité sociale et l’avenir de la nation, à gauche comme une lutte secondaire à inscrire dans un bien plus vaste programme, le féminisme a toujours dérangé ceux qui trouvent intérêt à préserver le régime patriarcal.
lire la suite
-

Appel à manuscrits
Lancement de la collection Observatoire de l’antiféminisme, aux Éditions du remue-ménage
Les Éditions du remue-ménage sont heureuses de vous annoncer le lancement de sa collection Observatoire de l’antiféminisme qui, comme son nom l’indique, proposera des livres — monographies et ouvrages collectifs — qui traitent de l’antiféminisme.
lire la suite
-
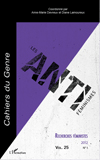
Revue
Cahiers du Genre, "Les antiféminismes"
Illustrant la dynamique des relations entre pays produisant des travaux féministes, ce numéro élaboré conjointement avec la revue québécoise Recherches féministes montre la variété des champs d’action des antiféministes et leurs stratégies pour tenter de faire taire les voix multiples des féminismes, en France et au Québec mais aussi au Vatican, au Mexique ou à Madagascar.
lire la suite
-
Misogynie et discriminations sexuelles
24-26 septembre - Pau
La discrimination des femmes constitue un phénomène universel, nécessitant une approche globale. Son fondement réside dans la misogynie, un sentiment non moins universel, mais que la langue et l’opinion commune minimisent.
lire la suite
-

Revues
Cahiers du Genre et Recherches féministes, "Les antiféminismes"
-
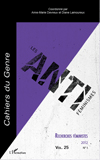
Journée d’études
Les antiféminismes : regards croisés France/Québec/Madagascar/Mexique
16 novembre - Paris Pouchet
A l’occasion de la parution du n°52 / 2012 de la revue Les Cahiers du genre coordonné par Anne-Marie Devreux et Diane Lamoureux
lire la suite
0 | 10
Fichiers de syndication :
Statistiques :
Le site contient 4383 articles