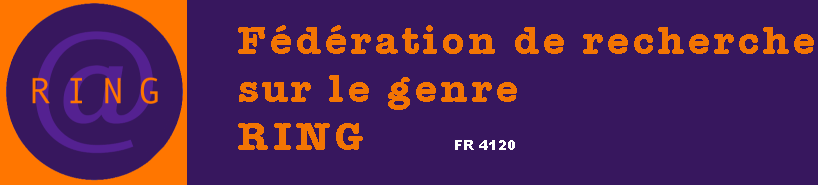Autres mots-clés :
égalité
-

Colloque
Égalité entre les femmes et les hommes : territoires et décentralisation
6 décembre - Binic (Côtes d’Armor)
Que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, l’inégalité entre les femmes semble être la norme, l’égalité l’exception.
En effet, que cela est sensible dans les différents pans de la société : dans la répartition des tâches domestiques, dans l’accès à l’emploi, le chômage, le temps partiel, les inégalités de salaire, la pauvreté, la représentation des femmes dans les instances politiques nationales et locales, dans les fédérations et conseils d’administration, l’accès aux classes préparatoires, etc.
lire la suite
-
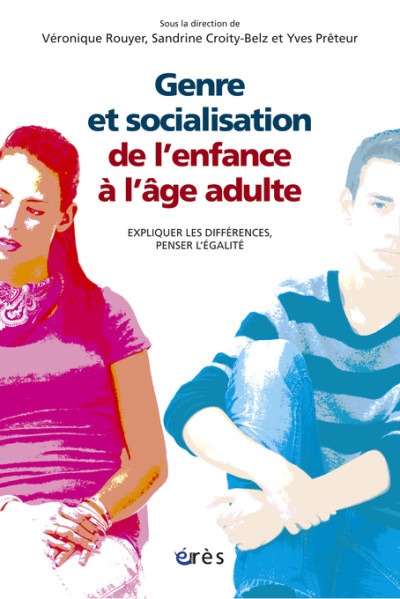
Livre
Véronique Rouyer, Sandrine Croity-Belz et Yves Prêteur, Genre et socialisation de l’enfance à l’âge adulte. Expliquer les différences, penser l’égalité
Si le terme sexe (sex) renvoie aux aspects biologiques et le genre
(gender) aux aspects socioculturels, l’identité sexuée peut être définie
comme le sentiment d’appartenir à un sexe. Le sujet va élaborer tout au
long de son développement un rapport singulier au genre.
lire la suite
-

Table-ronde
Femmes-hommes : penser l’égalité
13 janvier - Paris
En ce début de XXIe siècle, la France est un pays de contrastes, voire de contradictions, en ce qui concerne la question de la mise en œuvre du principe, constitutionnel depuis 1946, d’égalité des femmes et des hommes devant la loi. C’est ainsi que 2012 est à la fois l’année de la constitution du premier gouvernement paritaire et des débats sur l’abrogation par le Conseil constitutionnel de l’article 222-33 du Code pénal définissant le harcèlement sexuel.
lire la suite
-

Rachel Silvera, Un quart en moins, des femmes se battent pour en finir avec les inégalités de salaires
Malgré les lois, discours et autres chartes, en France, le salaire des femmes reste inférieur d’un quart à celui des hommes. Comment expliquer cet écart persistant ? Au XIXe siècle, on considérait qu’il n’était pas vital pour une femme de travailler. Pouvant compter sur « monsieur Gagnepain », celle-ci ne pouvait prétendre qu’à un « salaire d’appoint ». De manière insidieuse, ce modèle pèse encore aujourd’hui. Les salariées semblent piégées, entre « plancher collant » et « plafond de verre ».
lire la suite
-
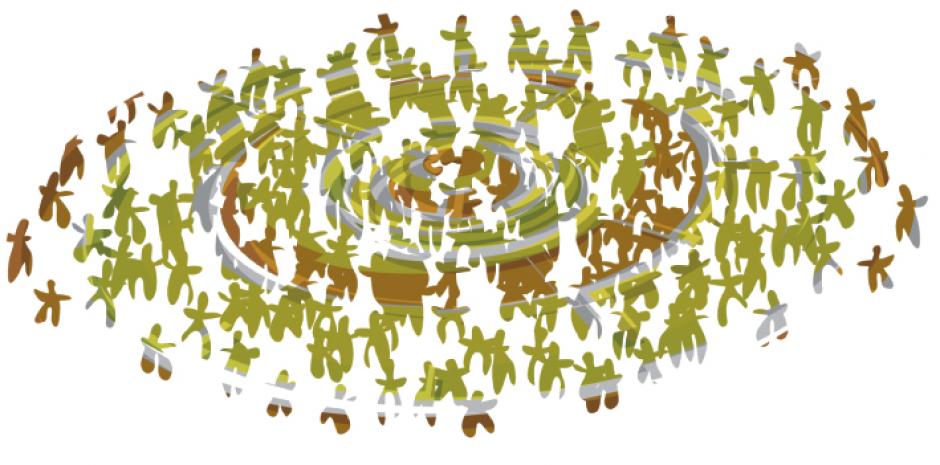
Appel à contributions
La globalisation à l’aune du genre : vers une sociologie politique de la promotion internationale des normes égalitaires
Avant le 15 octobre - Congrès AFSP
De la « Décennie de la femme » après la conférence internationale de Mexico (1975), aux politiques de « gender mainstreaming » à la suite de la conférence de Pékin (1995), les luttes féministes ont connu une légitimation croissante sur la scène internationale.
lire la suite
-

Livre
François Poulain de la Barre, De l’égalité des deux sexes. De l’éducation des dames. De l’excellence des hommes
François Poulain de la Barre (1647-1723) est peut-être le plus grand penseur moderne de l’égalité entre les sexes.
lire la suite
-
La professionnalisation des luttes pour l’égalité de genre et les effets de la crise. Enjeux théoriques et politiques
10-11 avril - Liège
Section thématique du Groupe Genre et Politique du 6ème Congrès triennal de l’Association belge francophone de science politique
lire la suite
-
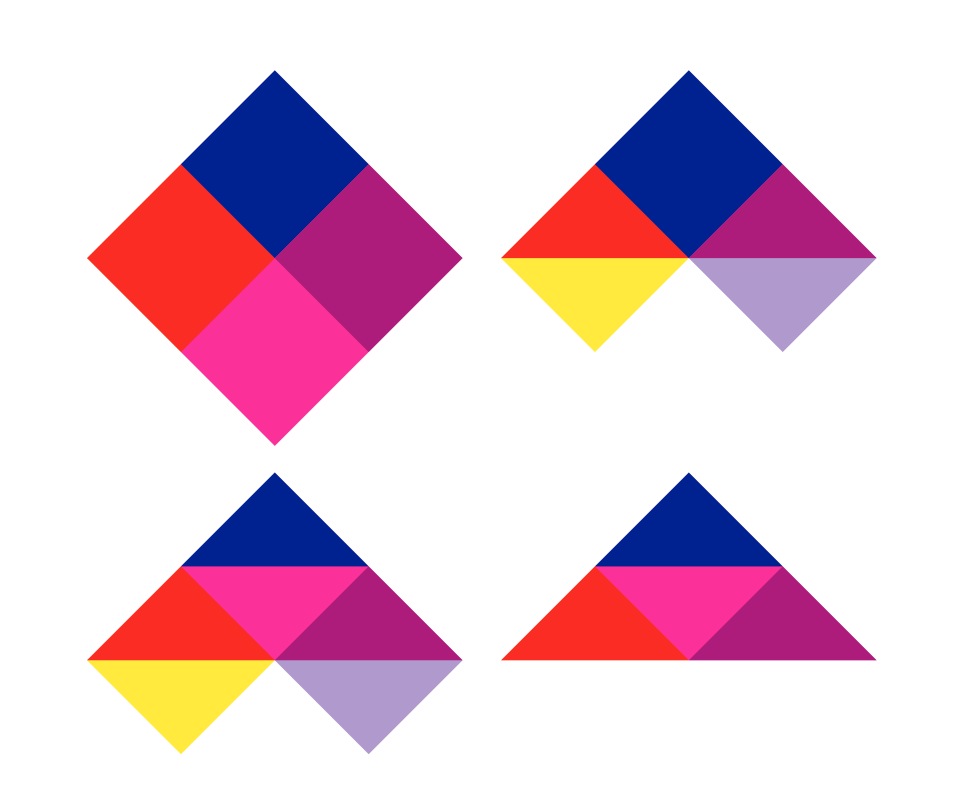
Egalité de genre : vers un dialogue renforcé
16 octobre - Bruxelles
Journée d’études organisée par Amazone en collaboration avec Sophia, le réseau belge des études de genre, modéré par Nadine Plateau (Sophia, présidente de la Commission Enseignement du CFFB).
lire la suite
-
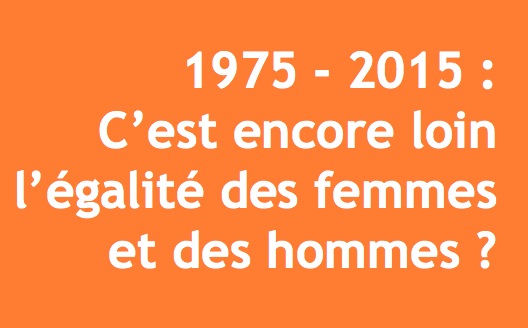
1975 - 2015 : C’est encore loin l’égalité des femmes et des hommes ?
16 décembre - Paris
En 1975, débutait la décennie des Nations Unies pour les droits des femmes. En 1979, la Convention pour l’élimination de toutes formes de discrimination envers les femmes (CEDEF/CEDAW) définissait un cadre international puissant pour les droits des femmes. En 1995, à l’issue de la IVème Conférence mondiale des femmes, la Plateforme de Pékin identifiait 12 domaines critiques, et prônait la transformation des organisations et des mécanismes institutionnels, ainsi qu’une combinatoire entre l’approche transversale (mainstreaming) et les projets spécifiques pour l’autonomisation des femmes.
lire la suite
-

Jacqueline Laufer, L’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’égalité professionnelle figure désormais en bonne place sur l’agenda politique de la France comme des pays de l’Union européenne ainsi que sur celui des entreprises et des partenaires sociaux. Pourtant, sa mise en oeuvre demeure très largement incomplète.
lire la suite
Fichiers de syndication :
Statistiques :
Le site contient 4383 articles