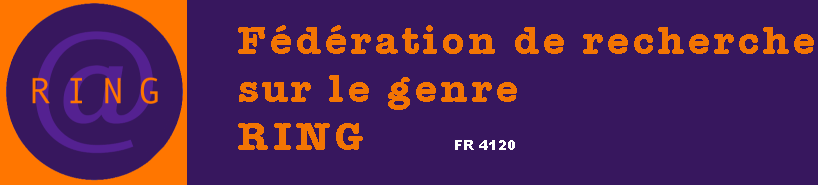Autres mots-clés :
- développement
- déviance
- domination
- droit
- écologie
- économie
- éducation
- égalité
- en une
- enfance
- enseignement
- entreprise
- environnement
- érotisme
- Espagne
- Etats-Unis
- ethnographie
- études féminines
- Europe
- Europe de l’est
- famille
- féminin
- féminisme
- fétichisme
- Foucault
- frontière
- gender
- géographie
- géopolitique
- Grande-Bretagne
texte
-
Le chromosome du crime, à propos de XY
Michèle Le Doeuff
Un compte rendu du dernier livre d’E. Badinter, XY, s’impose-t-il ? La meilleure conduite à tenir serait de l’ignorer, comme tant d’autres livraisons « si célèbres l’année dernière », et de développer une résistance vis-à-vis de ce que certains éditeurs parisiens appellent eux-mêmes « notre littérature kleenex ». Le genre se définit par le fait que le « produit » (sic, dans n’importe quel « mastère » d’édition) doit être capable de faire rage sur le marché pendant trois mois environ. Ceci implique qu’il soit construit autour d’une idée-choc et que cette thèse à sensation puisse être résumée en une petite page ou trois minutes de radio. La rédaction de l’ouvrage doit être assez aérée pour que les journalistes littéraires puissent en prendre connaissance en moins de deux jours, le moindre retard gâchant le feu d’artifice.
lire la suite
-
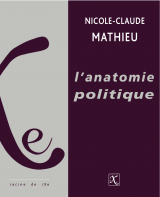
Sur « L’anatomie politique, catégorisation et idéologie du sexe » de Nicole-Claude Mathieu
Denis Berger
A la lecture de ce livre, on éprouve de la gêne. Ce sentiment ne naît pas du contenu de l’ouvrage. Bien au contraire, c’est le silence observé à propos d’un travail d’une telle qualité qui suscite le malaise. Inspirée par une critique féministe radicale – elle-même fortifiée par le combat des mouvements de femmes – Nicole-Claude Mathieu fait oeuvre d’épistémologie. L’essentiel de ses démonstrations tend à prouver que les différences de sexe sont socialement organisées pour maintenir la minorisation et l’exclusion des femmes.
lire la suite
-
Nicole-Claude Mathieu ou l’espoir d’une transmission muliéri-linéaire et plurilocale
Jules Falquet
Nicole-Claude Mathieu vient de nous quitter le 9 mars 2014. Une théoricienne fondamentale disparaît, et avec elle une militante décidée et une pédagogue généreuse. Mais Nicole-Claude Mathieu n’est pas morte : sa jument noire caracole encore parmi nous. Sa jument noire ? Plus exactement, elle nous laisse toute une manade sauvage, qui emporte nos pensés et leur donne de l’audace depuis plus de quarante ans. Ces fières créatures sont avant tout le produit d’un mouvement, de luttes et de réflexions portées par des femmes très variées dans le monde entier, non-occidental et occidental comme elle insistait pour l’écrire. Dans cet élan collectif et multiple, Mathieu a posé noir sur blanc, texte après texte, un certain nombre de propositions fortes.
lire la suite
-
Gender - ein epistemisches Ding / Gender - une « chose » épistémique
Astrid Deuber-Mankowsky, Université de Bochum, Allemagne
La problématisation du genre et de sa relation avec les sciences de l’homme d’un côté, les sciences exactes de l’autre ; le lien entre sexe et genre, l’élucidation de l’historicité de cette différenciation ; les recherches sur l’intersexualité, la transsexualité et sur leurs interactions avec les technologies médicales ou l’histoire de l’endocrinologie ; les changements des relations des sexes/genres et des relations familiales à travers les technologies de procréation : toutes ces thématiques ont été focalisées pendant les dernières années par les gender studies. A travers les thématiques en question ces études sont devenues une « tentative » pour les étudiants qui constitue, pour citer Michel Foucault, une mise à l’épreuve changeante d’eux-mêmes. Le sexe/genre (Geschlecht) devient une chose épistémique, un objet du savoir, le savoir devenant un objet de désir et la connaissance un exercice de soi-même.
lire la suite
-
Féminin/masculin versus Histoire sociale dans l’Université espagnole
Ana Iriarte, Universidad del País Vasco, Espagne
Au mois de juin 2005, à Madrid, l’Association de Recherches en Histoire des Femmes a organisé un séminaire, sur l’oeuvre de Joan Scott. Notamment, sur l’influence du concept de gender dans l’historiographie féministe espagnole. Concept que l’historienne américaine a défini en 1986, avec l’énorme succès dans la discipline historique qu’on connaît toutes.
La participation enthousiaste de Joan Scott à ce séminaire nous a beaucoup appris et éclairé à propos du devenir des études de gender des deux dernières décennies ainsi que des préoccupations actuelles de l’historienne américaine, concentrée sur la tension qu’elle perçoit entre l’universel garantissant, depuis la Révolution de 1789, l’égalité de tous devant la loi et la moderne conception de la différence des sexes. Or, malgré ses effets enrichissants, la visite de Joan Scott n’a fait que dévoiler la réticence des études féministes espagnoles à assimiler la catégorie de gender dans le double sens que lui prêta cette théoricienne. Plus précisément, les études espagnoles sur les femmes n’ont pas manqué d’adopter l’usage, déjà universel, du terme gender, mais, cet emploi est loin d’impliquer la prise de position sur l’inégalité ou le pouvoir qui a fait de cette catégorie d’analyse un outil vraiment novateur pour les études féministes.
lire la suite
-
A propos d’un concept ou les difficultés du genre en France
Michèle Riot-Sarcey
Tout a été dit ou presque sur les relations conflictuelles entre l’analyse historique fondée sur le genre et l’écriture de l’histoire sociale, politique ou économique. Dans tous les pays, les historiennes, particulièrement, se plaignent de la faible intégration des femmes dans l’Histoire, au sens global du terme.
Le mode de penser l’histoire en France est cependant assez spécifique, si l’on en juge par le rapport tendu de ses historiens avec la question du genre.
lire la suite
-
L’usage du genre au Portugal : en tant que catégorie analytique ou descriptif ?
Virgínia Ferreira, Université de Coimbra (Portugal)
La difficulté de conceptualiser les femmes, comme collectif social, par la Sociologie et d’autres sciences sociales, aussi bien que les problèmes suscités par le concept de " gender " sont présents dans l’oeuvre de beaucoup d’auteurs, femmes et hommes, qui, au Portugal, ont effectué des recherches dans ce domaine. Voyons quelques exemples, entre celles et ceux qui me semblent plus significatives/significatifs.
lire la suite
-
De l’histoire politique et des pouvoirs
Michèle Riot-Sarcey
S’il nous fallait rendre compte des discours d’exclusion des femmes de la cité, cet article n’y suffirait pas ; bien d’autres avant moi ont analysé ces discours, sans cependant infléchir l’écriture de l’histoire politique vers la critique des relations de pouvoir où s’inscrit le devenir historique des femmes. Du point de vue du mode de penser le politique, nous sommes toujours ou presque assignées à « la loi » énoncée par Auguste Comte :
« C’est ainsi que dans toutes sociétés humaines, la vie publique appartient aux hommes et l’existence des femmes est essentiellement domestique. Loin d’effacer cette diversité naturelle, la civilisation la développe sans cesse, en la perfectionnant. »
lire la suite
-
Entretien avec Michèle Perrot
Christine Planté
-
Féminisme, modernité, postmodernisme : pour un dialogue des deux cotés de l’océan
Eleni Varikas
Si, dans ses versions dominantes, la réflexion féministe a historiquement montré un attachement pathétique au projet de la modernité, cette passion - malheureuse car trop souvent à sens unique - est en train de s’affaiblir quand elle ne se tourne pas purement et simplement en son contraire. Pour ne pas avoir rempli ses promesses émancipatrices, la modernité devient l’objet d’une interrogation qui tend à déstabiliser quelques-unes des certitudes les mieux installées de notre tradition de l’Aufklärung, cette même tradition qui a vu naître la demande de l’émancipation des femmes.
lire la suite
Fichiers de syndication :
Statistiques :
Le site contient 4383 articles