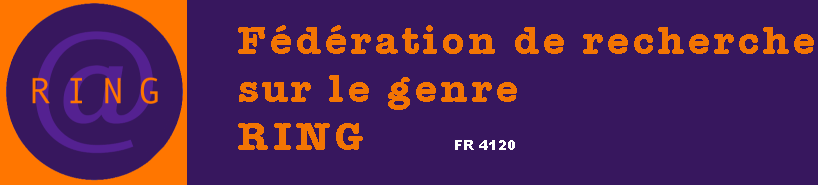Texte paru dans la revue Futur Antérieur, numéro spécial "Féminismes au présent", avril 1993.
Télécharger ce(s) document(s) :
Un compte rendu du dernier livre d’E. Badinter, XY, s’impose-t-il ? La meilleure conduite à tenir serait de l’ignorer, comme tant d’autres livraisons « si célèbres l’année dernière », et de développer une résistance vis-à-vis de ce que certains éditeurs parisiens appellent eux-mêmes « notre littérature kleenex ». Le genre se définit par le fait que le « produit » (sic, dans n’importe quel « mastère » d’édition) doit être capable de faire rage sur le marché pendant trois mois environ. Ceci implique qu’il soit construit autour d’une idée-choc et que cette thèse à sensation puisse être résumée en une petite page ou trois minutes de radio. La rédaction de l’ouvrage doit être assez aérée pour que les journalistes littéraires puissent en prendre connaissance en moins de deux jours, le moindre retard gâchant le feu d’artifice. Et il est essentiel, d’abord, que les attaché-(es) de presse n’aient pas l’impression qu’on les snobe. Cela étant acquis, peu importe que les critiques ensuite célèbrent ou éreintent. La règle d’or a été établie outre-Atlantique : any press is good press, l’essentiel est qu’on en parle, qu’on accorde au livre un grand espace de visibilité et qu’il soit constitué en événement. Dès l’instant que tout quidam, et toute quédame, se sent tenu(e) d’avoir son opinion sur la chose, le tour est joué, l’ouvrage occupe le devant de la scène et, qu’il soit constitué par la critique en bon ou en mauvais objet, il sera dans les Maisons de la Presse. Tenez, Josyane Savigneau a consacré presque une page du Monde des Livres à un éreintage en bonne et due forme (une page quasi entière pour dire que c’est mauvais ?), et voilà qu’à mon tour je cède à d’amicales pressions, comme on dit.
Quand bien même l’ouvrage dont on ne peut pas ne pas parler serait trop confus ou trop mal argumenté pour pouvoir prétendre produire le moindre effet intellectuel, il a toujours au moins un effet concret, qui est fâcheux : il marginalise des livres qui, eux, auraient pu proprement ouvrir ou prolonger un débat. La seule tactique efficace contre la littérature kleenex consisterait dès lors à retourner la situation, et à noter simplement la publication de - par exemple - XY, pour enchaîner au plus vite sur (par exemple aussi) un compte rendu du livre de Colette Guillaumin, Sexe, Race et Pratique du pouvoir, paru juste avant l’été aux éditions Côté-Femmes, en le rapprochant éventuellement de celui de Nicole-Claude Mathieu, L’Anatomie Politique, et en signalant aussi un volume collectif paru aux Presses Universitaires de Lyon, Des Hommes et du masculin. Ces ouvrages suscitent la réflexion et l’on peut en discuter, ce qui est excellent. De plus, ils s’adressent à des lectrices et lecteurs de livres, une espèce en voie de disparition. Gilles Deleuze a noté naguère que les livres des « nouveaux philosophes » n’étaient pas faits pour être lus, mais pour servir de supports et de prétextes à des articles d’opinion écrits à propos d’eux. On se souvient du titre du New York Times, « les philosophes français déclarent que le marxisme est monstrueux » : l’effet « nouveaux philosophes » fut foncièrement de réactiver l’image de l’homme au couteau entre les dents. C’est une honte d’avoir mêlé le nom de la philosophie à cela, mais qu’y faire ? J. Savigneau note quelque chose du même ordre à propos de XY (« acheter ce livre et ne pas le lire »). Mais il n’est pas nécessaire que le livre soit lu pour qu’un message pervers passe au choix, « les féministes sont tombées bien bas, le bouquin de Badinter, Seigneur ! », ou « Eh eh, les féministes ont compris qu’elles étaient allées trop loin, et sainte Élisabeth prie déjà pour nous » - à tous les coups, nous perdons. De plus, la visibilité accordée à XY (même ici) joue au détriment d’autres livres. C’est donc cela d’abord qu’il faudrait interroger. Mais pourquoi ne parvenons-nous pas à mettre sur pied une stratégie défendant positivement les livres faits pour être lus ? Nous laissons ainsi tous les livres réfléchis ou intellectuellement exigeants glisser vers la littérature grise. Peut-être est-il déjà trop tard, car déjà, quand on imagine une presse littéraire qui parlerait seulement de livres à lire, on subodore qu’elle irait au suicide, du moins en France.
J’ai failli caler à la première phrase : « XY est la formule chromosomique de l’homme - appel de note - », et la note en question dit : « XX est celle de la femme. » « L’homme » dans le corps du texte, « la femme » en note - ah bon, et à qui donc s’adresse ce livre ? A un public qui ne serait pas assez informé pour ne pas avoir appris à l’école cette grande banalité, mais qui aurait besoin de l’apprendre, et d’entendre un discours prétendument savant sur la dualité des sexes ? Dans les pages que j’ai lues (un tiers du livre, et vous n’allez pas m’en demander davantage), la combinaison de la dramatisation naïve et du mode pédant structure le propos. Il y a du « douloureux », de la « véritable mutilation » et du « piège mortel » dans tous les coins, mais le moindre énoncé sur « la pensée occidentale » (sic) quant à la dualité des sexes est étayé par une référence à quelque « brillant ouvrage de l’Américain » Untel. Le tout est écrit comme une laborieuse dissertation.
Vous l’aurez lu dans la presse : le thème de l’ouvrage, c’est que les hommes sont de pauvres mignons, fragiles, handicapés et désavantagés par rapport aux femmes ; telle est la raison pour laquelle ils ont besoin d’opprimer celles-ci, et le patriarcat n’a été inventé que comme palliatif, dit la dernière page. Mais si le livre m’est tombé des mains, ce n’est pas seulement parce que j’avais déjà lu des choses comme celles-là quelque part [1], ni à cause du caractère hallucinant de la sollicitude dont l’auteur fait ainsi preuve vis-à-vis des fantasmes mâles, mais en raison d’abord d’une allergie au pathos facile : les romanciers « disent avec des mots simples leur désarroi ». Misère ! En voilà un demi-cliché, dont la forme complète est, permettez-moi de vous le rappeler, « avec des mots simples et forts ». On ne peut pas me demander non plus de lire des énoncés du type : « La Française n’a jamais tout à fait rompu... », « Contrairement à leurs sueurs méditerranéennes, la Française et l’Anglaise... », et encore moins : « La blanche affirmait que... Mais la noire n’était pas d’accord. » Parler ainsi des personnes, c’est s’installer d’emblée dans un mythe taxonomique peu respectueux desdites personnes, pour dire le moins. Sociologiquement parlant, un tel style classe, et du côté du mauvais goût bourgeois. On aurait tort de penser qu’il s’agit d’un livre écrit pour une audience un peu peuple, par une grande bourgeoise qui s’est efforcée de se mettre à la portée d’un « grand public » qu’elle imagine à sa façon. Il est bon de se souvenir de la définition de l’art populaire donnée par Proust : s’il s’agit d’un art facile, qui sacrifie les raffinements de la forme, alors c’est « destiné plutôt aux membres du Jockey qu’à ceux de la Confédération Générale du Travail », car, dit-il, « ... j’ai assez fréquenté les gens du monde pour savoir que ce sont eux les véritables illettrés, et non les ouvriers électriciens. »
« Ce livre est le résultat de six séminaires tenus à l’École Polytechnique. » Il y a bien plus de XY que de XX à l’X (E. Badinter n’évoque d’ailleurs nullement une présence d’étudiantes à ses cours), et l’on y forme notamment des individus connus ensuite sous l’abréviation « X-Mines », des Polytechniciens qui, à l’issue de leur scolarité, trouvent à l’École des Mines une école d’application. Le corps des X-Mines est une des grosses pépinières de « décideurs » du pays, dans les sphères étatiques comme dans le secteur privé. Peut-être la meilleure carte d’identité chromosomique connue dans l’hexagone est-elle celle-là, qu’il faudrait écrire X(Y)-Mines. Dans certains ministères, il est encore mieux porté de sortir de Polytechnique que de l’E.N.A. Lorsque vous râlez contre l’incurie des pouvoirs publics quant à des questions qui vous importent (pilules non remboursées, droits reconnus par loi Veil mais déniés par des hôpitaux...) ou contre l’immobilisme du gouvernement face à des problèmes du même type, ou d’un autre, vous savez bien que, derrière le ministre nominalement responsable, il y a une petite cohorte de grands commis, Énarques, X(Y)-Mines, etc., qui n’ont pas préparé convenablement le dossier ou qui n’ont rien compris au mémorandum envoyé par une association compétente. Si c’est à eux, et globalement aux hommes de moyen pouvoir, que ce livre est dédié, voilà qui ne nous promet pas des jours meilleurs.
Pour avaler des à peu près aussi approximatifs que celui-ci : « Ce sont les Précieuses qui furent à l’origine de la première remise en question du rôle des hommes et de l’identité masculine », ou pour croire que, si des biologistes disent ce qui leur passe par la tête quant à la destinée humaine, c’est forcément du sérieux, du solide, du scientifique, il faut un profil intellectuel un peu particulier, celui de qui cherche à acquérir, vite fait et sans se montrer trop difficile, un brin de culture d’emprunt et d’appoint, hâtivement estampillée par l’autorité d’une expertise assez mal définie. Mais cette fausse culture n’est pas ciblée n’importe comment et, qu’on lise le livre ou non, il est l’occasion de mettre en circulation des opinions qui deviendront cadres a priori de la perception : pour les femmes, ça va ; pour les hommes, ça ne va pas ou plus, et d’ailleurs ça a toujours été glorieusement dramatique. D’un côté, quiconque se rêve comme wonder boy entend à plein des remarques comme celle-ci : « La moindre défaillance testiculaire met le foetus en danger d’être plus ou moins féminisé » ; de l’autre, nos interlocuteurs étatiques ou nos employeurs vont pouvoir faire la sourde oreille mieux que jamais, quand nous dirons que, justement pour les femmes, ça ne va pas, en raison de données concrètes que l’on peut décrire, et que ça pourrait aller mieux si certaines mesures étaient prises.
« Je me suis parfois sentie coupable [dans les séminaires donnés à l’X] de mettre en question les critères traditionnels de la masculinité sans pouvoir en proposer d’autres. » Ce sentiment de culpabilité si bien venu trouve un aboutissement dans des actes de réconfort (« que les hommes se rassurent » pp. 24-25), de tendresse (voyez la dernière phrase du livre) et de compréhension. Les bénéficiaires pourront parodier Feydeau : « Ah ! ce dont j’ai toujours rêvé, une femme qui me comprisse ! » A eux, E. Badinter dit : la masculinité est aujourd’hui en crise, parce que les femmes ont contesté l’idée de supériorité masculine. Certes, il n’est pas nécessaire d’être polytechnicien pour trouver un bénéfice de plaisir à l’idée qu’une femme compatit, reconnaît que les féministes des années 70 ont semé la pagaille et veut prendre en charge la crise. Mais une conclusion pratique se dessine, à la portée de n’importe quel petit décideur : le changement est allé trop loin, revenons en arrière ou du moins arrêtons le processus, on en a assez subi comme ça. N’est-ce pas au reste la doctrine tacite des pouvoirs exécutif et législatif ces dernières années ? Depuis environ dix ans, on a l’impression que nos gouvernants sont étreints par une sainte trouille d’on ne sait trop quoi, leur ombre peut-être. Tenez, il n’y a pas si longtemps les députés communistes ont proposé de faire passer le délai légal de l’I.V.G. de dix à douze semaines, ce qui arrangerait bien des situations, ce qui alignerait la France sur ses voisins, ce qui enfin n’est jamais qu’une vieille promesse socialiste. Le gouvernement a bloqué l’initiative, en arguant de ce qu’il ne faut pas remettre en cause des « délicats équilibres » [2]. Entre qui et qui, grands dieux, quand on sait qu’environ 90 % de nos compatriotes sont favorables à la liberté et au remboursement de l’I.V.G. ? Si le P.S. cherche à justifier son inaction, il ne pouvait pas trouver mieux que la campagne d’opinion faite autour de ce livre, à six mois d’élections qui risquent de sanctionner diverses légèretés, dont celle-là.
Le livre propose un méli-mélo d’explications historiques (le féminisme ouvre chroniquement une crise affreuse pour les hommes) et d’explications par le biologique (ce pauvre foetus mâle, neuf mois dans un corps de femme !). Mais tout devient plus clair si l’on en explicite la thèse politique sous-jacente : les rapports sociaux de pouvoir ne sont pas une donnée première, et les pouvoirs publics n’ont aucune responsabilité en la matière, c’est foncièrement la psychologie sui generis des XY et des XX qui explique tout. II est facile d’être une femme (si, si, et donc ne venez pas nous raconter des histoires de femmes battues ou de fillettes violées en famille), il est difficile, douloureux, c’est une lutte et un malaise, d’être un mâle, et ce dès l’âge foetal ou depuis avant-hier, comme vous voudrez : quelle que soit l’explication retenue, la question des rapports de pouvoir, y compris étatique, des hommes sur les femmes, tels qu’ils peuvent exister, devient très secondaire. Qu’il y ait 94 % d’hommes à l’Assemblée nationale (qui fait plus ou moins les lois), autant sans doute dans les cabinets ministériels, et je ne sais plus combien au C.N.P.F. [3], voilà un fait qui tout à coup perd de son importance et qu’en outre on peut comprendre : ils ont besoin de ce « palliatif », les pauvres.
Plutôt que de discuter de la médiocre assiette intellectuelle du livre, je crois que c’est sur ce plan qu’il faut en interpréter l’effet. Peu importe que l’auteur semble congédier d’une main la sociobiologie, déclarée bonne pour la Nouvelle Droite et Luce Irigaray seulement, tout en reprenant de l’autre les paradigmes fondamentaux d’une sorte de psychobiologie qui ressemble à la sociobiologie mollement congédiée comme la proverbiale goutte d’eau à une autre, et qui se superpose on ne sait comment à une lecture historique d’une crise réputée actuelle. A mon avis, l’essentiel n’est pas là, mais dans l’importation des gender studies qui constituent une idéologie de même farine que la sociobiologie, mais livrée dans une version libérale. La nuance est mince (l’écart entre un libéralisme bien avancé et la Nouvelle Droite l’est parfois aussi), et tient davantage aux images concrètes qu’on loge dans les alvéoles du cadre théorique qu’à ce cadre lui-même. La sociobiologie va jusqu’à justifier le viol, tandis que l’idéologie libérale s’en tient à des référents supposés plus soft, comme l’apologie de la pornographie (tout fantasme étant supposé sui generis) ou globalement à l’idée de besoins subjectifs endogènes, qui doivent être respectés, même s’ils ont des effets désastreux sur le réel d’autrui.
Retour donc de l’endogène, prologue de XY : « Qu’est-ce qu’un homme ? » Privilégier la question de l’identité se fait toujours au détriment d’une référence à des rapports sociaux iniques ou violents, référence qui, elle, reste liée à une problématique philosophique socialiste, telle qu’on la trouve déjà chez Thomas More. Quand celui-ci dit : « vous fabriquez vous-mêmes les voleurs que vous allez pendre ensuite », il met en cause un ordre social qui affame, et il écarte absolument l’idée d’une identité de la personne qui se constituerait sua sponte. Au contraire, du côté de la préhistoire de la socio(psycho)biologie, vous trouverez des recherches pseudosavantes sur le « criminel né », le chromosome du crime et toute cette sorte de choses. La sociobiologie revient vers les rapports sociaux (de sexe, de classe...) pour les légitimer, en partant d’une construction hormonale ou d’une allégorie génétique d’individus déterminés en eux-mêmes. L’idéologie libérale, elle, tend - seulement ! - à gommer la question des rapports matériels, sociaux, politiques, légaux et institutionnels, et à effacer la responsabilité d’un État qui ne doit pas intervenir, mais elle en vient toujours, de ce fait, à substantialiser les personnes, afin de pouvoir rendre compte malgré tout des phénomènes. Rendant invisibles les mécanismes de pouvoir et décrivant leurs effets comme des faits naturels, elle considère que les divers individus, tels qu’on les observe, sont au fond comme ils avaient diversement à être. Vis-à-vis de l’École, il y a des aptitudes intrinsèques et, dans les attitudes sexuées, c’est aussi et encore de l’intrinsèque qui s’exprime, et/ ou qui devrait pouvoir s’exprimer.
C’est sur ce devoir-être toujours tangent au déjà-là que les gender studies sont construites ° : l’intrinsèque, ce que les hommes ont « en propre » comme ce qui est « spécifique aux femmes », est considéré comme entravé par des choses qui sont (mais là, c’est moi qui parle) des effets de surface ou de représentation : ainsi, le fait que l’homme ait été considéré comme l’être humain universel entraverait ( ?!) sa conscience de soi comme sexuellement spécifié (XY pp. 22-23). Que la recherche de cette spécification sexuelle masculine aboutisse parfois, dans les male studies américaines, à l’apologie d’un « moi sauvage intérieur » proche de l’homme des bois est sûrement un racontar britannique, que j’ai eu tort d’écouter, du moins sans prendre des notes adéquates. Le symétrique, côté women studies, est plus connu : maternité, sensibilité, sollicitude... Quoi qu’il en soit, si l’on en juge seulement par XY, tout file vers de simples problèmes d’identité et vers l’idée de rapports seulement spéculaires entre hommes et femmes. Le psychologique phagocyte le politique, et le tout innocente les mêmes que d’habitude, à savoir les hommes en général et les gestionnaires généralement masculins de la vie collective. Comme toujours, « les Dieux sont innocents », et voilà qu’ils sont fragiles, en plus, donc à ménager.
Il faut prendre ce livre pour ce qu’il est, à savoir un symptôme, et l’on ne peut donc pas l’ignorer. Mais un symptôme de quoi ? Du glissement de la mouvance anciennement socialiste vers un libéralisme flagrant ? On n’avait pas besoin de lui pour s’en rendre compte. Que l’idéologie libérale en matière de relations entre les sexes n’ait jamais cessé d’occuper une position idéologique centrale, c’est vraisemblable aussi. Mais ce qui est le plus symptomatique, c’est que ce travail ait été accompli par une femme qui a pu se dire féministe en d’autres temps, à une époque où c’était peu ou prou acceptable, voire rentable. A vrai dire, je ne sais pas jusqu’où a pu aller son engagement ; il est à craindre que, sur toutes les questions pratiques brûlantes, elle se soit soigneusement abstenue de se mêler à nous. Quand on la présente comme l’une des nôtres, on fait donc injure à celles qui, loin de se servir du féminisme pour se placer, ont donné de leur temps et de leur énergie à des questions concrètes. Vous avez déjà vu Mme Badinter être porte-parole ou porte-plume du Planning Familial ? d’un Collectif contre le viol ? d’une association contre l’excision ? etc. Or les références sûres sont bien de ce côté-là. Dans son article du Monde, Josyane Savigneau oppose « Élisabeth Badinter, une intellectuelle connue, reconnue, féministe s’opposant courageusement à la frénésie des féministes américaines tenantes du mouvement politically correct », avec laquelle, dit-elle, « on a envie d’être d’accord » (vraiment ?), et un livre qu’elle juge à bon droit consternant. Mais où est l’opposition ? Nulle part. Le politically correct est également un effet du libéralisme, mais dans sa tendance pluraliste, et les male studies louées par E. Badinter en font partie ; l’idée fondatrice de ce mouvement, c’est qu’il y a une diversité, des hommes, des femmes, des Noirs, des Natifs américains, des Caucasiens protestants, des Juifs, des nostalgiques de Palerme, et que nul groupe n’est tenu d’en prendre un autre comme référence. En cela, c’est l’équivalent d’une contestation de « nos ancêtres, les Gaulois », dit Christine Delphy. Quand ce mouvement s’en tient là, on ne peut pas ne pas être d’accord, d’autant qu’il a formulé quelques règles de courtoisie qui tombent sous le sens. Mais on peut regretter que toute contestation autrement orientée fasse figure d’incongruité dans les universités américaines et que, pour se prétendre radical, le P. C. embrasse souvent un relativisme sans rivage, au point que dire « à chacun sa vérité », c’est encore trop, donc non correct ! On a dès lors quelques raisons intellectuelles de se détourner de lui. Ce n’est pas cela que fait E. Badinter : elle le pourfend quand il est porté par les femmes des women studies et elle le bénit quand il produit les male studies ! Vous avez dit bizarre ! Non, c’est sans hasard.
D’un côté, une femme qui, avec quelques autres en France, cherche à se poser en instance régulatrice contre des jeunes « frénétiques » qui, au reste, ne sont pas à nos portes, d’où le caractère courageux de la position ; qui a prêché contre celles qui dénoncent le harcèlement sexuel ; qui déplore que la maternité rende des femmes contentes d’elles, etc. De l’autre, la même qui se pose en mère de fils et dit qu’il est des femmes qui, tendrement, « retiennent leur souffle » tandis que les hommes se cherchent et se trouvent. Les deux aspects vont très bien ensemble : l’association d’une position d’autorité vis-à-vis d’adolescentes turbulentes et d’une attitude protectrice vis-à-vis des hommes et de leur droit à la sollicitude, voilà qui rappelle une figure fortement ancrée dans notre culture, et qui remonte au moins à la presbyptera de saint Paul : parmi les femmes, seules celles qui sont un peu âgées ont la parole, laquelle leur est donnée, pour « qu’elles enseignent la bonne conduite aux femmes plus jeunes, qu’elles leur disent d’aimer leur mari, d’avoir de l’affection pour leurs enfants, d’être prudentes, chastes, sobres, d’avoir soin de leur maison, d’être complaisantes et soumises à leur mari » [4]. Il ne s’agit pas d’un strict problème de vieillissement, mais de la mise en service, par l’ordre patriarcal, d’une angoisse que le même ordre patriarcal suscite chez les femmes, dès qu’on peut les (nous) désigner comme « non jeunes ». Quand on cesse d’être objet juvénile, un rôle de contre-dame de l’ordre patriarcal est proposé (dans la langue ouvrière, une contre-dame est un contremaître femme). Et c’est cela ou rien, ce statut-là ou la perte de tout statut. Par ailleurs, il semble que les pouvoirs publics, « culturels » et médiatiques aient la possibilité maintenant de choisir leurs interlocutrices, de bombarder comme représentative qui les arrange, d’élire eux-mêmes nos porte-parole. De mémoire de fille du baby-boom, jamais la complaisance, jamais l’alliance de femmes avec des pouvoirs mâlement tenus n’avait été si bien rétribuée. En revanche, toute critique induit une marginalisation au moins apparente, pour cause de rupture de consensus. Et le droit à la parole s’est tellement restreint, qu’il suffit de l’accorder un peu, même à des femmes qui ont fait le féminisme d’hier, pour qu’elles y voient une reconnaissance de leur respectabilité, et donc se conduisent comme on l’attend d’elles. Le signe de ralliement, en ce moment, consiste à rompre des lances contre les jeunes Américaines, mais il pourrait être autre.
Et si tout ceci était un symptôme de la frousse des détenteurs du pouvoir politique ou idéologique ? Regardez donc le mal qu’ils se donnent pour conjurer d’avance un danger qui n’a pas encore éclos ! Les femmes qui ont moins de vingt-cinq ans, ici et aujourd’hui, n’ont pas dit leur premier mot, même si elles ont déjà un peu montré quelle est leur sensibilité politique. Ce mot peut venir du jour au lendemain ou ne pas venir du tout. J’ai gardé des souvenirs nets de l’année universitaire 1969-1970 : le grand sujet de conversation, dans les dîners en ville ou les soirées d’étudiant(e)s, c’était le Women’s Lib, dont il convenait de faire des gorges chaudes. Et puis, en août 1970, il y eu le grand imprévu de l’Étoile, où elles étaient neuf, et, en novembre 1971, une manif pour la liberté de l’avortement, où nous étions des milliers. Or, déjà en ce temps-là, des femmes qui avaient un passé plutôt avouable de notre point de vue furent mises à contribution pour nous désavouer. L’histoire est en train de se répéter, à titre prophylactique sûrement. En attendant qu’éventuellement une génération montante vienne dire son mot, ne devrions-nous pas cultiver l’art peu courant de vieillir agréablement ? d’accumuler les années sans vieillir ? Ceci passe assurément par une certaine attitude vis-à-vis des femmes plus jeunes : le refus radical d’être leurs cheftaines, en quelque sens que ce soit. Que l’imprévisible nouvelle vague définisse elle-même son langage et ses fins ! Nous poursuivrons les nôtres, qui sont loin d’être accomplis, et continuerons peut-être aussi à trouver du charme à des échanges affectifs et intellectuels avec quelques hommes curieusement exempts du syndrome badintérien de l’XY, ou qui le cachent drôlement bien, pour se faire estimer, sans doute, avant même de se faire aimer.
[1] Les noms de Hegel et A. Comte (qui ne sont pas de nos libérateurs) n’apparaissent pas dans l’index. Pourtant, XY se rapproche du § 166 de La Philosophie du Droit avec son Zusatz (la femme comme déploiement tranquille, l’homme qui a sa vie substantielle dans le combat et le travail) et de la tradition positiviste (je me permets de renvoyer à « Quelle modernité philosophique ? », in La Revue d’en-face, 1982, n° 12). Donc, si vous trouvez E. Badinter absurde, avez la bonté d’étendre vos ricanements ou votre rire à certains sous-produits de la philosophie phallocrate, plutôt qu’à l’ensemble du mouvement féministe !
[2] Interview de Michel Sapin (ministre de la Justice) dans Projets Féministes, n° I. mars 1992.
[3] Lire l’article de Mariette Sineau. « Pouvoir, modernité et monopole masculin de la politique : le cas français » in N. Q. F., 1992, vol. 13, n° 1.
[4] Épître à Tite. 2 ; 3-5.
Pour citer cet article :
Michèle Le Doeuff , « Le chromosome du crime, à propos de XY », Fédération de recherche sur le genre RING, 4 août 2010. URL : http://www2.univ-paris8.fr/RING/spip.php?article1075
Fichiers de syndication :
Statistiques :
Le site contient 4383 articles