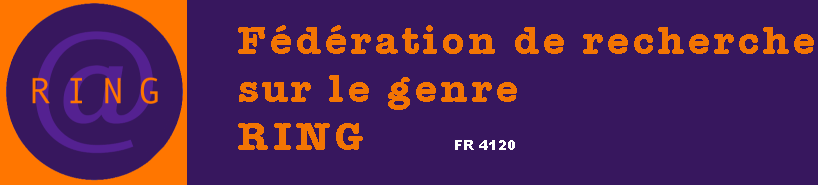Sur « L’anatomie politique, catégorisation et idéologie du sexe » de Nicole-Claude Mathieu
par Denis Berger
Texte paru dans la revue Futur antérieur, numéro spécial "Féminismes au présent", avril 1993.
A la lecture de ce livre, on éprouve de la gêne. Ce sentiment ne naît pas du contenu de l’ouvrage. Bien au contraire, c’est le silence observé à propos d’un travail d’une telle qualité qui suscite le malaise. Inspirée par une critique féministe radicale – elle-même fortifiée par le combat des mouvements de femmes – Nicole-Claude Mathieu fait oeuvre d’épistémologie. L’essentiel de ses démonstrations tend à prouver que les différences de sexe sont socialement organisées pour maintenir la minorisation et l’exclusion des femmes. A partir de ce constat fondamental, elle établit, à l’aide d’une remarquable érudition ethnologique, que la volonté de nier aux femmes le statut de sujet social ne peut qu’empêcher une vision scientifique des structures et du fonctionnement de toutes les sociétés existantes : l’invisibilité des femmes dans l’analyse que mène la pensée androcentrique dominante est source d’une incompréhension fondamentale du contenu réel de concepts tels que le pouvoir, la domination, l’exclusion, l’exploitation, etc.
En d’autres termes, dans la synthèse qu’elle opère des études féministes les plus récentes, Nicole-Claude Mathieu propose une méthodologie nouvelle pour l’ensemble des sciences sociales. A ce titre, son livre est un ouvrage de référence même pour ceux qui en critiquent certaines conclusions. Que, depuis sa publication il n’ait pas été considéré comme tel par les grands parleurs de l’Université et de la recherche, en dit long sur l’état actuel de ces institutions.
Quelques mots encore pour présenter l’auteur et son travail. Nicole-Claude Mathieu, sociologue et ethnologue, enseigne à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales ; membre du Laboratoire d’Anthropologie sociale, secrétaire de rédaction de la revue l’Homme, elle a une réputation internationale (elle a notamment été chargée de rapports avec l’Unesco). Elle a dirigé, en 1985, la publication d’un recueil d’études, l’Arraisonnement des femmes [1].
L’Anatomie politique est un recueil d’articles et de rapports parus entre 1970 et 1989. Ils sont regroupés ici en deux parties (Le sexe, évidence fétiche ou concept sociologique ?, Conscience, identités de sexe/ genre et production de la connaissance). Leur présentation dans un ordre chronologique a l’avantage de montrer les constantes d’une recherche, tout en permettant de suivre l’évolution et la précision des concepts.
Invisibilité et domination
D’un ensemble riche, on ne peut, dans un compte rendu, que mettre en valeur quelques traits principaux. Le premier concerne, il faut y revenir, la méthode même des sciences sociales. Celles-ci ne font pas référence aux catégories de sexe, sauf à accorder dans la sociologie de la famille ou la sociologie de la sexualité, un statut particulier à la femme, considérée comme une particularité par rapport au modèle général qu’est l’homme. A ce dernier, on ne fait pas référence comme sujet sexué mais comme être en soi par rapport auquel s’organise et se définit la société. Du même coup, les rapports sociaux de sexe ne sont pas pris en compte comme facteurs déterminants de l’histoire et la vision de la société globale qui en résulte ressemble à celle d’un borgne qui, placé sur un piedestal, prétendrait embrasser tout le champ de l’horizon, et y régler la circulation.
On aboutit ainsi à une dichotomie quasi absolue. L’homme, placé au centre de l’édifice social imaginé, est seul du côté de l’universel, du général, du social, et du culturel. La femme est définie par rapport à lui et la différence qu’on est contraint de lui reconnaître ne peut être ni sociale, ni culturelle elle relève du domaine biologique ; la femme est du côté de la Nature. Dans le meilleur des cas, elle pourra espérer parvenir au niveau de l’homme, jamais exister par elle-même. Cette relation, constitutive du lien social, est modifiée mais non fondamentalement altérée par les résultats des luttes. L’oppression, la minorisation, l’exclusion, sont parties intégrantes des structures du pouvoir qui, parce qu’il place l’homme en position de domination, détermine son idéologie et sa vision du monde androcentriste [2].
Les rapports de sexes doivent être perçus comme des rapports sociaux de domination. Le sexe biologique est intégré dans une réalité sociale qui devient primordiale, voire déterminante. Et la tâche principale est « une théorisation sociologique de la notion de sexe » (p. 228) qui tienne compte du « sexe pensé » (tout ce qui relève des représentations et des mythes) comme du « sexe agi » (les rapports sociaux entre sexes). N.-C. Mathieu, qui a contribué à l’élaboration de la notion de « genre », estime que le « genre construit le sexe » (p. 255) : la détermination des femmes par leur anatomie, telle qu’elle est opérée dans les sociétés existantes, est « l’opérateur du pouvoir d’un sexe sur l’autre » (p. 258). Le problème des rapports entre hommes et femmes ne peut être compris, et résolu, qu’au niveau social.
Même à partir d’un résumé sommaire, il est possible de se rendre compte de la fécondité du travail de Nicole-Claude Mathieu : à partir de ses analyses, des hypothèses de recherche peuvent être formulées en nombre. Toutes permettent de comprendre sans cesse davantage la structure dissymétrique de nos sociétés où toutes les divisions de classes (au sens large du terme) sont surdéterminées par les affrontements entre les sexes, socialement définis par la domination masculine et l’exclusion multiforme des femmes.
L’auteur fournit d’ailleurs, au gré des études qui constituent l’Anatomie politique, plusieurs exemples des résultats que permet sa méthode. Je retiendrai d’abord ses remarques sur la division sexuelle du travail. Contrairement à ce qu’ont pensé la plupart des auteurs, Marx et Engels en premier lieu, cette division n’est pas « naturelle ». Elle est au contraire, postérieure à l’attribution de valeurs et à la définition de positions sociales ce qui apparaît comme une « simple » répartition des « tâches » en fonction de critères « techniques » (la « moindre résistance physique » attribuée aux femmes, leur rôle dans la procréation) est en fait une construction sociale où s’expriment des rapports de pouvoir [3]. Une telle réflexion contribue à poser l’étude des sociétés différemment des structuralistes classiques. (N.-C. Mathieu se livre d’ailleurs à une critique nuancée mais ferme de Lévi-Strauss, notamment à propos de concept « d’échange des femmes ».)
Je noterai aussi l’utilisation que l’auteur fait de Freud. Récusant le rejet sommaire de la psychanalyse auquel ont procédé certaines féministes, telle Kate Millet, elle distingue entre la description du processus de subordination des femmes que Freud a fait efficacement de la rationalisation de l’oppression qu’il a commise au nom de pseudo-critères « naturels » (par exemple, la « passivité » inhérente aux femmes opposée au caractère « actif » des hommes). Une telle distinction – qu’il faut appliquer à d’autres auteurs, Marx, Lévi-Strauss… – est fondamentale car elle permet de « travailler avec Freud » en utilisant ses concepts les plus opérants sans renoncer à une critique interne de sa démarche, et donc de ses concepts eux-mêmes.
Il y aurait dix autres développements de Nicole-Claude Mathieu à citer (sur la maternité, sur l’avortement, sur le langage, etc.). Je me bornerai à une remarque générale réflexion à portée globale sur le pouvoir, l’Anatomie politique pose des jalons qui peuvent conduire à une réflexion sur le monde contemporain. Les phénomènes de bureaucratisation qui ont conduit à l’effondrement du « socialisme réellement existant » aussi bien que les manifestations de renaissance du chauvinisme et du racisme ne peuvent être compris sans une référence à l’inconscient des individus et des groupes. A ce niveau, aucune analyse n’est possible qui ne prenne en compte, pour en mesurer les conséquences sociales et politiques, l’existence des rapports sociaux de domination entre hommes et femmes.
Identité et Conscience : femmes et classes
Nicole-Claude Mathieu procède à une critique acérée de l’idée, couramment véhiculée par les ethnologues et les sociologues, selon laquelle les femmes « consentiraient » à leur domination par les hommes, soit pour des raisons utilitaires, soit par adoption des normes dominantes. Cette « théorie », qui peut abusivement se réclamer de La Boétie, a pour contrepartie la notion d’un « pouvoir caché » des femmes, masqué sous les apparences de la prédominance masculine mais disposant de redoutables ressources effectives.
Pour l’auteur de l’Anatomie politique, tout consentement suppose une conscience préalable des rapports de forces existants. Dans le cas des rapports de sexe, cette forme de contrat (dont la formulation est inspirée par la philosophie politique de la démocratie) n’a pas sa place car la violence généralisée est la marque constitutive de la domination d’un sexe sur l’autre. Violence physique mais aussi, et plus généralement, violence sociale, qui se traduit par une exclusion idéologique, un rejet global des femmes du domaine de la connaissance (ce que marquent l’éducation et le langage, entre autres).
Les femmes, plutôt qu’elles ne consentent, cèdent devant la domination. Celle-ci est vécue comme un traumatisme récurrent, dont l’aboutissement est une forme mutilée et mystifiée de conscience. L’intériorisation des normes n’équivaut pas à leur acceptation. Cette analyse a une portée générale ; elle peut être reportée sur l’ensemble de la société politique (qui, en définitive, a pris naissance en fonction de l’exclusion des femmes de l’espace public). Elle peut, en particulier, faciliter une approche critique de la notion molle de « consensus », tellement popularisée de nos jours par les tenants du libéralisme B.C.B.G. Tout consensus n’est pas une acceptation, mi-consciente mi-inconsciente. L’histoire nous a fourni et nous fournit de nombreux exemples de ce que Gramsci aurait appelé sans doute « consensus passif » et qui exprime la résignation à une domination, triomphante grâce à une violence larvée permanente.
Le dernier article de l’ouvrage aborde la question des rapports entre sexe et genre. Il distingue trois formes d’identité des femmes : l’identité sexuelle (individuelle) ; l’identité sexuée (conscience d’appartenir à un groupe) ; l’identité de sexe (qui est une conscience de classe dans la mesure où elle est conscience d’être déterminée socialement comme femme). Cette forme d’identité, que défend N.-C. Mathieu, me semble poser un certain nombre de problèmes qui ne trouvent pas tous réponse dans le livre.
Parler de « conscience de classe » des femmes, c’est – l’auteur ne s’en cache pas – vouloir utiliser la méthode que Marx a appliqué à la situation du prolétariat. Pourquoi pas ? S’il s’agit de rendre compte à la fois de la réalité d’une exploitation spécifique des femmes (le rôle du travail domestique, la domination sur la procréation qui se traduit par une domination des corps), de l’existence d’intérêts communs des femmes qui transcendent leurs intérêts de classe et du rôle moteur que jouent dans l’histoire les luttes entre les sexes, au même titre que les luttes entre les classes.
Mais analogie n’est pas identité. Et on peut se demander s’il est utile de pousser la comparaison trop loin. La domination des femmes par les hommes ne s’exprime pas seulement dans les rapports de production. Sa spécificité naît, dans une large mesure, de ce qu’elle est, socialement, liée à la sexualité – ce qui lui donne un rapport direct avec l’inconscient. La richesse de la critique féministe vient de la prise en compte de cette dimension, grâce à laquelle on peut envisager une définition de pouvoir qui tienne compte pleinement de la subjectivité. De celle-ci Nicole-Claude Mathieu a le souci permanent. Mais il n’est pas certain que l’insistance qu’elle met sur le caractère « matérialiste » de son analyse de l’oppression (bien qu’elle soit fondée comme point de départ d’une recherche) suffise à répondre à toutes les questions que soulèvent, à partir de la domination des femmes, le pouvoir quotidien comme le pouvoir politique central.
Et ceci d’autant plus que le concept de la conscience de classe n’est pas un des mieux étayés du marxisme théorique (même et surtout après Lukacs). Ladite conscience est-elle le produit d’un développement organique des luttes ou doit-elle une part importante de sa constitution à l’action d’organisations qui se veulent représentatives ? Dans ce dernier cas, qui me semble confirmé par un siècle d’histoire du mouvement ouvrier, surgit immédiatement le problème de la bureaucratie. La réflexion sur ce phénomène ne peut que s’enrichir de la critique féministe du pouvoir. A condition que celle-ci soit plus que le calque des analyses du marxisme canonique.
Affirmer l’existence d’un bloc (d’une classe) des femmes est un projet politique plus qu’une description de la réalité. En dépit des liens décisifs qui l’unissent face à la domination masculine, le « groupe femme » n’est pas homogène. Il est traversé par des dissonnances (des contradictions) dues au poids des structures sociales (de classe). Rechercher comment les surmonter, c’est se demander quels liens existent dans les faits et peuvent exister dans les luttes entre oppression des femmes et combats de classes, combats nationaux. L’homogénéisation du mouvement des femmes est à ce prix.
N.-C. Mathieu esquisse une réponse qui ne me convainc guère. Partant d’une application systématique et quelque peu mécanique du principe selon lequel le genre (social) conditionne le sexe, elle privilégie le rôle des lesbiennes. Ses développements sur les lesbiennes comme autres (elles ne sont femmes ni économiquement, ni politiquement, ni idéologiquement, selon la formule de Monique Wittig), sa critique de l’imposition de l’hétérosexualité comme forme de domination masculine sont forts. Ils ne me semblent pourtant pas rendre compte de la situation de toutes les femmes : l’hétérosexualité n’est pas seulement un produit de l’opposition masculine ; elle n’est pas une forme obligée de « collaboration de classe ».
Si je termine par ces remarques critiques, c’est parce que le débat qu’ouvre Nicole-Claude Mathieu, les avances méthodologiques qu’elle propose me semblent trop importantes pour qu’on reste, devant eux, dans un silence intermédiaire entre l’acquiescement et la dénégation.
(Berger Denis, militant politique et essayiste est décédé le 6 mai 2013. Il était le compagnon de Michèle Riot-Sarcey.)
Pour citer cet article :
Denis Berger , « Sur « L’anatomie politique, catégorisation et idéologie du sexe » de Nicole-Claude Mathieu », Fédération de recherche sur le genre RING, 11 mars 2014. URL : http://www2.univ-paris8.fr/RING/spip.php?article3327
Notes
[1] N. C. Mathieu, L’Arraisonnement des Femmes. Essais en Anthropologie ries sexes. Paris, éd. EH.E.S.S. Cahiers de l’Homme, nouvelle série n°24, 1985, 251 p. (contributions de N. Échard, O. Journet, C. Michard-Marchal, C. Ribery, N.-C. Mathieu, P Tabet).
[2] « Qu’il s’agisse des idéologies scientifiques ou des idéologies des différentes sociétés, l’invisibilité des acteurs sociaux hommes en tant que groupe sexué (c’est-à-dire défini dans et par les rapports économiques, juridiques, reproductifs qu’ils entretiennent avec l’autre groupe de sexe : les femmes) dépendait (et dépend encore) de l’invisibilité des femmes en tant qu’acteurs sociaux et de leur représentation comme, en quelque sorte, des sexes non acteurs », L’Anatomie politique, p. 81.
[3] « La division du travail par sexe peut en conséquence être vue comme un « tabou » ; un tabou contre la similitude des hommes et des femmes ; un tabou divisant les sexes en deux catégories exclusives ; un tabou qui exacerbe les différences biologiques entre les sexes, et par là crée le genre » Gayle Rubin. The Traffic in women. Notes on the « political economy » (cité p. 122).
Fichiers de syndication :
Statistiques :
Le site contient 4383 articles