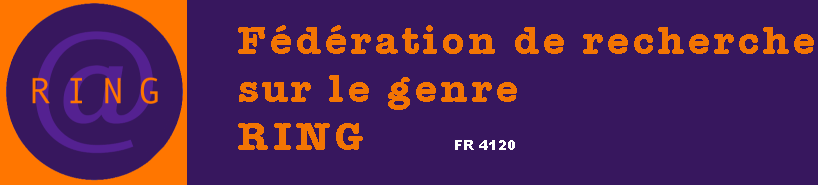Autres mots-clés :
maternité
-
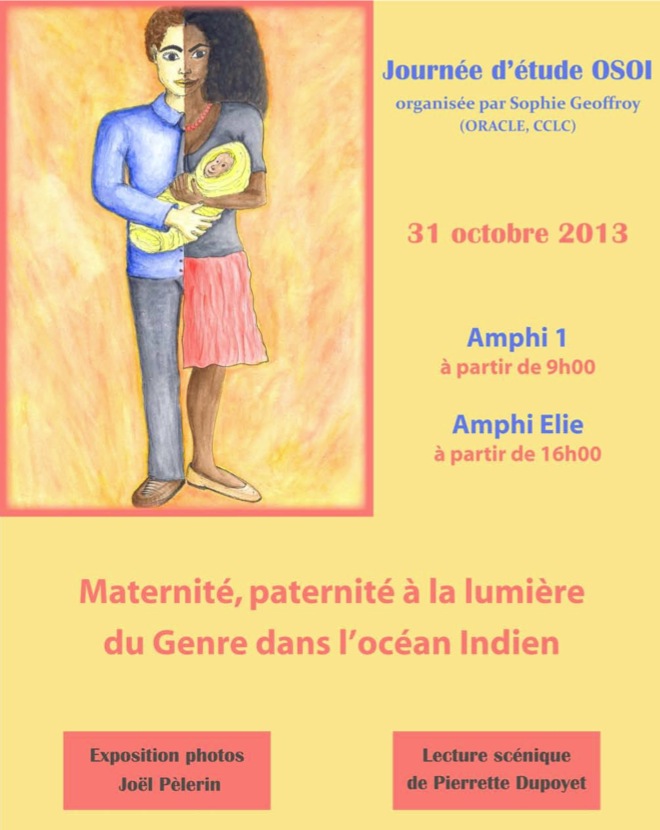
Journée d’études
Maternité, paternité à la lumière du genre dans l’Océan indien
31 octobre - La Réunion
Cette journée est organisée dans le cadre de la Fédération OSOI (Observatoire des Sociétés de l’Océan Indien), et soutenue par le laboratoire Oracle, l’équipe d’accueil CCLC et l’Association Niama.
lire la suite
-

Conférence
Yvonne Knibiehler, "Etre Mère et travailler / Maternité et Citoyenneté"
9 mars - Aix-en-Provence
" La maternité pèse sur les femmes bien plus que la paternité ne pèse sur les hommes. Elle est encore trop souvent un obstacle à l’action politique des femmes. Elle doit au contraire devenir une source d’inspiration essentielle pour toute femme."
lire la suite
-

Livre
Geneviève Lefort, L’Education des mères. Olympe Gevin-Cassal, inspectrice générale de l’enfance (1859-1945)
À partir des archives personnelles d’Olympe Gevin-Cassal, inspectrice générale de l’enfance, et de nombreux autres documents, Geneviève Lefort retrace l’itinéraire d’une femme hors du commun.
lire la suite
-
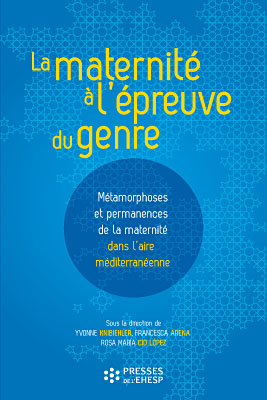
Yvonne Knibiehler, Francesca Arena, Rosa Maria Cid Lopez (dir.), La maternité à l’épreuve du genre. Métamorphoses et permanences de la maternité dans l’aire méditerranéenne
Les recherches sur la maternité ont intégré les critiques des féministes sur la « maternité aliénante » dans les années 1970 et la revisitent désormais à la lumière du « genre » et des constructions sociales. Expérience personnelle et intime, la maternité n’en est pas moins soumise aux contraintes culturelles, sociales, économiques et politiques qui entretiennent aujourd’hui encore les inégalités entre les sexes.
lire la suite
-

Maternités
Paris 8
« La maternité » est un topos et une question qui divisent profondément les féminismes occidentaux depuis les premières théorisations féministes en la matière : expérience singulière d’un sexe, rôle social dévolu à un genre, position symbolique et/ou imaginaire d’un sujet, pratique(s) du care, institution socio-politique, élément structurant de la parenté, régime particulier du biopouvoir, le terme recouvre des questions et problématiques diverses, voire divergentes.
lire la suite
-

La Maternité face au marché
3 décembre - Paris
Avant de se battre sur des « réponses » qu’il convient d’apporter à des problèmes de société, il faut avoir des opinions fermes que chacun doit être apte à se construire personnellement. Pour cela, il faut disposer non pas des multiples discours fournissant des « réponses », mais de l’état des « questions », pour que chaque citoyen devienne apte à se faire une opinion et puisse la faire valoir dans l’espace public démocratique national et international.
lire la suite
-

Colloque
La maternité à l’épreuve du genre. Métamorphoses et permanences de la maternité dans l’aire méditerranéenne
13-14 janvier
Colloque organisé par l’Association Déméter-Coré
La création de l’association Déméter-Coré (Association de recherche et
intervention sur la maternité, les femmes et le genre dans l’aire
méditerranéenne) rassemble des chercheurs universitaires, des responsables
d’associations et des acteurs de terrain.
lire la suite
-

Journée d’étude
Des nourrices aux banques de lait : commerce, économies du don et échanges symboliques autour des substituts du sein maternel
26-27 juin - Genève
-

Colloque international
Travail et maternité dans l’aire méditerranéenne
Avant le 1er mai 2014 - Aix-en-Provence
Selon les économistes de l’ère industrielle le " travail" est "productif" (producteur de valeur marchande), il se vend et s’achète sur le marché, relève de la sphère publique, et appartient essentiellement aux hommes. Les activités liées à la reproduction (mise au monde et première éducation des enfants) n’entrent pas dans la catégorie "travail" parce qu’elles ne se vendent pas et n’auraient donc pas de "valeur" ;
lire la suite
-

Travail et maternité dans l’aire méditerranéenne
Avant le 1er mai - Aix-en-Provence
Selon les économistes de l’ère industrielle le " travail" est "productif" (producteur de valeur marchande), il se vend et s’achète sur le marché, relève de la sphère publique, et appartient essentiellement aux hommes. Les activités liées à la reproduction (mise au monde et première éducation des enfants) n’entrent pas dans la catégorie "travail" parce qu’elles ne se vendent pas et n’auraient donc pas de "valeur" ; relevant de la sphère privée, elles sont confiées aux femmes, mères et futures mères, sous le contrôle des pères.
lire la suite
Fichiers de syndication :
Statistiques :
Le site contient 4383 articles