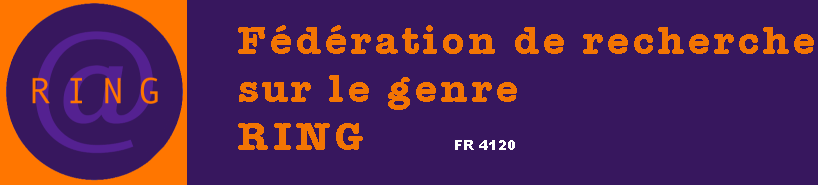Entretien avec Nicole-Claude Mathieu (EHESS)
Un hommage critique à Lévi-Strauss et Freud : Gayle Rubin (1975)
par Catherine Quiminal
Texte paru dans le Journal des anthropologues n° 82-83, 2000.
Nicole-Claude Mathieu et Catherine Quiminal, « Un hommage critique à Levi-Strauss et Freud : Gayle Rubin (1975) », Journal des anthropologues, 82-83 | 2000, mis en ligne le 18 janvier 2012, consulté le 26 mars 2014. URL : http://jda.revues.org/3276
Catherine Quiminal – Près de 25 ans après sa parution en anglais, le CEDREF publie la traduction que tu viens de faire de l’article de Gayle Rubin, « L’économie politique du sexe. Transactions sur les femmes et systèmes de sexe/genre » [1]. Elle y appelait à revisiter les œuvres de Lévi-Strauss et de Freud, car : « Au contraire [de Marx], dans les cartes de la réalité sociale établies par Freud et Lévi-Strauss, il y a une intense reconnaissance de la place de la sexualité dans la société et des profondes différences d’expérience sociale entre les hommes et les femmes ». Selon elle – une fois élucidées par un œil critique les implications de leurs théories – « ils fournissent des outils conceptuels qui permettent d’élaborer des descriptions de cette part de la vie sociale qui est le lieu de l’oppression des femmes, des minorités sexuelles et de certains aspects de la personnalité humaine chez les individus ». Peux-tu nous rappeler le contexte dans lequel l’article avait paru aux USA et nous préciser la raison de cette traduction tardive ?
Nicole-Claude Mathieu – Dès le début des années soixante-dix, en pleine expansion du mouvement féministe aux Etats-Unis, se sont créés également dans les universités des groupes de discussion entre femmes – étudiantes, enseignantes et chercheures – qui se sont concrétisés dans les premiers cours de « Women’s Studies », et ce, dans toutes les disciplines, puis ont donné lieu à des livres souvent collectifs sans compter de nombreux articles de revues. Pour ne parler que de l’anthropologie, deux ouvrages importants de l’époque furent en 1975 Toward an Anthropology of Women, où est paru l’article de Gayle Rubin, précédé en 1974 de Woman, Culture and Society, édité à Stanford University par Michelle Zimbalist Rosaldo et Louise Lamphere. Il est facile, et stupide, de ricaner aujourd’hui (ou à l’époque) sur cette insistance à vouloir se centrer sur les « femmes ». C’était un parcours obligé puisqu’elles étaient invisibles dans les discours scientifiques établis. Soit on ne parlait pas des activités des femmes, soit on en parlait trop peu, soit on en parlait de travers et surtout, conséquence logique, cette partie des acteurs sociaux n’était pas intégrée dans les théorisations « générales » du fonctionnement et de la structure des sociétés. (Je parle au passé, mais globalement ça n’a guère changé.) Donc certaines ethnologues se sont attachées à compléter ou corriger les ethnographies, d’autres à réévaluer les théorisations existantes. Je ne vais pas m’étendre là-dessus, j’ai fait pour l’Unesco en 1985 un rapport détaillé sur les principales analyses féministes critiques de la période [2]. Bref, face à une anthropologie (et une sociologie, et une histoire, etc.) androcentrée et devant un langage, tant courant que scientifique, également androcentré, il fallait donc « chercher les femmes », si j’ose dire. Et notez que le titre Woman, Culture and Society est évidemment un clin d’œil agacé au titre (prototypique) de l’ouvrage édité par Shapiro en 1956 : Man, Culture and Society, où est parue d’ailleurs la version originale en anglais de l’article de Lévi-Strauss, « La famille » – dont Rubin tire des conséquences radicalement logiques auxquelles personne n’avait pensé et qui prennent de nos jours un regain d’actualité…
Gayle Rubin était active dans le mouvement des femmes et co‑fondatrice du programme de Women’s Studies à l’université du Michigan. Son article est, comme elle le souligne, sa « vision personnelle d’une conversation collective » – le produit de cette passion de penser que nous avons connue autour de 68, passion pour comprendre rationnellement afin de mieux combattre politiquement les inégalités, les hiérarchies sociales, et en l’occurrence les discriminations basées sur le sexe et la sexualité. Les courants de pensée alors prégnants étant le marxisme, la psychanalyse et le structuralisme, c’est à eux que s’est adressée Rubin pour voir s’ils peuvent nous éclairer (si oui en quoi, et sinon pourquoi) sur les mécanismes de l’oppression des femmes et de la répression de l’homosexualité.
Pourquoi cette traduction française tardive ? Parce qu’à l’époque, je n’avais pas trouvé de lieu où la publier, même dans des revues féministes. Si bien que, lorsque au sein du programme universitaire « Genre, Sciences et Sociétés », l’idée fut émise de revenir, lors de journées d’étude, sur l’histoire des théories féministes (soulignons une fois de plus, pour les ignorants qui persistent, qu’il n’existe pas « une » théorie féministe) – et plus précisément de leurs rapports (critiques ? emprunts ? ruptures ?) aux grandes théorisations sociales –, il allait de soi qu’organisant en janvier 1999 la première journée, consacrée à la pensée de Claude Lévi-Strauss, je devais exposer l’importance de ce texte pionnier de Rubin, très largement ignoré en France [3].
Le traduire m’a semblé nécessaire aussi pour les étudiants. J’estime qu’il devrait être inclus dans les programmes d’enseignement, car il allie, à la clarté d’exposition des théories de Marx, Engels, Freud et Lévi‑Strauss sur les sexes, l’audace de la pensée critique, la précision de l’argumentation et, last but not least, un humour décapant. C’est aussi l’occasion de redécouvrir (et pour beaucoup d’apprendre) les débats des diverses tendances d’analyse du féminisme des années soixante-dix aux Etats-Unis (les mêmes débats avaient lieu en Europe, la littérature en français est accessible à qui veut la chercher, notamment à la bibliothèque Marguerite Durand à Paris). De son point de vue d’ethnologue, Rubin fait remarquer que certaines des questions posées à partir des sociétés occidentales ne peuvent s’appliquer à l’ensemble des sociétés, ni même expliquer les mécanismes fondamentaux de l’oppression des femmes dans les sociétés modernes : ainsi en est-il, par exemple, des discussions des féministes marxistes sur l’articulation entre capitalisme, travail domestique et oppression des femmes. Et certains concepts utilisés pour rendre compte de la situation des femmes et des rapports entre les sexes lui semblent trop restreints, comme celui de « mode de reproduction », ou trop spécifiques historiquement, comme celui de patriarcat. C’est pourquoi elle propose la dénomination plus générale de sex/gender systems, « systèmes de sexe/genre »...
C.Q. – Dont elle donne comme définition préliminaire : « un “système de sexe/genre” est l’ensemble des dispositions par lesquelles une société transforme la sexualité biologique en produits de l’activité humaine et dans lesquelles ces besoins sexuels transformés sont satisfaits ». Dans son article, G. Rubin opère un déplacement des interrogations précédentes sur les origines de la subordination des femmes, vers l’étude de « ces relations sociales qui font qu’une femelle devient une femme opprimée ».
N.-C.M. – D’où la distinction entre sexe, sexualité et genre. L’une des tâches de la nouvelle vague du féminisme était de contrer l’idée commune que les catégories « femme » et « homme » étaient biologiques (les « femmes » étant d’ailleurs davantage naturalisées que les hommes, et il s’agissait d’expliquer pourquoi). Ces idées naturalistes couraient aussi bien dans la rue, que chez certaines tendances féministes, que dans les sciences sociales ou psychologiques.
C.Q. – C’est pourquoi tu avais écrit dès 1971 ton article « Notes pour une définition sociologique des catégories de sexe », et Colette Guillaumin, « Pratique du pouvoir et idée de Nature – L’appropriation des femmes », paru en 1978.
N.-C.M. – Oui. Et Pierre Naville, alors directeur de la revue Epistémologie sociologique, avait eu du mal à imposer mon texte au comité de rédaction ; de même que le CNRS au long des années soixante-dix pas plus que l’Ecole des Hautes Etudes ensuite, n’a admis comme recevable scientifiquement mon projet de recherche sur le « sexe social ». Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. Et il ne s’agit pas seulement d’une réticence socio-viscérale à admettre que les sexes ne sont pas si naturels et si « différents » que ça. Tout cela fait partie d’une attitude globale qui perdure aujourd’hui dans les milieux scientifiques européens, particulièrement en France, toujours championne de l’arrogance et de la bêtise institutionnelles – et dont les étudiants font aussi les frais : c’est que, voyez-vous, alors qu’il est admis (depuis la fin de l’Inquisition ?) que toute « science » ne progresse que par la critique d’elle-même, seuls les majoritaires font de « l’épistémologie », les minoritaires et les novateurs faisant… de « l’idéologie ». Plus aucun ethnologue (crois-je) n’oserait dire d’un texte rigoureux reconsidérant, mettons, l’histoire de la colonisation ou de l’esclavage : « Ah, si ça vient d’un Noir antiraciste, je le jette à la poubelle et je l’interdis à mes étudiants ». C’est pourtant ce qui se fait encore aujourd’hui des écrits de chercheurs femmes féministes, y compris de la part de femmes qui travaillent prétendument sur le « genre ». Bien sûr il y a des Noirs antiracistes et des femmes féministes qui disent des bêtises, tout comme beaucoup d’hommes « scientifiques » qui se croient sans couleur et sans idéologie.
L’invisibilisation des travaux sérieux qu’il arrive quand même à des féministes, ou à des homosexuel-le-s, de produire peut se faire sous des formes plus insidieuses mais qui vont dans le même sens. Je me souviens d’avoir été choquée par un article de Claude Lévi‑Strauss paru dans les Temps modernes [4]. Choquée non par le contenu : il vilipendait fort justement un certain nombre de théories fantaisistes sur le présumé rôle de la perte de l’œstrus chez les femelles dans le passage de la nature à la culture. Mais choquée par l’attribution de ces bêtises, non à des auteurs précis, mais d’entrée de jeu à « l’influence des mouvements féministes et [des] gender studies » aux Etats-Unis qui, selon lui, auraient amené un retour en force « des hypothèses matriarcales ». (Il faut savoir que toute féministe, quoi qu’elle dise ou fasse, est systématiquement pensée comme une adepte du matriarcat !) D’une part, si le simple fait de se demander quel a pu être, à l’époque, le changement de comportement socio-sexuel actif des femelles-femmes (et pas seulement des mâles-hommes) est une hypothèse matriarcale, on n’est pas sortis de l’auberge. D’autre part, enraciner la culture dans la physiologie, s’adonner à « une pensée aveuglée par le naturalisme et l’empirisme », n’est pas le propre de travaux féministes (Lévi-Strauss a depuis longtemps combattu de célèbres sociobiologistes hommes qu’on ne saurait soupçonner de féminisme) – et surtout n’en constitue qu’une infime minorité. Ne citer aucun nom parmi ces « gender studies » peut certes apparaître comme de l’élégance ou de la commisération, mais aboutit en réalité à globaliser une catégorie entière de chercheur-e-s – dont la plus grande part ne partage pas du tout les théories mises en cause dans l’article – sous l’infamie de la non‑scientificité.
C.Q. – Ce qui, chez d’autres, se présente sous l’accusation d’« idéologie ». Mais Marx était en lutte contre l’idéologie, celle majoritaire, des économistes, ce qui lui a permis de construire une théorie radicalement nouvelle sur les mécanismes de l’exploitation capitaliste du travail.
N.-C.M. – Oui, il fut un temps (hélas disparu sous la nouvelle vague des « post » : post-modernisme, post-structuralisme, etc.), un temps où cette position critique de la science précédente et de la société fut validée comme scientifique, et pas seulement « idéologique ». Il reste encore des gens qui pensent que sa méthode est toujours applicable, notamment à l’analyse des rapports de sexe, ce qui nous ramène à Gayle Rubin.
Rubin – comme celles d’entre nous qui créèrent en France la revue théorique Questions féministes où parut l’article de Guillaumin, et comme l’ethnologue italienne Paola Tabet dont parut en 1979 un article sur le rapport différencié des deux sexes aux moyens de production [5] – s’inspire de la méthode marxienne (et non obligatoirement marxiste) : la nécessaire approche en termes de rapports sociaux lorsqu’on traite des « sexes ». J’aimerais citer la très jolie paraphrase que fait Rubin d’un passage du Capital (qu’elle cite), où Marx dit que c’est seulement dans certains rapports sociaux qu’un « homme de race noire » devient un « esclave nègre », ou qu’une machine à filer le coton devient du capital :
« Qu’est-ce qu’une femme domestiquée ? Une femelle de l’espèce. Cette explication a autant de valeur que la première. Une femme est une femme. C’est seulement dans des rapports déterminés qu’elle devient une domestique, une épouse, un bien meuble, une minette du club Playboy, une prostituée ou un dictaphone humain. Arrachée à ces conditions, elle n’est pas plus l’assistante de l’homme que l’or n’est par lui-même de la monnaie, etc. »
C.Q. – Rubin nous enjoint dans son texte de commencer par l’exégèse des travaux de Lévi-Strauss et de Freud « pour débrouiller le système de relations par lequel les femmes deviennent la proie des hommes ». N’était-ce pas néanmoins une forme de complaisance, de concession aux théories dominantes, voire une provocation à l’endroit de certains courants féministes qui, à l’époque, ne pensaient rien devoir ni à Lévi‑Strauss ni à Freud, même revisité par Lacan ?
N.-C.M. – Il y a plusieurs façons pour les dominés de considérer les textes, ou les gens, par lesquels on se sent insultés : soit les abandonner à leur sort (et leur sort est excellent), soit saisir que l’insulte ressentie révèle une vérité sur le fonctionnement social de la domination, et que – ce que savent tous les chefs de guerre – la stratégie est plus efficace si on a compris l’adversaire, si on sait contre quoi et où se battre.
Rubin explique la violente opposition à la psychanalyse de la part du mouvement des femmes et du mouvement gay comme une réaction justifiée à ce qu’était devenue la psychanalyse aux Etats‑Unis, « où la tradition clinique a fétichisé l’anatomie ». Elle montre comment les pratiques cliniques, dérivées des théories de certains (et hélas certaines) successeurs de Freud dont elle donne des citations clé, ont entraîné des tentatives de normalisation des femmes vers la passivité, des lesbiennes et des homosexuels vers l’hétérosexualité – refoulant de la sorte les implications radicales qu’on aurait pu tirer des écrits de Freud. Car, dit‑elle, « selon l’orthodoxie freudienne, la conquête de la féminité “normale” est extorquée aux femmes au prix fort. La théorie de l’acquisition du genre aurait pu être le point de départ d’une critique des rôles de sexe ».
Concernant donc les rejets et les critiques, la position de Rubin est claire : « Dans la mesure où elle [la théorie de Freud sur la féminité] est une rationalisation de la subordination des femmes, ces critiques ont été justifiées. Dans la mesure où elle est une description du processus qui subordonne les femmes, cette critique est une erreur. En tant que description de la manière dont la culture phallique domestique les femmes, et description des effets que produit sur les femmes leur domestication, la théorie psychanalytique n’a pas d’égal […]. Et comme la psychanalyse est une théorie du genre, l’écarter serait suicidaire pour un mouvement politique qui se consacre à éradiquer la hiérarchie de genre (ou le genre lui-même) ».
C.Q. — Sa position est la même en ce qui concerne la lecture de Lévi-Strauss et de sa théorie de l’échange des femmes, dont elle dit que c’est un concept à la fois « séduisant et fort » et « problématique ». Pourrais‑tu nous dire quelques mots sur la place des études ethnologiques dans le texte de G. Rubin ?
N.-C.M. – Elle est importante. Rubin, qui fut, notons-le, l’élève de Marshall Sahlins, présente de façon très didactique (c’est pourquoi, je le répète, sa lecture serait une bonne introduction pour les étudiants) ce qu’est la parenté dans les sociétés traditionnelles, en quoi elle s’articule avec l’économie, la religion, le prestige et le pouvoir, etc. ; elle rappelle la théorie du don chez Mauss, fait appel à la critique d’Edmund Leach Rethinking Anthropology, signale l’intérêt, pour un approfondissement de l’étude des systèmes de sexe/genre, des travaux alors récents de Jack Goody et S.J. Tambiah sur Bridewealth and Dowry, etc., sans parler des nombreux exemples ethnographiques qu’elle utilise.
En ce qui concerne « l’échange des femmes », il n’est pas possible, ni souhaitable, de résumer en quelques mots l’analyse de Rubin, notamment sur les différentes modalités de l’échange et d’autres formes de trafic des femmes. Citons seulement cette phrase :
« “Échange des femmes” est une formule rapide pour exprimer que les rapports sociaux d’un système de parenté spécifient que les hommes ont certains droits sur leurs parentes femmes, et que les femmes n’ont pas les mêmes droits, ni sur elles-mêmes ni sur leurs parents hommes. En ce sens, le concept d’échange des femmes représente une profonde perception d’un système dans lequel les femmes n’ont pas de pleins droits sur elles-mêmes. L’échange des femmes devient un outil d’obscurcissement s’il est vu comme une nécessité de la culture, et lorsqu’on l’utilise comme seul instrument d’analyse dans l’approche d’un système donné de parenté. »
Au constat que les femmes n’ont pas de pleins droits sur elles‑mêmes, alors que les hommes en ont beaucoup sur elles, des ethnologues pourraient répondre : on le sait (en réalité ils n’y avaient jamais pensé), elle ne dit rien de nouveau… Ce qu’il y a là de nouveau, c’est l’angle de vision de la minoritaire qui fait voir l’implicite des textes. Cet angle de vue permet aussi de poser de nouvelles questions, qui ne sont pas seulement spéculatives ; par exemple, cette interrogation de Rubin à propos du mariage : « Que se passerait-il si notre femme hypothétique, non seulement refusait l’homme auquel elle était promise, mais demandait une femme à la place ? ».
Lévi-Strauss, sensible à certaines inquiétudes, avait voulu rassurer les femmes en disant que « le jeu serait le même » si on considérait que les femmes échangent entre elles des hommes. Disons que la question est moins d’inverser les rôles que de saisir pleinement qui supporte le poids du « jeu » dans la majorité des sociétés, et s’il est imaginable d’en sortir. C’est ce que fait Rubin, et vers la fin de l’article elle entreprend d’ailleurs de distinguer, à partir d’exemples concrets, différents types de contrainte et ou d’autonomie relative qui peuvent peser sur les femmes selon les modalités de l’échange matrimonial.
C.Q. – La remarque de Lévi-Strauss à laquelle tu viens de faire allusion était dans son article de 1956 sur « La famille ». Tu disais au début que G. Rubin avait tiré de l’exégèse de cet article des conclusions radicales…
N.-C.M. – A ce propos, je ne sais pas si Claude Lévi-Strauss a jamais eu connaissance de l’article de Rubin ou s’il a pressenti les déductions « radicales » qu’on pourrait tirer du sien, mais j’ai noté que c’est avec beaucoup d’hésitations (exprimées dans la préface, p. 12) qu’il a accepté de le republier en 1983 dans Le regard éloigné, sous forme remaniée par rapport à la traduction française de 1971. Selon lui, ce texte serait « assez platement didactique » et reposerait sur « une base documentaire […] qui aujourd’hui a vieilli ». (Il lui reconnaît cependant un intérêt épistémologique pour faire comprendre « à des lecteurs supposés novices » la nature des liens sociaux – notamment qu’« il faut percevoir au départ les relations comme des termes, et les termes eux-mêmes comme relations ».)
Pour en revenir à Gayle Rubin, de même qu’elle voyait dans le concept d’échange des femmes l’avantage qu’il enracine leur oppression dans le social et non dans la biologie, elle estime que dans cet article ultérieur de Lévi-Strauss, « toutes les formes manifestes du sexe et du genre sont vues comme instituées par les impératifs des systèmes sociaux ». Rappelons que Lévi-Strauss y pose la famille et la division du travail comme totalement artificielles : l’institution d’une division du travail entre homme et femme assure, par la dépendance économique ainsi créée, la formation d’un couple familial qui, souligne-t-il, n’est en rien nécessaire à la pure reproduction biologique (qui pourrait se faire en dehors de l’existence d’une famille), mais qui répond par contre à la nécessité sociale de la prohibition de l’inceste (quel que soit son contenu) et de l’échange entre groupes. Pour Rubin, « on impose un genre aux individus afin de garantir le mariage. Lévi-Strauss est dangereusement près de dire que l’hétérosexualité est un processus institué »…
Et, dans un passage sur la parenté mais où s’annonce également ce qu’elle dira des effets de la clinique psychanalytique, elle pose les déductions suivantes : « De plus, le tabou de l’inceste présuppose l’existence d’un tabou antérieur et moins explicite sur l’homosexualité. Une prohibition portant sur certaines unions hétérosexuelles suppose un tabou sur des unions nonhétérosexuelles. Le genre n’est pas seulement l’identification à un sexe ; il entraîne aussi que le désir sexuel soit orienté vers l’autre sexe. La division sexuelle du travail entre en jeu dans les deux aspects du genre – elle les crée homme et femme, et elle les crée hétérosexuels. Le refoulement de la composante homosexuelle de la sexualité humaine, avec son corollaire, l’oppression des homosexuels, est par conséquent un produit du même système qui, par ses règles et ses relations, opprime les femmes. »
J’espère que les lecteurs auront le souci d’aller lire le détail de l’argumentation car il est très gênant, pour un texte aussi riche et complexe, et soucieux des variations concrètes, de ne citer ainsi que des « formules » générales. Mais on peut déjà voir le lien, 25 ans après, avec les remises en cause du mariage et de la filiation sous leur forme traditionnelle qui agitent présentement les sociétés occidentales.
Pour citer cet article :
Catherine Quiminal , « Entretien avec Nicole-Claude Mathieu (EHESS) Un hommage critique à Lévi-Strauss et Freud : Gayle Rubin (1975) », Fédération de recherche sur le genre RING, 13 mars 2014. URL : http://www2.univ-paris8.fr/RING/spip.php?article3372
Notes
[1] Gayle Rubin, 1975. « The Traffic in Women : Notes on the “Political Economy” of Sex », in Rayna R. Reiter (ed.), Toward an Anthropology of Women. New York and London, Monthly Review Press : 157-210. Trad. franç. par N.-C. Mathieu avec la collaboration de G. Pheterson, sous le titre : « L’économie politique du sexe : Transactions sur les femmes et systèmes de sexe/genre », Cahiers du CEDREF, 7-1998, université Paris VII – Denis Diderot, 1999. Ce texte est disponible auprès du CEDREF, case postale 7132, 2 place Jussieu, 75521 Paris Cedex 05, au prix de 50 F (port en sus 13 F).
[2] « Critiques épistémologiques de la problématique des sexes dans le discours ethno-anthropologique » (1985), publié in N.-C. Mathieu, 1991, L’Anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe. Paris, Editions Côté-femmes.
[3] Étaient également au programme de cette journée des communications de Zarana Papic, Françoise Héritier, Chantal Collard et Jeanne Favret‑Saada. Cette dernière est (re)publiée dans le présent numéro du Journal des anthropologues. La communication de F. Héritier présentait, sur la « valence différentielle des sexes », certains aspects de son article (« Articulations et substances ») paru depuis dans L’Homme, 154-155 (Question de parenté), avril-sept. 2000. Celle de Ch. Collard, montrant que des groupes composés d’acteurs des deux sexes peuvent échanger soit des femmes soit des hommes, soit les deux, est développée dans son article « Femmes échangées, femmes échangistes. A propos de la théorie de l’alliance de Claude Lévi‑Strauss » paru dans le même numéro de L’Homme, où il est suivi d’un « Commentaire » (critique) de F. Héritier : « A propos de la théorie de l’échange ».
[4] « La sexualité féminine et l’origine de la société », Les Temps modernes, 598, 1998. Précédemment publié dans le quotidien La Repubblica du 3.11.1995, sous le titre « Quell’intenso profumo di donna ».
[5] « Les mains, les outils, les armes », L’Homme, XIX, 3-4, 1979. Republié in P. Tabet, La Construction sociale de l’inégalité des sexes. Des outils et des corps. Paris, L’Harmattan, 1998.
Fichiers de syndication :
Statistiques :
Le site contient 4383 articles