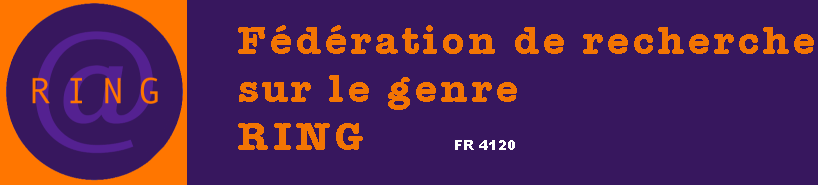Compte rendu
Nicole-Claude Mathieu, L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe
par Huguette Dagenais
Texte paru dans dans la revue Recherches féministes, vol. 5, n° 1, 1992, p. 179-183.
Nicole-Claude Mathieu, L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe. Paris, côté-femmes, 1991, 293 p.
Le hasard a voulu que ce compte rendu de L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe paraisse dans le numéro de Recherches féministes consacré aux femmes de la francophonie et c’est heureux car ce recueil constitue, comme on le verra, un apport théorique important pour la recherche féministe francophone. Certes, pour les chercheuses de ma génération et en particulier pour les anthropologues, sociologues et autres spécialistes en sciences sociales, les travaux de Nicole-Claude Mathieu se passent de présentation puisqu’ils sont, depuis de nombreuses années déjà, des sources intarissables d’inspiration et des références incontournables. Néanmoins, c’est une heureuse initiative qu’ont prise les éditions côté-femmes en réunissant ainsi six textes de cette auteure, publiés aux cours des deux dernières décennies (de 1971 à 1989) et qui n’étaient pas tous faciles d’accès (voir en particulier les chapitres 1 et 4), même pour les chercheuses des sciences sociales. Mais comment rendre compte adéquatement d’un tel ouvrage ? Comment résumer sans la trahir une pensée aussi complexe, aussi rigoureuse et aussi cohérente que celle de Nicole-Claude Mathieu ? Je vais tout de même relever le défi, en suivant l’ordre et l’organisation du livre, avec l’espoir que les limites mêmes de ce compte rendu constitueront un encouragement à la lecture du livre, à la prise de contact direct avec la pensée de l’auteure.
Le titre, tout d’abord, mérite un commentaire. On ne pouvait, en effet, trouver pour ce recueil de titre plus descriptif du travail scientifique de Nicole- Claude Mathieu au cours de ces vingt dernières années, à savoir la démonstration patiente que le sexe est social, un produit idéologique des rapports sociaux/politiques concrets de nos sociétés, et qu’il doit de ce fait être traité non pas comme un donné, une évidence biologique, mais comme une catégorie sociologique.
Le livre est divisé en deux grandes parties. La première, ayant pour titre « Le sexe, évidence fétiche ou concept sociologique ? », se veut une « critique interne » du discours scientifique. Elle comprend quatre textes, dont le premier est devenu un classique des cours de théorie féministe. Il s’agit de « Notes pour une définition sociologique des catégories de sexe », un article paru en 1971, qui devance de plusieurs années les ouvrages théoriques et les « études sur les femmes » ou Women’s Studies que l’on connaît actuellement. Après avoir montré que les trois variables « fondamentales » utilisées dans les recherches empiriques, à savoir le sexe, l’âge et la classe sociale, « ne bénéficient ni de la même rigueur quant aux critères sociologiques de leur définition, ni du même statut au sein de la sociologie générale quant à la systématisation de leur problématique » (p. 18), l’auteure examine le discours scientifique autour des catégories de sexe et met en évidence les « distorsions » que celles-ci subissent au niveau des concepts et du langage. Sa conclusion à l’effet qu’« il reste à élaborer une problématique sociologique des sexes » (p. 41) ouvrit la voie aux nombreuses recherches féministes réalisées depuis mais demeure —malheureusement— toujours d’actualité aujourd’hui.
Les deux chapitres suivants poursuivent la critique entreprise dans le premier. Le chapitre 2 ( « Homme-culture et femme-nature ? ») examine la différence dans le traitement appliqué aux deux catégories de sexe, à partir d’un article de l’anthropologue Edwin Ardener portant sur « La croyance et le problème des femmes ». Ce « problème », selon Ardener, en est un de « non-verbalisation » (inarticulateness) : les femmes, selon lui, « "ne parlent pas", ou refusent de parler, sur le terrain » (p. 45). Mathieu soulève, à propos de l’interprétation de ce prétendu mutisme des femmes, des questions méthodologiques qui s’adressent à toutes les chercheuses (et chercheurs), en particulier celles (et ceux) qui travaillent avec des personnes et sont appelées à interpréter des comportements. Ces questions concernent, comme au chapitre précédent, les « évidences à clarté trompeuse » de la dichotomie sexuelle basée sur la biologie alors qu’au contraire, pour échapper à ce type de pensée « fixiste », il y a, rappelle l’auteure, « nécessité d’étudier le système social des sexes, comme on étudie le système économique, ou religieux, ou politique, etc. » (p. 60).
Dans le chapitre suivant, intitulé « Paternité biologique, maternité sociale... De l’avortement et de l’infanticide comme signes non reconnus du caractère culturel de la maternité », Mathieu s’attaque plus spécifiquement à « l’évidence "naturelle" de la maternité » et à l’« obnubilation » sur le lien biologique mère- enfant, qui ont pour conséquence que « le véritable sujet social de la maternité est l’enfant non la femme ». L’auteure critique principalement ce qu’elle appelle « la littérature socio-ethnologique dominante » et « l’impression de fatalité biologique pesant sur elle [la femme] et sur elle seule » qui s’en dégage, mais elle aborde aussi les « a priori inconscients » qui sous-tendent les interprétations psychanalytiques des rapports sociaux de sexe.
Elle poursuit la même démarche, en l’élargissant et en la complexifiant considérablement, dans le chapitre suivant où elle procède, comme le titre l’indique, à des « Critiques épistémologiques de la problématique des sexes dans le discours ethno-anthropologique ». Après un bref historique des premières publications collectives, du développement des « études des/sur les femmes » et une définition, claire et complète, de l’androcentrisme, Mathieu procède au « démontage précis des mécanismes de l’androcentrisme de la recherche, dont les deux principaux sont la sur-visibilisation des femmes par les explications à tendance naturaliste, et leur invisibilisation » en tant qu’actrices sociales. Comme elle le souligne dans l’« Introduction », ces mécanismes jouent « à tous les niveaux de l’analyse [...] ; dans tous les domaines d’étude [...] ; et dans toutes les tendances méthodologiques [...]. Ils demeurent d’actualité » (p. 10). Ce chapitre se termine par des réflexions sur l’appartenance de sexe de l’ethnologue, c’est-à-dire « ce que sa position d’homme ou de femme [dans le champ des rapports de sexe] lui permet de connaître respectivement, et de l’oppression exercée, et de l’oppression subie » (p. 126), réflexions qui concernent les chercheuses et chercheurs de toutes les disciplines.
Comme l’indique le titre qui la coiffe : « Conscience, identités de sexe/genre et production de la connaissance », dans la deuxième partie Nicole- Claude Mathieu met davantage l’accent sur les « sujets », les actrices et acteurs, c’est-à-dire aussi bien ceux et celles « qui écrivent » la pièce, en l’occurrence les ethnologues, que « les personnages » qu’ils et elles construisent, et les « modèles réels » — les « ethnologisé-e-s » —, en se demandant à chaque fois « quels mécanismes, quels intérêts, quelles stratégies, conscientes ou inconscientes, politiquement implicites ou explicites, les animent » (p. 7). Les titre et sous-titre du chapitre V, le plus volumineux du livre, sont d’ailleurs des plus explicites : « Quand céder n’est pas consentir. Des déterminants matériels et psychiques de la conscience dominée des femmes, et de quelques-unes de leurs interprétations en ethnologie ». Dans ce chapitre, l’auteure expose le fonctionnement et les effets théoriques et politiques de postulats comme ceux du « consentement des dominé(e)s à la domination » et de la « fausse symétrie de la conscience entre dominants et dominé(e)s ». La première partie du texte (« Préambules sur soi et les autres ») contient une mise au point essentielle (mais combien courageuse actuellement au sein de la discipline ethno-anthropologique) concernant les accusations « d’ethnocentrisme, d’impérialisme, et même de racisme », proférées à l’égard des anthropologues féministes et des féministes occidentales en général, lorsqu’elles osent parler de l’oppression des femmes dans d’autres sociétés que la leur. L’auteure montre que, s’il faut éviter l’impérialisme culturel, il faut pouvoir également reconnaître la part d’ethnocentrisme, d’androcentrisme et de mauvaise foi que peuvent contenir de telles accusations. La deuxième partie (« La part réelle de l’idéel, pour les femmes ») s’intéresse aux « limitations de la conscience que les femmes peuvent subir » (p. 154) du fait de contraintes physiques et du partage inégal des connaissances entre dominants et dominées. Les nombreux exemples qui illustrent la démonstration sont empruntés à des sociétés « très diverses, mais essentiellement patrilinéaires et patri-viriarcales », et même « homogènement viriarcarles ». Ils doivent être compris, précise Mathieu, comme « une ébauche de guide de lecture et d’interprétation, comme des questions à se poser pour chaque société » et « non comme des "vérités universelles" » (p. 155). Enfin, dans la troisième et dernière partie de ce chapitre (« Du "consentement" des dominé(e)s ? »), l’auteure procède à une critique épistémologique des concepts en cause, à savoir ceux de violence, consentement et collaboration, de domination et oppression, et en souligne les conséquences politiques pour les dominées et dominés. Le chapitre qui s’était ouvert par une citation de Maurice Godelier, un des anthropologues les plus influents des vingt dernières années, à l’effet que « [...] de deux composantes du pouvoir, la force la plus forte n’est pas la violence des dominants mais le consentement des dominés à leur domination [...] », se termine par le rappel que « parler de consentement à la domination rejette de fait, une fois de plus, la culpabilité sur l’opprimé(e) », rappel illustré par une autre citation, sarcastique cette fois mais non moins éloquente, du poète Henri Michaux (« Ils tenaient seulement à le tirer par les cheveux. Ils ne voulaient pas lui faire de mal. Ils lui ont arraché la tète d’un coup. Sûrement, elle tenait mal. Cane vient pas comme ça. Sûrement il lui manquait quelque chose »).
Dans le sixième et dernier chapitre du recueil (« Identité sexuelle/sexuée/de sexe ? Trois modes de conceptualisation du rapport entre sexe et genre »), Mathieu présente successivement trois façons de conceptualiser le rapport entre sexe et genre et les trois types d’identité personnelle correspondants, en précisant bien, toutefois, que l’ordre dans lequel elles sont exposées « ne correspond pas forcément à une évolution historique linéaire ». Dans le mode de conceptualisation I, il y a « bipartition absolue du sexe, à la fois naturelle et sociale » : le genre (sexe social) traduit le sexe (biologique) et l’on peut parler d’« identité sexuelle ». Selon elle, « une grande partie de la psychologie et de la psychanalyse est encore à placer dans ce mode de conceptualisation » (p. 232). Dans le mode II, « le genre symbolise le sexe » ; même si « les deux groupes sociaux continuent d’être pensés comme clos sur le biologique », on s’intéresse davantage à « l’expression dans le social de la différence biologique, à l’élaboration culturelle de la différence ». C’est, précise-t-elle, la problématique de la « complémentarité sociale et culturelle des sexes », actuellement majoritaire en psychosociologie, sociologie, anthropologie. On y traite des « relations "entre" les sexes, des "rôles de sexe" » et de « la construction du genre ». L’identité correspondante est l’« identité sexuée — le participe passé marquant la reconnaissance d’une action, d’une élaboration faite par le social sur le biologique [...] d’une section (sexion) de la catégorie du sexe en deux catégories sociales de sexe » (p. 239). Quant à la conscience correspondante, c’est une conscience de groupe, avec référence à une « culture de groupe », contestée ou valorisée, ou les deux à la fois, comme on peut l’observer dans les tendances du « féminisme culturel » et du « lesbianisme culturel » (p. 240). Dans le mode III, au contraire, « la bipartition du genre est conçue comme étrangère à la "réalité" biologique du sexe (qui devient d’ailleurs de plus en plus difficile à cerner) [...]. Et c’est l’idée même de cette hétérogénéité [...] qui amène à penser [...] que le genre construit le sexe ». On passe donc « de l’idée de différence à celle de différenciation sociale des sexes, de construction sociale de la différence » ou, en d’autres mots, « de la construction culturelle du genre vers la construction culturelle du sexe, et particulièrement de la sexualité » (p. 255- 256). C’est pourquoi, selon Mathieu, « on peut appeler identité "de sexe" la conscience de classe qui correspond au mode III dans les mouvements de femmes (tendances féministes radicales [françaises] et lesbiennes politiques) » (p. 259).
Ce dernier chapitre est probablement le plus difficile de tout le livre, même pour les personnes familières avec ces questions et avec les débats actuels autour de la notion de « genre ». Mais après une discussion théorique, plus abstraite que dans les chapitres précédents, les précisions qu’apporte l’auteure en conclusion, concernant « le fonctionnement asymétrique du genre en fonction du sexe, y compris dans les transgressions apparentes » [des normes culturelles (homosexualité, travestisme, transsexualisme, « troisièmes sexes »)], nous ramènent, comme toujours avec Nicole-Claude Mathieu, aux rapports sociaux concrets.
Comme on peut le constater, même si à la lecture de ce livre les anthropologues et les sociologues se retrouveront en compagnie d’auteures et d’auteurs connus et de thèmes familiers, la portée des questions théoriques et épistémologiques qui y sont traitées déborde amplement le cadre de ces deux disciplines. Quelle féministe ne s’est pas trouvée un jour à court d’arguments devant des discours biologisants ou fonctionnalistes, des accusations d’ethnocentrisme ou la négation de l’oppression des femmes sous prétexte que celles-ci tirent certains « avantages » de leur situation ? De plus, alors que les forces de droite reprennent de plus belle leurs luttes contre l’avortement, on assiste actuellement à un inquiétant retour de balancier par lequel certaines féministes en viennent à adopter des positions essentialistes, à revendiquer la différence, bref les assises idéologiques mêmes de l’opppression des femmes, objets des premières luttes et des premiers textes théoriques féministes dans les années 1960. Ce livre de Nicole-Claude Mathieu arrive donc à point. Les analyses critiques et en profondeur de l’auteure, échelonnées sur les deux premières décennies de recherches féministes, rappellent, exemples à l’appui, que, pour éviter de reproduire les idéologies oppressives du passé, il faut en conserver lucidement à la mémoire les conséquences théoriques, épistémologiques et surtout politiques, à la fois pour les femmes et pour la connaissance scientifique.
Je ne voudrais pas, cependant, conclure sans préciser que la lecture de ce livre est loin d’être aride, même si, je le reconnais, le texte est « tricoté serré », comme on dit au Québec. C’est qu’à la rigueur de la démonstration, l’auteure allie une passion profonde pour la cause féministe et, parfois, un humour caustique, décapant, comme on dit encore au Québec. Cette passion et cet humour se manifestent non pas par une inflation verbale mais, au contraire, dans un choix, une précision et une économie exemplaires des mots. Tout en déplorant que l’ignorance du français et/ou le sectarisme — pour ne pas dire l’arrogante suffisance — empêchent beaucoup de féministes anglophones de tirer profit d’une contribution théorique aussi importante (comme d’ailleurs de la contribution des féministes matérialistes françaises et francophones en général), on ne peut que se réjouir, encore une fois, que le premier ouvrage publié dans la collection « Recherches » de la maison côté-femmes (qui promet pour bientôt un livre de Colette Guillaumin) soit ce recueil de travaux de Nicole-Claude Mathieu.
Huguette Dagenais
Département d’anthropologie
Université Laval
Pour citer cet article :
Huguette Dagenais , « Compte rendu Nicole-Claude Mathieu, L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe », Fédération de recherche sur le genre RING, 13 mars 2014. URL : http://www2.univ-paris8.fr/RING/spip.php?article3371
Fichiers de syndication :
Statistiques :
Le site contient 4383 articles