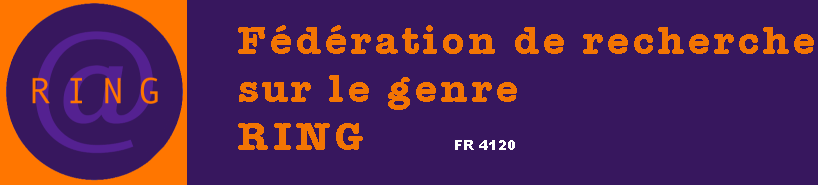Le philosophe travesti ou le féminin sans les femmes
par Francoise Collin
Texte paru dans la revue Futur Antérieur, numéro spécial "Féminismes au présent", avril 1993.
Télécharger ce(s) document(s) :
J’analyserai « les formes de l’antiféminisme contemporain », telles qu’elles se manifestent non dans la pratique sociale mais dans le discours, et plus précisément dans le discours philosophique (puisque c’est ce qui m’avait été demandé par les organisateurs et organisatrices de ce Colloque). J’éprouve cependant quelque scrupule à prendre pour cible principale le discours philosophique : il me semble qu’il ne mérite « ni cet excès d’honneur ni cette indignité » car il y a dans le social, - même si l’on s’en tient à l’ordre du discours - des formes d’antiféminisme plus graves et surtout de plus de conséquence que celui-là. Pourtant la forme même prise par ce qu’on peut nommer l’antiféminisme en philosophie - et qui est ici qualifiée de travestissement - pourrait peut-être faire symptôme pour l’analyse d’autres discours qui n’ont pourtant avec le premier qu’un rapport lointain, voire antithétique : le discours médiatique, le discours politique, le discours de sens commun.
De la négation à la dénégation [1]
Mon propos pourrait s’éclairer de cette hypothèse que si les anciennes formes d’antiféminisme n’ont pas disparu - celles où il se formulait à visage découvert sur le fond d’une pesante misogynie -, une autre, plus diffuse, plus complexe aussi s’y substitue. Et c’est en ce sens que j’interpréterai la formule « antiféminisme », qui préside à cette rencontre : non plus comme dénigrement direct des femmes, mais comme esquive de ce que supporte le féminisme, à savoir la dimension politique qui habite les rapports de sexes même si elle ne les épuise pas. Cette hypothèse qui pourrait être éprouvée sur l’ensemble des pratiques discursives ne le sera donc ici que sur l’une d’entre elles.
Le discours traditionnel, philosophique et théologique autant que littéraire, relevé aussi par celui de la science et partagé par le sens commun, a longtemps affirmé que les femmes sont inférieures aux hommes. Ou que tout au moins elles sont d’une nature autre que celle des hommes, nature qui les rend inaptes aux responsabilités publiques, à l’invention et à la création et les confine dans le domaine privé de la reproduction et de l’entretien de la vie, ou encore dans les fonctions subsidiaires de services. Les citations de penseurs éminents de ce sexisme tranquille sont innombrables, et proprement effarantes. Elles font écho à une situation effective où pendant longtemps les femmes sont exclues de la scène publique comme d’ailleurs des institutions de savoir ou des activités professionnelles qualifiées. Tous les arguments sont bons pour soutenir cette position, qu’il s’agisse de l’incapacité intellectuelle et mentale, de la fragilité physique, ou de la vocation maternelle des femmes.
La Révolution française, et l’avènement de l’ère dite démocratique éclairée par la Déclaration des droits de l’homme ne mettra pas fin à cette tradition. Tout au plus, l’inégalité sera-t-elle désormais camouflée sous les termes de la complémentarité. La citoyenneté proclamée n’inclut en effet pas les femmes dans ce qu’on nommera le « suffrage universel ». Elle en consolide plutôt l’exclusion, comme l’avait fait la démocratie grecque.
Ce tableau est certes schématique et caricatural. Il y a mille manières plus ou moins subtiles ou plus ou moins outrancières, de décliner cette position, et d’y apporter des nuances. Mais leur horizon général est celui d’une « métaphysique des sexes » qui distingue les hommes des femmes au sein de l’humanité, les hommes étant d’ailleurs les représentants de l’universel et les femmes du particulier, les femmes du côté de la nature, les hommes du côté de la raison. La différence est toujours pensée dans l’inégalité. Et les pensées de l’égalité, pour ne pas contrevenir à leur présupposé affirmeront qu’il ne s’agit pas d’inégalité mais de spécificité.
L’argumentation qui prétend étayer ces affirmations prend la forme d’un cercle vicieux. En effet, le principe s’appuie sur le fait, et le fait obéit au principe : les femmes sont déclarées incapables de certaines fonctions puisqu’elles ne les exercent pas, et elles ne peuvent les exercer puisqu’elles en sont rendues incapables. Certains cependant, pressentant que la réalité pourrait venir démentir leurs affirmations, ou constatant que ces affirmations sont déjà démenties au moins par des exceptions, se démasquent en déplaçant l’argumentation. Ils affirment alors non pas qu’il est impossible mais qu’il serait dangereux pour « la » société que les femmes sortent de la place qui leur est assignée, sans préciser que ce serait dangereux non pour la société comme telle mais pour la société qui repose sur leur sujétion, ce qui est une tautologie. Souvent d’ailleurs les arguments de l’incapacité et de la dangerosité, pourtant contradictoires, se superposent chez le même penseur.
Mais je ne m’attarderai pas à l’analyse de ces formes d’antiféminisme, qui ont été analysées par les critiques féministes du discours philosophique [2]. Les femmes au cours des siècles ont su peu à peu démentir ces énoncés en s’affirmant et en conquérant progressivement des espaces qui avaient été déclarés inaccessibles à leur nature. Notre objet est plutôt de traquer les formes actuelles, plus subtiles, de ce qu’on peut appeler l’antiféminisme en philosophie - ou plus exactement dans un courant philosophique - aujourd’hui.
Il faut sans doute préciser d’abord que les penseurs que nous pourrons évoquer sont loin d’être les plus misogynes ou les plus étrangers au féminisme. Certains d’entre eux ont au contraire l’avantage de s’être interrogés, voire d’avoir dialogué avec le féminisme ou des féministes. Mieux encore, un courant important de la pensée féministe, surtout aux États-Unis a cru, et non sans quelque justification, trouver en eux des aliments majeurs pour sa réflexion. Le terme d’antiféminisme dans ce contexte doit donc être nuancé. Il signera que ces pensées philosophiques, intéressées voire animées par le thème du féminin et parfois du maternel, éludent dans leurs analyses la dimension politique qui affecte les rapports entre les hommes et les femmes comme groupes sociaux, même en supposant que cette dimension n’en épuise pas l’effectivité. Car c’est bien cela que, au minimum, les féministes de toutes tendances et de toutes opinions, dans leurs désaccords mêmes, soutiennent en commun, à savoir que dans la réalité la différence des sexes est structurée par la domination, et que celle-ci peut et doit être dépassée, quelque idée que les unes et les autres se fassent de cette différence. Et je rappelle rapidement que pour les unes, qu’on a nommées essentialistes le dépassement de la domination doit laisser subsister la différence des sexes, en renforçant l’apport du féminin propre aux femmes, tandis que pour les autres, les rationalistes, qui se sont parfois désignées comme radicales, le dépassement de la domination serait en même temps l’extinction de la différence. Je ne m’attarderai pas sur ces distinctions, ni sur ce débat, interne à la pensée féministe, qui n’est pas ici mon objet. Car les unes et les autres revendiquent au moins pour les femmes le droit à l’autodétermination, ou encore à l’égalité, celle-ci étant pour les unes l’égalité dans la différence, pour les autres l’égalité dans l’identité d’une unique raison. J’aborderai plutôt ici le courant, nommé aux États-Unis déconstructionniste et en France postmétaphysique, qui pense la différence, et la différence des sexes, comme une différance, selon le terme forgé par Derrida, un perpétuel différer, irréductible au deux (il y a un propre des femmes et un propre des hommes) - soutenu par les essentialistes - comme au un (il n’y a qu’une manière d’être humain) - soutenu par les rationalistes.
Le féminin comme métaphore de l’être-au-monde
Si, comme nous l’avons évoqué, la tradition philosophique fourmille, même chez les plus grands, d’énoncés plus idéologiques que rationnels concernant l’infériorité naturelle des femmes, on peut considérer que ces énoncés se sont raréfiés (ou ont à peu près disparu) dans la philosophie contemporaine - celle du moins de la deuxième moitié de ce siècle -, et s’en réjouir. Il apparaît plutôt que dans tout un courant de la pensée contemporaine, désigné comme post-métaphysique ou encore comme post-moderne, encore que ces deux termes ne s’identifient pas, le « féminin » occupe désormais une place privilégiée. Ce courant effectue en effet une critique radicale de l’idée d’un Sujet susceptible, par la connaissance et par l’action, d’exercer sa maîtrise sur l’objet : sur le monde et sur l’autre. Les motifs qui trament cette pensée sont bien au contraire ceux de l’altération, de la réceptivité, de la passivité, de la vulnérabilité, de l’inadéquation de soi avec soi, du laisser être, de la dissémination, de la déconstruction. Et la psychanalyse apporte sa contribution à cet ébranlement dans la mise en cause de la prétention du Sujet à sa propre transparence. La pensée philosophique a cessé depuis longtemps de présenter la vérité comme conformité du sujet et de l’objet, maîtrise de l’objet par le sujet dans le registre d’une logique duelle (que la critique féministe assimile trop souvent indûment à « la » philosophie et qu’elle dénonce comme masculine). Et elle a enterré avec Marx, ou du moins avec un certain marxisme, la version historiciste de la métaphysique : l’illusion d’une humanité marchant d’un même pas vers son adéquation avec elle-même, sa réconciliation avec son essence, dans un progrès continu. La vérité n’a plus prétention totalisante. Et la science elle-même est aujourd’hui pensée de manière beaucoup plus hypothétique et fragmentaire qu’à l’époque du positivisme.
Cette mise en question, interne à la philosophie, de ce qu’on nomme alors le logocentrisme, est explicitement liée à la mise en question de la maîtrise phallique dans le terme forgé par Derrida : le « phallogocentrisme ». Désormais, mais je schématise, les dimensions traditionnellement caractérisées comme féminines deviennent les dimensions de l’être au monde humain, et des métaphores féminines viennent émailler le discours philosophique. Il y a résistance du non-un à la prétention de l’Un, déconstruction de l’Un par le non-un. Mais le féminin, bien que linguistiquement prélevé sur les femmes, n’est toutefois pas ici pris comme une qualification des seules femmes [3], ainsi que le défendent pour leur part les penseuses féministes dites essentialistes. La déconstruction n’est pas le mode de penser propre aux femmes, et la différence effective des sexes est d’ailleurs déclarée indécidable autant qu’incontournable. La critique de l’Identité, fût-ce comme processus d’identification, emporte une critique des identités sexuées. Femme ou Homme ne sont pas des concepts mais des « fétiches ».
Ce type de pensée est d’un intérêt et d’une fécondité certaines. Mais en recourant à la notion de féminin, fût-ce pour la distinguer de la féminité traditionnelle, ou même pour révoquer celle-ci, elle crée l’illusion d’aborder la question des femmes, de la réalité effective des femmes, alors qu’il n’en est rien - et que tel n’est d’ailleurs pas son projet. La mise en évidence de la dimension du féminin, et de son cortège de connotations (altération, réceptivité, non-un, dissémination, etc.) laisse hors de son champ la question des rapports effectifs entre hommes et femmes au sein d’un même monde. Elle la laisse dans l’ombre tout en ayant l’air de l’aborder. Ainsi, dans ces textes philosophiques, le jeu des catégories du féminin et du phallique, ou de la virilité, crée une scénographie qui n’a qu’un rapport lointain avec la situation des hommes et des femmes. En contestant le dualisme des sexes, au profit de leur indécidabilité, on recouvre plutôt qu’on affronte ce dualisme effectif.
Je ne mets pas ici en question une conception de la différence des sexes qui récuse leur dualisation en essences ou en identités tranchées et distinctes. Bien au contraire, je suivrais volontiers Derrida par exemple dans sa dénonciation de toute métaphysique des sexes, de toute définition essentialiste, moniste ou dualiste des sexes. Il est vrai qu’il y a de la différence des sexes mais qu’elle est de l’ordre de l’irreprésentable en ce sens qu’il est impossible de définir ce qu’est un homme, ce qu’est une femme, ce qui équivaudrait d’ailleurs à normativer l’existence des hommes et des femmes. Ce qui me paraît toutefois plus gênant ou insuffisant dans ce type d’approche, c’est qu’elle élude le fait que la domination d’un sexe sur l’autre a précisément produit ce dualisme, qui est inscrit dans le fonctionnement social et culturel, et qu’on ne peut croire l’effacer en le critiquant au seul niveau des catégories. Affirmer qu’ontologiquement la différence des sexes ne relève ni du un ni du deux, que le un ou le deux la nient plutôt qu’ils ne la pensent, ne permet pas d’escamoter le fait qu’elle est culturellement inscrite et appréhendée dans la dimension du deux ou de l’un.
A la limite, dans cette perspective, c’est le penseur homme qui occupe désormais la position féminine et c’est la féministe femme, elle qui croit encore au progrès, imagine pouvoir changer le monde, et revendique l’égalité dans la « platitude démocratique », qui se voit renvoyer une image phallique. Si le féminin devient valable, si la vérité se fait femme, alors le philosophe homme se déclare féminin, se pare pour ainsi dire du féminin, en récusant la logique des contraires.
Je n’éclairerai ce propos que par un exemple, repris à un commentaire que fait Derrida d’un texte de Maurice Blanchot, La folie du jour. Dans l’univers désenchanté des récits de Blanchot, les personnages de femme ont toujours une force affirmative surprenante [4]. Ainsi, dans La folie du jour, Blanchot écrit : « J’ai pourtant rencontré des êtres qui n’ont jamais dit à la vie, tais-toi, et jamais à la mort va-t-en. Presque toujours des femmes, de belles créatures. Les hommes, la terreur les assiège... » Devant cette mise en valeur des femmes, Derrida s’appuie sur le « presque » du « presque toujours des femmes » pour s’introduire ou introduire les hommes parmi elles : « il est donc plus que probable que, pour autant que je dise oui, oui, je sois femme et belle. Je suis femme et belle... Les genres passent l’un dans l’autre... ’Je’ garde donc la chance d’être femme ou de changer de sexe... » [5].
Mais on peut trouver dans la psychanalyse, et en particulier chez Lacan, des procédures similaires. Certes, la pensée psychanalytique reste, elle, indéfectiblement attachée à l’affirmation du Signifiant phallique - détaché cependant de son identification au pénis - par rapport auquel se déterminent la genèse et la structure constitutives de chacun des deux sexes, à travers les procédures différenciées de la castration (et Derrida lui en fait grief). Mais dans certains textes, tel celui du séminaire Encore, Lacan évoque, pour ce qui concerne la jouissance du moins, un « au-delà du phallus », un « en plus », qui caractériserait les femmes, « une jouissance supplémentaire » et non « complémentaire » : « Ce n’est pas parce qu’elle est pas toute dans la fonction phallique qu’elle y est pas pas du tout. Elle y est pas pas du tout. Elle y est à plein mais il y a quelque chose en plus. » Mais cet « en plus », repéré chez les femmes, est aussitôt déclaré n’être pas exclusif aux femmes : il s’agit plutôt d’une position féminine que peuvent adopter certains hommes, et par exemple les mystiques : « Il y a des hommes qui sont aussi bien que les femmes » écrit ironiquement Lacan. Et puisqu’il vient de débusquer un « en plus » (et non plus seulement un en moins) du côté des femmes, Lacan lui-même s’en crédite aussitôt : « Y ajouter les écrits de Jacques Lacan parce que c’est du même ordre [6]. »
On voit donc bien ici, et de manière qu’on pourrait presque considérer comme caricaturale, comment si femme est positivée, le penseur (masculin) se déclare femme, s’attribue le féminin. Je traduirais vulgairement ce phénomène de la manière suivante : si elles sont bien, j’en suis. Mais cette femme-là, qui est un homme, n’assume pas pour autant les avatars généralement liés à la condition effective des femmes. A la Bourse de Paris, comme de Wall street ou de Tokyo, le féminin d’une femme ne vaut jamais autant que le féminin d’un homme, et la question politique reste entière. On peut même, si on pratique l’art du soupçon, se demander si la valorisation du féminin, aussitôt récupérée par les hommes, n’est pas une nouvelle « ruse » - inconsciente - de leur opération appropriative qui ajoute ainsi aux avantages acquis de la position masculine, ceux qui pourraient être affirmés du côté des femmes. On constate en effet que le franchissement des frontières traditionnelles de la sexuation n’est pas connoté de la même manière pour les uns et pour les autres : un homme s’en accroît, une femme s’en diminue, comme en atteste l’expression toujours péjorative de « femme phallique ». Une femme-homme est d’une moins belle transsexualité qu’un homme-femme, et ne travaille en tout cas pas l’imaginaire philosophique. Les signes ne sont jamais réversibles, et l’indécidable semble à sens unique.
La bissexualité ou plutôt la transsexualité (car la bissexualité impliquerait encore l’existence du deux) du penseur cumule les avantages des deux sexes et évite leurs inconvénients. C’est pourquoi j’ai pu parler de travesti. J’ajouterai que toutes les formules du genre : « nous sommes tous des femmes », de même que « nous sommes tous des juifs » ou « nous sommes tous des immigrés », sont toujours hautement questionnables, car elles dissolvent dans la généralité une situation particulière non partageable parce qu’effectivement non partagée.
Indécidabilité et dualité
Les penseurs qui ont abordé la thématique du féminin l’ont fait dans des contextes philosophiques extrêmement différents qui mériteraient chacun une analyse spécifique qui ne peut être menée ici [7]. Si ce qu’est une femme, ce qu’est un homme, est en effet indécidable, ontologiquement, sous peine de succomber à une nouvelle métaphysique des sexes, homme et femme est cependant socialement et politiquement qualifiable. Naître femme, dans le monde actuel encore, ne nous positionne pas de la même manière que naître homme, et ne nous donne pas les mêmes chances dans la détermination du monde commun, lequel reste toujours défini unilatéralement même quand il devient plus favorable aux femmes. La réflexion qui substitue la confrontation des catégories logiques et ontologiques du masculin et du féminin aux positions effectives des hommes et des femmes, quel que soit son intérêt, élude donc la dissymétrie des groupes sexués qui se rencontrent et s’affrontent dans le réel. On pourrait certes prétendre que de telles considérations empiriques ne relèvent pas des limites du champ philosophique. (Mais on se demandera alors pourquoi la réalité du racisme peut y être nommée et inscrite comme motif fondateur, non celle du sexisme). Dans cette optique philosophique un homme remet en question le phallicisme au moins sous la forme du phallogocentrisme, et ce n’est certes pas négligeable, mais sans remettre en question le rapport effectif des hommes aux femmes. Sans doute faudrait-il pouvoir penser à la fois l’indécidabilité ontologique des sexes, et la dualisation effective des sexes dans l’organisation sociale. Or ici, pour échapper à la dualisation ontologique, on élude l’examen de la dualisation sociopolitique.
Ainsi ce qu’on peut appeler, avec toutes les réserves que j’ai faites, l’antiféminisme de la philosophie contemporaine diffère profondément de l’antiféminisme de la philosophie traditionnelle et doit être analysé à nouveaux frais. Cet antiféminisme ne réside plus dans l’affirmation misogyne d’une nature des femmes inférieure à celle des hommes - même si cette misogynie peut pointer çà et là -, mais plutôt dans l’éviction du problème du rapport hommes/femmes au profit du rapport des catégories, en quelque sorte abstraites, du féminin et du masculin. Ce n’est plus un antiféminisme d’affirmation mais plutôt de recouvrement. En un certain sens l’instance du féminin, comme mode d’être au monde, peut se passer des femmes. La déconstruction ou la dissémination qui vient raturer le règne du logos est illustrée par des écrivains tels que Artaud ou Joyce, et non par des femmes.
L’affirmation de l’indécidabilité de la différence des sexes sert d’ailleurs de point d’appui à une critique plus ou moins poussée du féminisme, à un « antiféminisme » plus ou moins affirmé. En effet, de ce point de vue, le féminisme, en prétendant lutter contre la « phallocratie », en ratifie paradoxalement les termes, en fortifie le dualisme et contribue à maintenir la différence dans le régime de l’opposition : il est « réactif », selon le mot de Nietzsche. En voulant subvertir les rôles, il commence par les reconduire. La lutte de libération se fonde en effet sur un « nous les femmes » (corrélatif d’un « eux les hommes ») qui, selon Derrida, fortifie une métaphysique identitaire, quelque justification qu’on en donne. En ce sens la lutte de libération contredirait plutôt qu’elle n’accomplit la liberté. Sans aller jusqu’à en contester le bien-fondé, Derrida la considère au mieux comme une malheureuse nécessité historique transitoire, au pire comme une trahison de ce qu’elle vise. « Pourquoi ne pas se libérer de cette libération ? » écrit-il [8].
La question est de savoir si le malheur des dominés n’est pas précisément de devoir se définir comme « nous » pour accéder au « je », s’il n’est pas de devoir passer par le registre du deux pour pouvoir l’estomper. S’il est vrai qu’une lutte de libération qui se coupe du rappel de la liberté souveraine risque d’inverser plutôt que de bouleverser le donné, il est vrai aussi que la prétention des dominés au seul exercice de la liberté souveraine risque d’être un leurre mortifère en dehors de la libération. « Si je ne peux pas danser, je ne veux pas en être, de votre révolution », écrivait la féministe anarchiste Emma Goldman, que cite une correspondante de Derrida, Christie Mc Donald [9]. Mais sans votre révolution, est-ce que je pourrai danser ? Est-il vrai qu’on puisse « tout seul, toute seule, résister, s’écarter (pour danser, précisément) d’une certaine histoire dans laquelle on inscrit en général la révolution, ou du moins son "concept"... » [10]. Comment à la fois lutter et « danser » ? Heureux qui, comme le philosophe, peut seulement danser, et danser tout seul. Mais on peut penser que ce que le philosophe prend pour liberté souveraine est souvent solidement étayé par la maîtrise (pour reprendre ici les concepts proposés par Bataille et Blanchot). Il danse. Mais sur quelle musique ?
Déconstruction et juxtaposition
Cette évocation des ressources et des limites de la pensée de la déconstruction, qui critique cette pensée pour sa non-prise en compte de la réalité sociale effective, pour son éviction de la dimension politique dans le traitement de la différence des sexes, pourrait surprendre le public américain qui semble au contraire y avoir trouvé un aliment non seulement philosophique mais aussi politique. C’est que, effectivement, la lecture et l’interprétation française d’une part, américaine de l’autre, de la pensée déconstructionniste, et surtout l’usage qui en est fait, sont profondément différentes, et l’engouement longtemps acritique d’un courant important des féministes américaines pour la pensée derridienne a toujours surpris les féministes françaises.
On peut toutefois comprendre ce qui, dans l’interprétation américaine, a pu être tiré du côté du politique. Si la réalité est textuelle, si elle se déploie comme un système de signifiants, toujours différant, mais sans Signifiant Maître, s’il n’y a pas d’Un auquel référer les autres, pas de centre auquel ramener les bords, pas de maître mot, pas de mesure mesurant tout ce qui est (« si le centre est partout et la circonférence nulle part » comme disait Pascal) toute maîtrise perd son fondement, tout privilège est irrecevable. Et tous les discours se valent en quelque sorte. Le système hiérarchique s’effondre. Le phallo-centrisme, et le phallogocentrisme comme le formule Derrida lui-même, est caduc.
Au discours maître, au « canon » ratifié par la tradition ethno- et occidentalo-centriste peut alors se substituer la prolifération égalitaire des discours jusque-là refoulés. La stratégie actuelle du « politically correct » qui réclame l’introduction dans l’université des discours antérieurement considérés comme mineurs, et traditionnellement minorisés, ou même complètement occultés, sur le même plan que le discours majoré par la tradition, peut en ce sens se revendiquer du déconstructionnisme, en l’incarnant dans un postmodernisme de la juxtaposition, dans une Babel de la traduction infinie. Une légende indienne ou africaine a même valeur que la Critique de la raison pure ou que La recherche du temps perdu... Si la pensée se déploie partout, si la vérité est à l’œuvre dans un « toujours différer », alors on ne voit plus pourquoi privilégier une certaine forme de discours par rapport aux autres.
Cette stratégie, si elle se revendique de la pensée dite déconstructionniste ne semble cependant pas en faire partie intégrante. Elle peut même être considérée comme sa trahison. Car la déconstruction, au sens philosophique et derridien du terme en tout cas, n’est jamais la juxtaposition de discours distincts. Parler d’une identité indienne, d’une identité noire, d’une identité gay, d’une identité femme, c’est reconstituer cela même que l’on avait dissout : substituer à un Un, des Uns identifiables, présents à soi et susceptibles de se présenter et de se présentifier, c’est substituer à la différence, à la différance comme toujours différer, une pluralité ou mieux une multiplicité. (On revient au dénombrable qui avait précisément été mis en question.) Le genre noir, le genre indien, le genre femme, n’existe pas plus que le genre humain. Et la différence derridienne vise précisément à empêcher la détermination des différents, à dénoncer non seulement la dualité mais aussi la multiplicité, bref à contester tout ce qui ferait limite. (Mais, répondront encore les défenseurs du « politically correct », le regroupement identitaire est une nécessité imposée par le système dominant.)
Différence et différend
Mais quoi qu’il en soit de la validité du lien généalogique établi ainsi entre la pensée déconstructionniste et des stratégies socioculturelles déterminées, il n’en reste pas moins que dans la mise à plat des différences, ou la substitution de la différence au régime des oppositions, le différend effectif est éludé, et les rapports de domination escamotés dans leur résolution spéculative.
Ce traitement des problèmes politiques par le biais de leur dénégation est peut-être symptomatique d’une pratique contemporaine plus générale. La position de ceux qui se considèrent comme purs de toute pensée discriminante (sexiste ou raciste) consiste souvent aujourd’hui à éluder les données du problème plutôt qu’à les affronter et à tenter de les résoudre dans leurs termes réels. Ainsi, à titre de comparaison, « il n’y a pas de problème de l’immigration, pas de problème de races, pas de problème des sexes » remplace souvent un agir politique effectif par une généreuse formule magique qui ne peut qu’exaspérer les problèmes au lieu de les résoudre.
Si la dualisation du rapport des sexes et le privilège accordé à l’un - le masculin - sur l’autre - le féminin - est irrecevable, ce dualisme ne peut être dépassé par sa simple dénégation : il exige d’abord d’être nommé. Autrement dit la différence indifférente ne peut s’accomplir dans la pratique que par la destruction des rapports de pouvoir qui aujourd’hui encore « arraisonnent » les sexes. Si « homme » et « femme » sont ontologiquement dans un rapport de « différance » c’est-à-dire de différer qui les rend inidentifiables, ils sont sociopolitiquement dans un rapport de domination qui les dualise. L’expérience ne cesse de renvoyer une femme à son appartenance sexuée, et une philosophie qui prend en charge la question des sexes en les présentant seulement dans leur différer indécidable escamote cette expérience. C’est en ce sens que l’on peut donc parler d’un « antiféminisme » de la philosophie contemporaine, certes très différent de l’antiféminisme vulgaire de la philosophie traditionnelle qui assignait, elle, aux femmes une position inférieure ou spécifique par nature, un « antiféminisme » plus subtil qui en déniant au contraire aux catégories d’homme et de femme toute réalité substantielle - et sans doute à juste titre - évite de s’interroger sur leur dualisation hiérarchique effective et sur les stratégies de son dépassement [11]. La pensée soft risque ainsi de faire le jeu de la pensée hard.
La question est de savoir si toute politique est supportée par des présupposés métaphysiques. Soutenir une politique non métaphysique, c’est-à-dire libre de la définition de sa fin et de ses acteurs, c’est là, à mon sens, l’enjeu périlleux du féminisme. Travailler à l’élimination des rapports de domination n’est pas nécessairement postuler une adéquation possible des femmes, des hommes, ou des êtres humains à leur « essence », voire s’en donner la représentation. Ne sommes-nous pas appelées, et appelés aujourd’hui, à un agir, à une praxis [12] (notion que j’élis en la décantant de ses consonances marxistes), de la différence des sexes, en dehors de toute assignation des différents à une place idéale ? La reconnaissance du différend - et le différend déborde sa seule version politique, à laquelle nous nous sommes limitée ici - ne fait-elle pas partie intégrante de la reconnaissance de la différance ? Et le méconnaître, n’est-ce pas, sous une forme certes subtile, reconduire l’hégémonie séculaire de l’Un ?
[1] Dénégation ou forclusion ?
[2] En France, et à des titres divers, Sarah Kofman, Geneviève Fraisse, Annick Jaulin, Michèle Le Doeuff entre autres.
[3] Bien qu’il recoure au terme de féminin, en particulier dans son rapport à Nietzsche, Derrida est bien conscient du risque de reterritorialisation que comporte l’usage du terme. II voudrait neutraliser ou universaliser les métaphores féminines (hymen, invagination...) comme l’ont été les métaphores masculines.
[4] Je l’avais relevé en 1976 dans « Du côté de Claudia ou Madame Moffat balaiera tout ça », in Gramma 5, Lire Blanchot, pp. 88-103.
[5] J. Derrida, Parages, éd. Galilée, 1986, pp. 279-280.
[6] Lacan, « Dieu et la jouissance de la femme », 1976, in Encore, éd. du Seuil.
[7] Voir « Différence et différend » in Histoire des Femmes, t. V, sous la direction de M. Perrot et G. Duby, 1992.
[8] J. Derrida, Points de suspension, éd. Galilée, 1992, p. 174.
[9] Id. ibid., p. 95.
[10] Id. ibid., p. 99.
[11] Ce n’est pas l’engagement personnel de Derrida face aux situations politiques qui est interrogé mais la difficulté de la prise en compte de la dimension du politique dans la pensée de la différence.
[12] Je renvoie à ce sujet à « Praxis de la différence, notes sur le tragique du sujet » in Provenances de la pensée, Cahiers du Grif, éd. Tierce, 1992.
Pour citer cet article :
Francoise Collin , « Le philosophe travesti ou le féminin sans les femmes », Fédération de recherche sur le genre RING, 2 août 2010. URL : http://www2.univ-paris8.fr/RING/spip.php?article1072
Fichiers de syndication :
Statistiques :
Le site contient 4383 articles