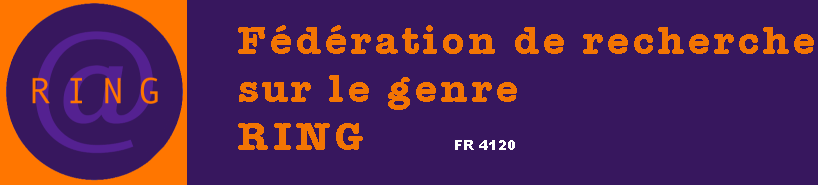État et structuration des études de genre en Italie
par Ginevra Conti Odorisio, professeure d’histoire, Université de Rome 3
Télécharger le texte en format .rtf ici
1. Données historiques sur l’institutionnalisation des études de genre dans les Universités italiennes de 1985 à 2005.
Dans cet exposé, je présenterai, en première partie, quelques données historiques sur le problème de l’institutionnalisation des études de genre dans les Universités, en Italie, de 1985 à 2005. J’aborderai, en seconde, la question complexe de l’usage de ce concept dans la recherche scientifique. Un des résultats les plus intéressants du mouvement féministe a été celui de souligner l’absence de connaissances de l’histoire des femmes et en général de l’apport des femmes à l’histoire, aux sciences et aux différentes disciplines, comme l’histoire de la pensée politique, dont je m’occupe. En 1975, quand avec Ida Magli, qui enseignait l’Anthropologie culturelle à l’Université La Sapienza de Rome, et sa jeune assistante, Annarita Buttafuoco, nous avons fondé la première revue d’études sur les femmes « Donna Woman Femme » 1, nous connaissions très mal notre sujet. Nous étions sûres qu’il y avait beaucoup à découvrir, et étions animées d’un très grand désir de contribuer au renouvellement de notre culture politique. C’était un beau rêve que d’unir à ma passion de chercheuse, et à mon engagement politique dans le mouvement des femmes, la création d’une revue avec un groupe d’amies. Le rêve n’a duré que le temps de quelques numéros. Tous ceux qui ont eu affaire aux mouvements des femmes connaissent toutes les implications affectives, psychologiques, politiques qui se déclenchent. Ida Magli et moi, sommes sorties de la revue à cause de « divergences politiques », comme on peut le comprendre à la lecture des premiers numéros de la revue. Abandonner la revue ne signifiait pas renoncer à mes recherches. Examiner les penseurs politiques dans leur intégrité, dans leurs vues sur le rapport femmes-societé-droits, ouvrait, à mon avis, des perspectives d’interprétation nouvelles qui étaient en contraste avec la déqualification académique que le sujet avait en soi. Il fallait donc faire admettre, d’un coté, la dignité scientifique du sujet, et de l’autre, l’insérer dans le processus de formation et de transmission des savoirs académiques. Ce n’était pas facile car ce type de perspective était réputé idéologique, et toutes les études sortant de là étaient comme disqualifiées. De 1979 à 1984, se sont tenus d’importants congrès dans lesquels on discuta considérablement des Women’s Studies, de leur reconnaissance et de leurs institutionnalisation. Ainsi, en 1979, organisée par Françoise Collin, l’ouverture de la première Université des femmes à Bruxelles ; en 1980, un Congrès international sur les Women’s Studies à Berlin, puis en 1984, sur l’Histoire des femmes au Smith College. Ces événements permettent de constater la richesse des approches et des résultats acquis sur le plan méthodologique et institutionnel en quelques années
2. Politique des études de genre
En 1986, avec un groupe d’amies et de collègues, avec lesquelles a été ensuite fondé le CISDOSS, Centre interuniversitaire pour les études sur les femmes dans l’histoire et dans la société, a été organisé à Rome le premier Colloque international sur « les Women’s Studies dans les Universités ». L’année précédente, en 1985, vraiment par hasard, avec l’aide de Paolino Ungari, juriste et auteur d’un livre fondamental sur le droit des familles 2, on avait ouvert le premier enseignement institutionnalisé de Women’s Studies à l’Université Libre Luiss de Rome, intitulé « Histoire de la question des femmes ». Le choix de l’appellation qui n’était pas neutre, avait été conditionné par le milieu auquel il était destiné. Cette appellation avait semblé au Conseil de Faculté plus acceptable que d’autres comme « Histoire des femmes », ou « Histoire des rapports sociaux des sexes ». C’était une appellation qui avait une tradition historique consolidée, rappelait par analogie d’autres disciplines déjà enseignées, comme l’Histoire de la question méridionale ou de la question ouvrière. En plus, cette dénomination d’apparence neutre, c’est-à-dire pas ouvertement « féministe », avait la possibilité d’inclure aussi les courants de pensée plus divers : traditionalistes, catholiques, misogynes, anti-féministes. Ce qui ne m’épargna pas une longue suite de commentaires ironiques ou sarcastiques de la part des collègues, pour lesquels, au contraire, cette appellation était déjà trop ouvertement féministe et idéologique. Comme de la part des féministes la jugeant, en revanche, trop académique.
3. Le refus de l’institutionnalisation. (1986-2000)
A partir de la fin des années 80, le débat sur l’institutionnalisation des Women’s Studies dans les Universités, aussi bien sur le plan national qu’européen, prit un tour tout à fait négatif. Après le Congrès de Rome de 1986, j’avais publié les actes dans Studi sulle donne nelle Università : ricerca e trasformazione del sapere 3. Choisir une traduction italienne de Womens’ Studies - « Études sur les femmes » ou « Études des femmes » - était difficile car chaque solution était envisagée, non pas comme un choix dérivant d’une stratégie d’acceptation et d’insertion, mais comme un choix politique, une déclaration d’appartenance. Conscientes de la portée novatrice intrinsèque de notre choix, nous avions opté pour la formule plus neutre et plus acceptable dans le milieu académique d’Études « sur les femmes » et non « des femmes », études ouvertes à tout le monde et appartenant à tous, parmi lesquelles , le cas échéant, place aurait faite pour les "études des femmes". Il s’agissait de souligner l’importance de la recherche, et pas seulement du politique, mais l’importance de la politique de la recherche. La thèse prévalente fut qu’il ne fallait pas poser la question dans des termes définis "réductifs", insérer les études féministes dans les universités ou non, et que cela représentait suivre le modèle américain 4. En réalité, la proposition d’institutionnaliser n’excluait aucune autre expérience ni réflexion dans des lieux et des formes différentes. Elle était inspirée seulement de la conviction de la nécessité, d’une part, de formation des jeunes générations qui sortaient des universités avec une culture encore pleine de stéréotypes et de lieux communs, et sans aucune connaissance objective de l’histoire des femmes et des modalités d’accès aux droits politiques, juridiques et sociaux ; et, d’autre part, de la reconnaissance de la dignité du sujet « femme » comme objet d’études dans les différentes disciplines, ainsi que de l’accès aux ressources nationales pour la recherche scientifique, détail tout à fait négligé par les opposants.
Le succès de ce refus était dû à différentes raisons. On objectait que, insérées dans les Universités, les W.S. auraient perdu leur caractère novateur et auraient été normalisées. Il fallait d’abord transformer les Universités, décider à quelles valeurs nous pensions et à quelle notion d’université : un îlot de pensée progressiste ou un véhicule de contrôle social ? De plus, où étaient les projets féministes pour une université qui réponde aux défis de notre temps ? Cela voulait dire, qu’au lieu de s’engager dans une réforme possible, il fallait en poser d’autres, plus vastes et radicales, impossibles. Certains mettaient en relation les Women’s Studies avec les droits de citoyenneté des femmes émigrés, et d’autres avec le lesbianisme. Des raisons différentes découlaient en général de la faiblesse des chercheuses féministes à l’intérieur des Universités et de leurs conflictualités internes. On évoquait alors la subjectivité féminine. Au fond des positions défendues existait un trait commun : celui du refus de reconnaître et d’admettre une relation avec les institutions, politiques ou culturelles, dans la conviction que l’histoire des femmes se déroulait dans un espace « autre » avec des modalités et des contenus « différents ». On exprimait ainsi une profonde méfiance vers la politique et les instruments de la démocratie libérale, qui a contribué à conserver la marginalisation politique des femmes. On soutenait que « répresentation et rappresentanza sont des concepts qui ont pour les femmes une valeur évocative, provisoire, imprécise... » 5. On affirmait aussi que le mouvement des femmes voulait contester et dépasser la classique division des disciplines, ce qui voulait dire se poser en dehors des logiques universitaires.
Pour l’Italie, dans le cadre d’un programme européen géré par Les Cahiers du Grif, en 1989 et en 1993, on avait effectué un recensement des études et des cours sur les femmes, qui, malgré tout, s’instauraient dans les Universités. Les premiers résultats furent discutés dans un colloque en 1993, à Bruxelles, où d’ailleurs la question théorique et l’élaboration d’une stratégie politique n’avancèrent pas 6. Le but des institutions communautaires était aussi de faire le point sur les recherches féministes consacrées à la construction européenne et d’en susciter de nouvelles. Comme le souligna Françoise Collin dans son Avant-propos, « les femmes s’étaient souvent montrées plus réticentes et plus critiques que les hommes... On pourrait dire que les femmes témoignent d’une méfiance particulière à l’égard de changements structurels qui, intervenant au milieu des luttes qu’elles mènent pour leurs droits, risquent d’en fragiliser les acquis ou d’en compliquer la poursuite » 7. Personne n’a considéré le problème dans les termes de la politique du possible et de la politique de la recherche scientifique : l’absence des études de genre dans les universités signifiait aussi le manque de ressources, réservées intégralement aux études traditionnelles ; le manque de reconnaissance scientifique ; l’impossibilité de formation de jeunes chercheuses, l’abandon des jeunes à la culture traditionnelle. Malgré cette position de refus, la situation, en réalité, a évolué au cours des années en fonction de la situation personnelle des chercheuses dans les Universités, surtout dans le secteur de la sociologie. Ainsi, à l’Université de Turin (Chiara Saraceno) et à celle de Milan (Laura Balbo), ont été créés des Centres interdépartementaux pour la sociologie.
En Mai 1991, on avait constitué avec l’Université de Roma « La Sapienza » et l’Université de Cassino, un Centre interuniversitaire pour les Études sur les femmes dans l’histoire et la société (C.I.S.DO.S.S.) étendu, ensuite, à l’Université de Roma Tre, à condition qu’il soit à "coût zéro". De 1991 à 1994, le Centre a organisé plusieurs séminaires et conférences remarquables. Une conférence de Simone Balayé, présidente de la Société des Études staëliennes, sur Madame de Staël e la condizione femminile (avril 1992) ; des workshops méthodologiques animés par : Jean Bethke Elshtain de la Vanderbilt University (mai 1992), Geneviève Fraisse du Centre national de la Recherche scientifique (mai 1993), et Adriana Cavarero de l’Université de Padoue (mai 1994). Des colloques, enfin, dont un consacré à Salvatore Morelli, le seul homme politique italien à s’être occupé, au XIXe siècle, de la condition des femmes 8, et un second, avec l’Université de Cassino, à Antonio e Teresa Labriola.
4. Les études de genre pénètrent dans les Universités (malgré tout)
La politique européenne pour l’égalité des chances a contribué à raffermir la nécessité du renouveau de la culture traditionnelle et de la nécessité de compréhension de tous les phénomènes historiques liés au genre. Plusieurs documents européens, nombreux Plans d’Actions, consolident le principe de l’égalité des chances homme-femme comme point central de la politique de l’Union Européenne. Dans le IVe Programme (1996-2000), on relève même une référence explicite à la stratégie multidisciplinaire des Women’s Studies, et le souhait d’une intégration du genre dans les Universités 9. Dans le Rapport du Groupe de réflexion sur Éducation et Formation en Europe, le principe de la parité est inséré dans les valeurs européennes à coté des droits de l’homme, de la liberté et de la légitimité démocratique 10.
Avec l’application de la réforme universitaire (2001-02), on assiste en Italie à un changement de climat. A la rigidité disciplinaire succède une certaine souplesse de la spécification, au moins dans le « lauree specialistiche ». Dans les Universités, il est désormais acquis la possibilité de créer de nouveaux cours de laurea et d’indiquer des thématiques de cours différents de celles traditionnelles. Il n’y a donc plus la rigidité du système précédent. La compétition pousse les Universités à la création de cours, de Masters, dont on suppose un vaste intérêt. Nombre d’entre-elles a ainsi instauré des Masters sur les politiques d’égalité de chances, des cours de perfectionnement sur le genre et l’histoire des femmes, sans que les enseignant-e-s, hormis quelques exceptions, aient bénéficié d’une formation scientifique régulière et universitaire. Il existe quelques Doctorats de Recherche, parmi lesquels un en Histoire et littérature à l’Université Orientale de Naples, un autre sur les Écritures féminines à la Sapienza de Rome, et celui que je coordonne sur Question des femmes et les politiques pour la parité, section de l’École doctorale de Sciences politiques de l’Université Roma Tre.
Depuis trois ans, même le Ministère pour la Parité des opportunités, surmontant le principe de l’autonomie des Universités, sponsorise, dans toutes les Universités, à l’aide d’un financement européen, des cours sur Femmes, Politique et Institutions auxquels ont accès nombreuses femmes, pas spécialement inscrites aux Universités. Cela donne lieu à une situation paradoxale : un Ministère qui préconise des cours dans les Universités sur un sujet non reconnu, sauf exceptions ; des Universités qui organisent une didactique sans avoir, en principe, formé les enseignants ; des femmes qui suivent un cours dans une Université sans être inscrites et des étudiants universitaires, régulièrement inscrits, qui terminent leurs études et reçoivent des de titres officiels sans aucune obligation de connaître l’histoire de la moitié de la société, ni d’être formés à la politique européenne sur la parité homme-femme, politique qui les concerne et les touche directement. Considérant cela, je ne veux pas soutenir l’inutilité de ces cours, mais tiens à mettre en lumière les conséquences du refus de l’institutionnalisation et ses risques. Pour ces enseignements, on a donc fait appel à des chercheurs explorant des secteurs disciplinaires généraux (Histoire moderne et contemporaine, Philosophie politique), et entrés en recherche féministe d’une manière autodidacte ou politiquement engagée, voire à des professeurs ignorant des Women’s Studies, cela dans une logique tout à fait académicienne selon laquelle, les Universités ne pouvaient agréer ces cours qu’à la condition qu’ils fussent ouverts à tout le monde. Voilà où a abouti la politique de recherche des espaces et des lieux " autres ", d’une Université " différente" : les espaces et les lieux institutionnels sont restés solidement aux mains de leurs détenteurs traditionnels. Pour les cours sur Femmes, Politiques et Institutions, certains d’entre eux ont été aussi tenus par des professeurs pour lesquels les problèmes méthodologiques des WS, les femmes, la politique et les institutions étaient tranquillement absents ou vus d’une manière traditionnelle.
Le risque est aussi la perte de professionnalisation, de la valeur des nouvelles compétences acquises et l’idée que tout le monde peut faire des WS, exactement comme dans les conférences sur les femmes où tout le monde se croit légitimé à intervenir et à parler « des femmes », car qui ne sait pas ce qu’est une femme ? Mais l’autocritique n’est pas encore arrivée, et toutes les résistances ne sont pas vaincues. C’est comme si on ne voulait pas admettre des " intrus " à cultiver un champ considéré comme une propriété exclusive et réservée. Di Cori déplore que "les Women’s Studies aient été engendrées par le haut" et reconnaît que ces études ont été accueillies avec "beaucoup de réserves et soutenues très faiblement dans leur institutionnalisation par celles qui depuis plusieurs années ont promu et pratiqué ce genre d’études" 11. Le curieux est qu’elle enseigne Studi di Genere e Studi Culturali dans la Faculté de Sociologie de l’Université de Urbino. Pour l’Université de Roma Tre, très sensible à cette thématique, le Comité de l’égalité des chances à promu une enquête dont on apprend que pour un total de 308 femmes enseignantes seuls trois cours spécifiques existent : celui que j’assure à Sciences Politiques, un second sur l’histoire de l’instruction de genre à Science de la Formation, un troisième, enfin, sur le Feminist Film Theory à la Faculté de Lettres 12. Aucun cours à la Faculté d’Économie de Loix ni à celle de Jurisprudence.
Quant à l’évolution du CISDOSS, le "coût zéro" s’est avéré pénalisant, car face à l’absence de ressources, nécessaires à l’organisation des colloques, séminaires, publications, à une activité quelconque, il fallait produire une énorme quantité de documentation administrative, procès verbaux, demandes de renouvellement des conventions et autres accomplissements bureaucratiques fastidieux. Pour ces raisons, le CISDOSS a été, en mai 2004, transformé en un Centre International de recherche, toujours à coût zéro, mais sans aucune obligation de procédures administratives, et situé dans le Département d’Études Internationales.
5. Le genre dans la recherche scientifique
Dans les années 70, quand on a commencé à vouloir introduire l’histoire des femmes dans l’histoire, on pensait, on souhaitait que l’insertion de ce thème dans l’historiographie traditionnelle, aurait tout bouleversé, tout changé. Il aurait fallu une nouvelle périodisation, de nouvelles classifications, de nouvelles définitions. C’était une position maximaliste destinée, avec les années, à être réduite, car on a dû constater que l’insertion n’était toujours pas facilement acceptée et que les disciplines traditionnelles conservaient fortement leurs positions. L’acceptation de la thématique du genre est, à mon avis, nécessaire, dirais-je indispensable, et si elle ne détruit pas les disciplines traditionnelles, ni les transforme complètement, elle les enrichit certainement et les complète. La publication de l’article de Joan W. Scott sur Gender : a Useful Category of Historical Analysis 13 a constitué un moment important et donné une contribution profonde à la réflexion. Il n’est pas question ici de l’analyser mais il faut rappeler, en des termes généraux, qu’avec " genre ", on voulait définir une nouvelle catégorie d’interprétation historique comprenant toutes les caractéristiques dérivantes de l’organisation sociale des relations entre les sexes. Il s’agissait d’un nouvel usage du terme passant de la grammaire au langage historique et politique. Dans sa signification plus profonde, le terme Genre indique le refus du déterminisme biologique, c’est-à-dire de la conception fonctionnaliste des deux sexes et met l’accent sur les aspects relationnelles des deux sexes. Non plus des études sur la femme mais sur les rapports entre les sexes, et l’évolution historique des rapports de sexe. D’un point de vue général, cela implique le refus des différences de sexe en des termes fixes et ontologiques, comme on le fait quand on parle d’une "différence" des sexes, de la dichotomie fixe et immuable entre homme et femme, des qualités des femmes et des hommes, de l’influence des corps sur l’esprit. Dans le champ de l’histoire des doctrines politiques, la notion de genre peut contribuer à mettre en relief comment les valeurs culturelles d’une époque concernant la féminité et la masculinité sont devenues partie d’un discours politique pour conserver, changer ou transformer un certain ordre politique. Cette nouvelle catégorie dans l’interprétation de la pensée politique ne devrait pas se limiter à l’ajout de quelques citations de phrases sur les femmes mais devrait tendre à démontrer comment cet aspect fait partie intégrante de la vision qu’un auteur a eu des buts, des possibilités, des caractéristiques et des limites de la vie politique. Dans mon article sur Pensiero politico e genere : incompatibilità o integrazione ?, j’ai indiqué trois façons possibles de tracer les liens entre pensée politique et genre 14. La première réside dans l’étude des grands classiques des idées politiques, qu’il convient d’analyser dans leur contexte complet, c’est-à-dire sans éliminer, comme on l’a toujours fait, leur pensée sur les femmes. Une deuxième consiste à considérer sans exclusive tous les problèmes politiques qui naissent du rapport femme-societé, examiner toutes les positions, non seulement celles favorables à l’émancipation, mais aussi celles opposées, les traditionalistes et anti-féministes. Enfin, la troisième concourt à l’émergence de toutes les critiques, des femmes aussi bien que des hommes, sur la condition traditionnelle de la femme, ce pour la recherche d’une nouvelle forme d’organisation sociale et politique, que j’appellerai histoire de la pensée féministe et de la contribution des femmes théoriciennes. Dans l’histoire des idées, le critère du genre fait ainsi appel à une méthodologie intégrée, où il n’y a pas l’histoire des hommes d’un coté et celle des femmes de l’autre, mais qui rend compte de leur dialogue, du contraste, des victoires et des défaites. Tel n’est pas l’avis de Gisela Bock qui prône une histoire séparatiste et différentialiste. Elle a soutenu que la pensée des philosophes et doctrinaires politiques mâles ne regarde pas les femmes, et que l’étude de leur doctrine se limite à « l’exposition et la répétition de choses réellement ou présumées misogynes dites ou écrites par les hommes dans les siècles et qu’à partir de l’indignation et de la dénonciation porte souvent à une espèce de fascination » 15. En s’appuyant sur les thèses de Carol Gilligan et sur la voix différentes des femmes, il faudrait écrire, selon elle, et que je considère comme impossible, une histoire des idées aux féminins. On y retrouverait des « différences significatives par rapport à la pensée et aux opinions masculines ». Il faut rappeler la position de Joan Scott qui ironise sur les différentes voix que certaines féministes entendent. Elle souligne le manque d’historicité et les imprécisions de cette thèse. Comme de celles qui voudraient les femmes porteuses d’une éthique supérieure. Historiquement toutes les valeurs, bonnes ou mauvaises, ont été soutenues par des hommes et des femmes. Difficile de trouver des pages plus belles et plus touchantes écrites par un homme sur la maternité 16, que celles de Poullain de la Barre.
Je ne parlerai donc pas non plus d’une pensée politique des femmes, terme vague et chronologiquement pas délimité, comme l’a fait R. Baritono 17, qui appartient elle aussi au courant de la différence, mais de ce que femmes et hommes ont pensé et écrit sur la condition des femmes, les rôles sociaux et les droits civils, politiques et sociaux. Poullain de la Barre, Mill, Morelli et tant d’autres peuvent-ils être inclus dans la pensée politique des femmes ? Bien des femmes ne se reconnaîtront pas dans la définition donnée par R. Baritono dans son article sur le "pensiero politico delle donne". Elle ne s’occupe pas de la réflexion politique des femmes ou des problématiques et des concepts de la théorie politique mais s’intéresse « à la pratique politique des femmes qui à partir des années 60 ont adressé une critique profonde et radicale aux sociétés capitalistiques occidentales dans leurs structures politiques et sociales qui avaient légitimé l’oppression et la subordination des femmes dans la sphère sociale et familiale, puis leur exclusion et leur marginalité dans la sphère politique » 18. On attribue donc une terminologie universaliste à un groupe de femmes politiquement engagé, en excluant les femmes qui ont une position politique différente, qui se reconnaissent dans les démocraties occidentales et qui croient que les théories politiques féministes (pas seulement des femmes) soient une partie intégrante des théories démocratiques. En plus, quand on étudie à fond l’histoire des mouvements d’émancipation et des femmes théoriciennes politiques des siècles passées on peut constater que jamais leur oppression n’a été légitimée, mais constamment contestée. D’un autre côté, le refus du concept de genre est expliqué, toujours du côté d’une théorie féministe de la différence, comme le refus d’une forme d’idéologie 19. Pour ce courant, le féminisme et une adhésion à l’idéologie du genre s’excluent mutuellement 20. Le féminisme serait une pratique de transformation socio-culturelle radicale et « le lesbianisme une des formes constitutives de la liberté du sujet » 21. Ce qui exclut du féminisme la masse des femmes hétérosexuelles et la politique de la parité.
Nous n’avons encore pas en Italie un ouvrage aussi complet, vaste, très important d’un point de vue méthodologique, que celui de Françoise Collin, Eleni Varikas et Evelyne Pisier, Les Femmes de Platon à Derrida, (Paris, 2000). Les auteures soutiennent, correctement, que quelques façons qu’on veuille interpréter le genre, on ne peut ignorer ce que les philosophes ont pensé, transmis et qui se trouve à la base de nos convictions et valeurs sociales.
On peut constater que la différence des sexes ne constitue pas un " impensé politique " comme on a souvent soutenu, mais a été au centre de la réflexion des philosophes, souvent déterminant des contradictions inéliminables comme celle de Locke entre égalité naturelle de tous les hommes et différence homme-femme. Et surtout, à coté de Locke, on voit restitué le personnage de Mary Astell, absente des livres traditionnelles d’histoire de la pensée politique, et qui fut une des premières femmes à souhaiter le droit à l’instruction féminine et à la création d’un centre "institutionnalisé" de formation féminine. Moi-même ai essayé de faire sortir d’un profond trou noir de l’histoire la grande sociologue et politologue Harriet Martineau en la situant à coté du célèbre Tocqueville dans mon livre sur Harriet Martineau et Tocqueville, deux différentes interpretation de la démocratie américaine (Rubbettino, 2003). Ce qui pouvait sembler une extravagance idéologique, c’est-à-dire placer à coté du plus important penseur politique le nom d’une femme inconnue, certainement oubliée, a permis au contraire de s’approcher de la réalité historique, d’élargir notre vision du débat sur la démocratie américaine et sur ses interprétations. Il a été ainsi possible de mettre en relief la pensée d’une femme qui a souligné, plus que les dangers de la démocratie, ses contradictions et ses inconséquences, c’est-à-dire l’esclavage des noirs et l’absence de citoyenneté politique des femmes 22.
Pour conclure, nous sommes loin d’avoir pu recueillir tous les fruits que la maturité scientifique acquise par l’analyse féministe et la définition de la catégorie du genre auraient pu nous donner. La philosophie de la différence des sexes porte en premier plan les problèmes du corps et du corps féminin, problèmes certainement plus proches du biologique que du politique. Selon la philosophie de la différence, toutes les pratiques politiques pour la parité portent à l’homologation, et les femmes doivent, sans renoncer à leur sphère féminine, penser à une politique "différente". Cela équivaut à mettre les femmes dans l’impossibilité d’accomplir aucune action, car poser le problème d’une différence féminine dans l’utilisation du pouvoir, dans la direction d’une entreprise, dans la représentation politique, dans un contexte général inchangé, signifie anéantir tout effort de changement. C’est au niveau des programmes politiques que peut exister une différence.
On n’a pas suffisamment pris en compte la spécificité des différentes disciplines. La recherche historique n’a toujours pas atteint un degré élevé de maturité et de résultats. Dans tous les secteurs, le travail à réaliser reste encore immense. L’histoire politique, l’histoire de l’émancipation, qui représentent le c ?ur de l’histoire des femmes, sont encore trop négligées. On s’occupe beaucoup des saintes, des congrégations religieuses, des infirmières, tous sujets très respectables, mais on ne dispose toujours pas de biographies des émancipationistes du XIXe siècle, d’études sérieuses sur les journaux féminins et féministes, de reprints anastatiques, de recueils d’actes parlementaires, ni de tous les instruments d’accès aux sources de l’histoire des femmes. Cela dit, l’utilisation de la catégorie du genre me semble utile sans être indispensable. Elle est une façon scientifique, élégante, "politically correct", pas dérangeante, de parler des femmes et de toutes les questions connexes sans toujours répéter le terme "femme" si difficile à entendre et si fastidieux, répété sans cesse. Mais à bien réfléchir, « genre » n’est rien autre que la synthèse de toutes les théories féministes expliquant pourquoi l’oppression des femmes était de nature culturelle et non pas biologique, et exprime le refus du déterminisme biologique, le refus des classifications fixes et rigides, le refus enfin de l’infériorité et de la supériorité.
Voilà pourquoi existent de très bonnes études de genre bien avant le genre, à récupérer absolument. Je pense notamment aux ouvrages d’Anna Maria Mozzoni La donna e i suoi rapporti sociali, de Julie Daubié, La femme pauvre au XIXe siècle, de Leroy Beaulieu (un homme) sur Le Travail des femmes au XIXe siècle, de Jessie White Mario sur La miseria à Napoli, et de tant d’autres qu’on voudrait revoir publiées pour pouvoir approfondir les études de genre.
Notes :
1. "Donna Woman Femme", Rivista Internazionale di studi antropologici, storici e sociali sulla donna, I, ott.-dic. 1975, Roma, Bulzoni.
2. P. Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia, Bologna, Il mulino, 1974.
4. La ricerca delle donne. Studi femministi in Italia, a cura di M. Cristina Marcuzzo e Anna Rossi-Doria, Rossenberg Sellier, 1988, p. 7.
6. Gli studi sulle donne in Italia nella banca dati Grace, a cura di G. Conti Odorisio e R. Modugno, Roma 1994.
7. F. Collin, "Avant-propos", in "Les femmes et la construction européenne. Egalité ? Parité ?",Les Cahiers du Grif, Bruxelles, Grace, s.d., p. 5.
8. Voir Salvatore Morelli, "emancipazionismo e democrazia nell ?ottocento europeo", a cura di G. Conti Odorisio, Napoli, ESI, 1992.
9. G. Conti Odorisio, "La rivoluzione femminile", in Eredità del novecento a cura di E. Di Nolfo, Roma, Enciclopedia Treccani, 2001, p. 897-898.
10. Groupe de réflexion sur l ?éducation et la formation, Accomplir l ?Europe par l ?éducation et la formation, Bruxelles, Commission Européenne, 1997, p. 60.
11. P. Di Cori, Atena uscita dalla testa di Giove. Gli studi delle donne in Italia, Carocci, 2001, p. 15.
12. C.P.O., Gli Universi femminili di Roma Tre, didattica e ricerca in ottica di genere, Roma, Univ. Roma Tre, 2006.
13. Publié en 1986 dans The American Historical Review et traduit en italien en 1998 dans la Rivista di Storia contemporanea, 1998, fasc. 4, pp. 560-586.
14. G. Conti Odorisio, "Pensiero politico e genere : incompatibilità o integrazione ?" in AA.VV. Strumenti didattici e orientamenti metodologici per la storia del pensiero politico a cura di E. Guccione, Firenze, Olschki, 1992, pp. 241-252 ; aussi dans mon Ragione e Tradizione, Roma, Aracne, 2005, pp. 11-22.
15. G. Bock, Storia delle donne, storia di genere, Firenze, Estro editrice, 1988, p. 40.
16. G. Conti Odorisio, "Poullain de la Barre : ragione ed eguaglianza" in Ragione e tradizione cit., p. 87-88.
17. R. Baritono, "Il pensiero politico delle donne" in Il pensiero politico. Idee, teorie, dottrine, Torino, UTET, 1999.
19. Teresa De Lauretis, Sui generi. Scritti di teoria femminista, Milano, Feltrinelli, 1996, p. 141.
22. G. Conti Odorisio, Harriet Martineau e Tocqueville, due diverse letture della democrazia americana, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003.
Pour citer cet article :
Ginevra Conti Odorisio, professeure d’histoire, Université de Rome 3 , « État et structuration des études de genre en Italie », Fédération de recherche sur le genre RING, 25 juin 2013. URL : http://www2.univ-paris8.fr/RING/spip.php?article2740
Fichiers de syndication :
Statistiques :
Le site contient 4383 articles